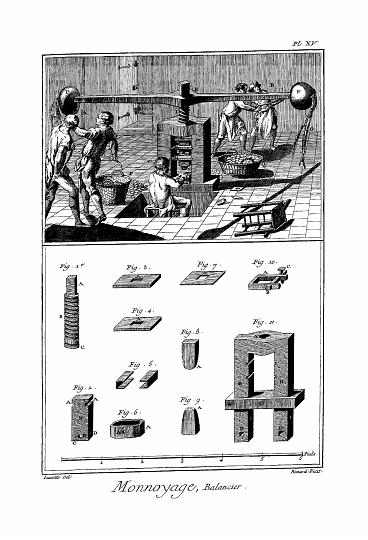S. m. (Morale et Commerce) Le crédit étant en général la faculté de faire usage de la puissance d'autrui, on peut le définir plus particulièrement en fait de commerce et de finance, la faculté d'emprunter sur l'opinion conçue de l'assurance du payement.
Cette définition renferme l'effet et la cause immédiate du crédit.
Son effet est évidemment de multiplier les ressources du débiteur par l'usage des richesses d'autrui.
La cause immédiate du crédit est l'opinion conçue par le prêteur de l'assurance du payement.
Cette opinion a pour motifs des sûretés réelles ou personnelles, ou bien l'union des unes et des autres.
Les sûretés réelles sont les capitaux en terres, en meubles, en argent, et les revenus.
Les sûretés personnelles sont le degré d'utilité qu'on peut retirer de la faculté d'emprunter ; l'habileté, la prudence, l'oeconomie, l'exactitude de l'emprunteur.
Ces causes, quoiqu'ordinaires, ne sont cependant ni constantes, ni d'un effet certain ; parce que dans toutes les choses où les hommes ne se sont pas dépouillés de leur liberté naturelle, ils n'obéissent souvent qu'à leurs passions. Ainsi il arrive que les sûretés réelles et personnelles ne font pas toujours sur l'esprit des hommes une impression proportionnée à leur étendue ; on les méconnait où elles sont, on les suppose où elles n'existent jamais.
Par une conséquence nécessaire de ce que nous venons de dire, tout crédit a ses bornes naturelles ; il en a d'étrangères qu'il n'est pas possible de déterminer.
Quoique les sûretés personnelles soient moins évidentes que les sûretés réelles, souvent elles n'en méritent pas moins de confiance : car en général elles tendent continuellement à procurer des sûretés réelles à celui qui les possede.
De cette considération il résulte, que si l'un et l'autre crédit excède sa proportion connue, le danger est moindre respectivement au crédit personnel.
L'objet du crédit réel ne peut disparaitre, il est vrai : c'est un grand avantage, et l'unique motif de préférence sur l'autre qui peut cesser d'exister pendant quelque temps sans qu'on le sache.
Cette différence emporte avec elle trois sortes de risques de la part du crédit personnel : l'un est plus attaché à la nature des moyens qu'à l'industrie d'employer des richesses d'autrui ; le second regarde la prudence de l'emprunteur ; le troisième, sa bonne foi.
Le premier risque s'évanouit si le second est nul : il est constant que l'industrie ne s'exerce que pour acquérir des sûretés réelles ; que tout homme prudent gagne dans la masse générale de ses entreprises ; car un homme prudent ne cherche de grands profits, que lorsqu'il est en état de soutenir de grandes pertes.
Le troisième risque est le plus frappant, et le moindre cependant, si les lois sont exécutées. Le crime est facîle sans doute ; mais le crédit est si favorable à l'industrie, que son premier soin est de le conserver.
Après la religion, le plus sur garand que les hommes puissent avoir dans leurs engagements respectifs, c'est l'intérêt. La rigueur des lois contient le petit nombre d'hommes perdus, qui voudraient sacrifier des espérances légitimes à un bénéfice présent, mais infâme.
Des différences qui se trouvent entre le crédit réel et le crédit personnel, on peut conclure qu'il est dans l'ordre :
1°. Que les sûretés réelles procurent un crédit plus facîle et moins couteux, mais borné le plus ordinairement à la proportion rigide de ces sûretés.
2°. Que les sûretés personnelles ne fassent pas un effet aussi prompt ; pouvant disparaitre à l'insu des prêteurs, ce risque doit être compensé par des conditions plus fortes : mais lorsque l'impression de ces sûretés est répandue dans les esprits, elles donnent un crédit infiniment plus étendu.
Si ces deux sortes de sûretés peuvent chacune en particulier former les motifs d'un crédit, il est évident que leur union dans un même sujet sera la base la plus solide du crédit.
Enfin moins ces sûretés se trouveront engagées, plus dans le cas d'un besoin l'opinion conçue de l'assurance du payement sera grande.
Tout citoyen qui jouit de la faculté d'emprunter fondée sur cette opinion, a un crédit qu'on peut appeler crédit particulier.
Le résultat de la masse de tous ces crédits particuliers, sera nommé le crédit général : l'application de la faculté dont nous venons de parler, à des compagnies exclusives bien entendues et à l'état, sera comprise sous le mot de crédit public.
Il est à propos d'examiner le crédit sous ses divers aspects, d'après les principes que nous avons posés, afin d'en tirer de nouvelles conséquences. Je supplie le lecteur d'en bien conserver l'ordre dans sa mémoire, parce qu'il est nécessaire pour l'intelligence de la matière.
Crédit général. Commençons par le crédit général.
On peut emprunter de deux manières : ou bien le capital prêté est aliéné en faveur du débiteur avec certaines formalités ; ou bien le capital n'est point aliéné, et le débiteur ne fournit d'autre titre de son emprunt qu'une simple reconnaissance.
Cette dernière manière de contracter une dette appelée chirographaire, est la plus usitée parmi ceux qui font profession de commerce ou de finance.
La nature et la commodité de ces sortes d'obligations, ont introduit l'usage de se les transporter mutuellement par un ordre, et de les faire circuler dans la société. Elles y sont une promesse authentique d'opérer la présence de l'argent dans un lieu et dans un temps convenus : ces promesses réparent son absence dans le commerce, et d'une manière si effective, qu'elles mettent les denrées en mouvement à des distances infinies.
Au terme limité ces promesses reviennent trouver l'argent qu'elles ont représenté : à mesure que ce terme approche, la circulation en est plus rapide ; l'argent s'est hâté de passer par un plus grand nombre de mains, et toujours en concurrence avec les denrées dont il est attiré, et qu'il attire réciproquement. Tant que le commerce répartira l'argent dans toutes les parties de l'état où il y a des denrées, en proportion de la masse générale, ces obligations seront fidélement acquittées : tant que rien n'éludera les effets de l'activité du commerce dans un état, cette répartition sera faite exactement. Ainsi l'effet des obligations circulantes dont nous parlons, est de répéter l'usage de la masse proportionnelle de l'argent dans toutes les parties d'un état : dès-lors elles ont encore l'avantage de n'être le signe des denrées, que dans la proportion de leur prix avec la masse actuelle de l'argent ; parce qu'elles paraissent et disparaissent alternativement du commerce, qu'elles indiquent même qu'elles n'y sont que pour un temps ; au lieu que les autres représentations d'espèce restent dans le public comme monnaie : leur abondance a l'effet même de l'abondance de la monnaie ; elle renchérit le prix des denrées sans avoir enrichi l'état. L'avantage des signes permanens n'est pas d'ailleurs intrinsequement plus grand pour la commodité du commerce, ni pour son étendue.
Car tout homme qui peut représenter l'argent dans la confiance publique, par son billet ou sa lettre de change, donne autant que s'il payait la même somme avec ces représentations monnaies. Il est donc à souhaiter que l'usage des signes momentanés de l'argent s'étende beaucoup, soit en lui accordant toute la faveur que les lois peuvent lui donner, soit peut-être en astreignant les négociants qui ne paient pas sur le champ avec l'argent, de donner leur billet ou une lettre de change. Dans les endroits où l'argent est moins abondant, cette petite gêne aurait besoin qu'on prolongeât les jours de grâce ; mais elle aurait des avantages infinis, en mettant les vendeurs en état de jouir du prix de la vente avant son terme.
L'accroissement des consommations est une suite évidente de la facilité de la circulation des denrées, comme celle-ci est inséparable de la circulation facîle de la masse d'argent qui a paru dans le commerce. Chaque membre de la société a donc un intérêt immédiat à favoriser autant qu'il est en lui le crédit des autres membres.
Le chef de cette société ou le prince, dont la force et la félicité dépend du nombre et de l'aisance des citoyens, multiplie l'une et l'autre par la protection qu'il accorde au crédit général.
La simplicité, la rigueur des lais, et la facilité d'obtenir des jugements sans frais, sont le premier moyen d'augmenter les motifs de la confiance publique.
Un second moyen, sans lequel même elle ne peut exister solidement, sera la sûreté entière des divers intérêts qui lient l'état avec les particuliers, comme sujets ou comme créanciers.
Après avoir ainsi assuré le crédit des particuliers dans ses circonstances générales : ceux qui gouvernent ne peuvent rien faire de plus utîle que de lui donner du mouvement et de l'action. Tous les expédiens propres à animer l'industrie, sont la seule méthode de remplir cette vue, puisque l'usage du crédit n'aura lieu que lorsque cet usage deviendra utile. Il sera nul absolument dans une province qui n'aura ni rivières navigables, ni canaux, ni grands chemins praticables ; où des formalités rigoureuses et de hauts droits détruiront les communications naturelles ; dont le peuple ne saura point mettre en œuvre les productions de ses terres ; ou bien dont l'industrie, privée de l'émulation qu'apporte la concurrence, sera encore refroidie par des sujétions ruineuses, par la crainte qu'inspirent les taxes arbitraires ; dans tout pays enfin dont il sortira annuellement plus d'argent, qu'il n'y en peut rentrer dans le même espace de temps.
Crédit public, première branche. Nous avons observé plus haut, que la faculté d'emprunter sur l'opinion conçue de l'assurance du payement, étant appliquée à des compagnies exclusives et à l'état, porte le nom de crédit public ; ce qui le divise naturellement en deux branches.
Les compagnies exclusives ne sont admises chez les peuples intelligens que pour certains commerces, qui exigent des vues et un système politique dont l'état ne veut pas faire la dépense ou prendre l'embarras ; et que la rivalité ou l'ambition des particuliers aurait peine à suivre. Le crédit de ces compagnies a les mêmes sources que celui des particuliers, il a besoin des mêmes secours ; mais le dépôt en est si considerable, il est tellement lié avec les opérations du gouvernement, que ses conséquences méritent une considération particulière, et lui assignent le rang du crédit public.
Le capital des compagnies exclusives dont nous parlons, se forme par petites portions, afin que tous les membres de l'état puissent y prendre commodément intérêt. La compagnie est représentée par ceux qui en dirigent les opérations, et les portions d'intérêt le sont par une reconnaissance transportable au gré du porteur.
Cette espèce de commerce emporte de grands risques, de grandes dépenses ; et quelque considérables que soient les capitaux, rarement les compagnies sont-elles en état de ne point faire usage de la puissance d'autrui.
Il en résulte deux sortes d'engagements de la compagnie avec le public : les uns sont les reconnaissances d'intérêt dans le capital ; les autres sont les reconnaissances des dettes contractées à raison des besoins. Ces deux sortes d'engagements, dont l'un est permanent et l'autre momentané, ont cours comme signes de l'argent.
Si la somme des dettes s'accrait à un point et avec des circonstances qui puissent donner quelque atteinte à la confiance, la valeur d'opinion de l'un et de l'autre effet sera moindre que la valeur qu'ils représentaient dans l'origine.
Il en naitra deux inconvéniens, l'un intérieur, l'autre extérieur.
Dans une pareille crise, les propriétaires de ces reconnaissances ne seront plus réellement aussi riches qu'ils l'étaient auparavant, puisqu'ils n'en retrouveraient pas le capital en argent. D'un autre côté le nombre de ces obligations aura été fort multiplié ; ainsi beaucoup de particuliers s'en trouveront porteurs : et comme il n'est pas possible de les distinguer, le discrédit de la compagnie entraînera une défiance générale entre tous les citoyens.
Le trouble même qu'apporte dans un état la perte d'une grande somme de crédit, est un sur garant des soins qu'un gouvernement sage prendra de le rétablir et de le soutenir. Ainsi les étrangers qui calculeront de sang-froid sur ces sortes d'événements, acheteront à bas prix les effets décriés, pour les revendre lorsque la confiance publique les aura rapprochés de leur valeur réelle. Si chez ces étrangers l'intérêt de l'argent est plus bas de moitié que dans l'état que nous supposons, ils pourront profiter des moindres mouvements dans ces obligations, lors même que les spéculateurs nationaux regarderont ces mouvements d'un oeil indifférent.
Le profit de cet agiotage des étrangers sera une diminution évidente du bénéfice de la balance du commerce, ou une augmentation sur sa perte. Ces deux inconvénients fournissent trois observations, dont j'ai déjà avancé une partie comme des principes ; mais leur importance en autorise la répétition.
1°. Tout ce qui tend à diminuer quelque espèce de sûreté dans un corps politique, détruit au moins pour un temps assez long le crédit général, et dès-lors la circulation des denrées, ou en d'autres termes la subsistance du peuple, les revenus publics et particuliers.
2°. Si une nation avait la sagesse d'envisager de sang-froid le déclin d'une grande somme de crédit, et de se prêter aux expédiens qui peuvent en arrêter la ruine totale, elle rendrait son malheur presque insensible. Alors si les opérations sont bonnes, ou si l'excès des choses n'interdit pas toute bonne opération, ce premier pas conduira par degrés au rétablissement de la portion de crédit qu'il sera possible de conserver.
3°. Le gouvernement qui veille aux sûretés intérieures et extérieures de la société, a un double motif de soutenir, soit par les lais, soit par des secours prompts et efficaces, les grands dépôts de la confiance publique. Plus l'intérêt de l'argent sera haut dans l'état, plus il est important de prévenir les inégalités dans la marche du crédit.
Crédit public, deuxième branche. Le crédit de l'état, ou la deuxième branche du crédit public, a en général les mêmes sources que celui des particuliers et des compagnies ; c'est-à-dire les sûretés réelles de l'état même, et les sûretés personnelles de la part de ceux qui gouvernent.
Mais ce serait se tromper grossièrement que d'évaluer les sûretés réelles sur le pied du capital général d'une nation, comme on le fait à l'égard des particuliers. Ces calculs poussés jusqu'à l'excès par quelques écrivains Anglais, ne sont propres qu'à repaitre des imaginations oisives, et peuvent introduire des principes vicieux dans une nation.
Les sûretés réelles d'une nation, sont la somme des tributs qu'elle peut lever sur le peuple, sans nuire à l'agriculture ni au commerce ; car autrement l'abus de l'impôt le détruirait, le désordre serait prochain.
Si les impôts sont suffisans pour payer les intérêts des obligations, pour satisfaire aux dépenses courantes, soit intérieures, soit extérieures ; pour amortir chaque année une partie considérable des dettes : enfin si la grandeur des tributs laisse encore entrevoir des ressources en cas qu'un nouveau besoin prévienne la libération totale, on peut dire que la sûreté réelle existe.
Pour en déterminer le degré précis, il faudrait connaître la nature des besoins qui peuvent survenir, leur éloignement ou leur proximité, leur durée probable ; ensuite les comparer dans toutes leurs circonstances avec les ressources probables que promettraient la liquidation commencée, le crédit général, et l'aisance de la nation.
Si la sûreté n'est pas claire aux yeux de tous, le crédit de l'état pourra se soutenir par habileté jusqu'au moment d'un grand besoin. Mais alors ce besoin ne sera point satisfait, ou ne le sera que par des ressources très-ruineuses. La confiance cessera à l'égard des anciens engagements ; elle cessera entre les particuliers d'après les principes établis ci-dessus. Le fruit de ce désordre sera une grande inaction dans la circulation des denrées : développons-en les effets.
Le capital en terres diminuera avec leur produit ; les malheurs communs ne réunissent que ceux dont les espérances sont communes : ainsi il est à présumer que les capitaux en argent et meubles précieux seront mis en dépôt dans d'autres pays, ou cachés soigneusement ; l'industrie effrayée et sans emploi ira porter son capital dans d'autres asiles. Que deviendront alors tous les systèmes fondés sur l'immensité d'un capital national ?
Les sûretés personnelles dans ceux qui gouvernent peuvent se réduire à l'exactitude ; car le degré d'utilité que l'état retire de son crédit, l'habileté, la prudence, et l'oeconomie des ministres, conduisent toutes à l'exactitude dans les petits objets comme dans les plus grands. Ce dernier point agit si puissamment sur l'opinion des hommes, qu'il peut dans de grandes occasions suppléer aux sûretés réelles, et que sans lui les sûretés réelles ne font pas leur effet. Telle est son importance, que l'on a Ve quelquefois des opérations contraires en elles-mêmes aux principes du crédit, suspendre sa chute totale lorsqu'elles étaient entreprises dans des vues d'exactitude. Je n'entens point cependant faire l'éloge de ces sortes d'opérations toujours dangereuses si elles ne sont décisives ; et qui, réservées à des temps de calamité, ne cessent d'être des fautes que dans le cas d'une impossibilité absolue de se les épargner ; c'est proprement abattre une partie d'un grand édifice, pour soustraire l'autre aux ravages des flammes : mais il faut une grande supériorité de vues pour se déterminer à de pareils sacrifices, et savoir maitriser l'opinion des hommes. Ces circonstances forcées sont une suite nécessaire de l'abus du crédit public.
Après avoir expliqué les motifs de la confiance publique envers l'état, et indiqué ses bornes naturelles, il est important de connaître l'effet des dettes publiques en elles-mêmes.
Indépendamment de la différence que nous avons remarquée dans la manière d'évaluer les sûretés réelles d'un état et des particuliers, il est encore entre ces crédits d'autres grandes différences.
Lorsque les particuliers contractent une dette, ils ont deux avantages : l'un de pouvoir borner leur dépense personnelle jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés ; le second, de pouvoir tirer de l'emprunt une utilité plus grande que l'intérêt qu'ils sont obligés de payer.
Un état augmente sa dépense annuelle en contractant des dettes, sans être le maître de diminuer les dépenses nécessaires à son maintien ; parce qu'il est toujours dans une position forcée relativement à sa sûreté extérieure. Il n'emprunte jamais que pour dépenser ; ainsi l'utilité qu'il retire de ses engagements, ne peut accroitre les sûretés qu'il offre à ses créanciers : au moins ces occasions sont très-rares, et ne peuvent être comprises dans ce qu'on appelle dettes publiques. On ne doit point confondre non plus avec elles, ces emprunts momentanés qui sont faits dans le dessein de prolonger le terme des recouvrements, et de les faciliter : ces sortes d'oeconomies rentrent dans la classe des sûretés personnelles ; elles augmentent les motifs de la confiance publique. Mais observons en passant que jamais ces opérations ne sont si promptes, si peu couteuses, et n'ont moins besoin de crédits intermédiaires, que lorsqu'on voit les revenus se libérer.
C'est donc uniquement des aliénations dont il s'agit ici.
Dans ce cas, un corps politique ne pouvant faire qu'un usage onéreux de son crédit, tandis que celui des particuliers leur est utîle en général, il est facîle d'établir entr'eux une nouvelle différence. Elle consiste en ce que l'usage que l'état fait de son crédit peut nuire à celui des sujets ; au lieu que jamais le crédit multiplié des sujets ne peut qu'être utîle à celui de l'état.
L'usage que l'état fait de son crédit, peut porter préjudice aux sujets de plusieurs manières.
1°. Par la pesanteur des charges qu'il accumule ou qu'il perpétue ; d'où il est évident de conclure que toute aliénation des revenus publics est plus onéreuse au peuple, qu'une augmentation d'impôt qui serait passagère.
2°. Il s'établit à la faveur des emprunts publics, des moyens de subsister sans travail, et réellement aux dépens des autres citoyens. Dès-lors la culture des terres est négligée ; les fonds sortent du commerce ; il tombe à la fin, et avec lui s'évanouissent les manufactures, la navigation, l'agriculture, la facilité du recouvrement des revenus publics, enfin imperceptiblement les revenus publics mêmes. Si cependant par des circonstances locales, ou par un certain nombre de facilités singulières, on suspend le déclin du commerce, le désordre sera lent, mais il se fera sentir par degrés.
3°. De ce qu'il y a moins de commerce et de plus grands besoins dans l'état, il s'ensuit que le nombre des emprunteurs est plus grand que celui des prêteurs. Dès-lors l'intérêt de l'argent se soutient plus haut que son abondance ne le comporte ; et cet inconvénient devient un nouvel obstacle à l'accroissement du commerce et de l'agriculture.
4°. Le gros intérêt de l'argent invite les étrangers à faire passer le leur pour devenir créanciers de l'état. Je ne m'étendrai pas sur le préjugé puérîle qui regarde l'arrivée de cet argent comme un avantage : j'en ai parlé assez au long en traitant de la circulation de l'argent. Les rivaux d'un peuple n'ont pas de moyen plus certain de ruiner son commerce en s'enrichissant, que de prendre intérêt dans ses dettes publiques.
5°. Les dettes publiques emportent avec elles des moyens ou impôts extraordinaires, qui procurent des fortunes immenses, rapides, et à l'abri de tout risque. Les autres manières de gagner sont lentes au contraire et incertaines : ainsi l'argent et les hommes abandonneront les autres professions. La circulation des denrées à l'usage du plus grand nombre est interrompue par cette disproportion, et n'est point remplacée par l'accroissement du luxe de quelques citoyens.
6°. Si ces dettes publiques deviennent monnaie, c'est un abus volontaire ajouté à un abus de nécessité. L'effet de ces représentations multipliées de l'espèce, sera le même que celui d'un accroissement dans sa masse : les denrées seront représentées par une plus grande quantité de métaux, ce qui en diminuera la vente au dehors. Dans des accès de confiance, et avant que le secret de ces représentations fût connu, on en a Ve l'usage animer tellement le crédit général, que les réductions d'intérêt s'opéraient naturellement : ces réductions réparaient en partie l'inconvénient du surhaussement des prix relativement aux autres peuples qui payaient les intérêts plus cher. Il serait peu sage de l'espérer aujourd'hui, et toute réduction forcée est contraire aux principes du crédit public.
On ne saurait trop le répéter, la grande masse des métaux est en elle-même indifférente dans un état considéré séparément des autres états ; c'est la circulation, soit intérieure, soit extérieure, des denrées qui fait le bonheur du peuple : et cette circulation a besoin pour sa commodité d'une répartition proportionnelle de la masse générale de l'argent dans toutes les provinces qui fournissent des denrées.
Si les papiers circulants, regardés comme monnaie, sont répandus dans un état, où quelque vice intérieur repartisse les richesses dans une grande inégalité, le peuple n'en sera pas plus à son aise malgré cette grande multiplicité des signes : au contraire les denrées seront plus chères, et le travail pour les étrangers moins commun. Si l'on continue d'ajouter à cette masse des signes, on aura par intervalle une circulation forcée qui empêchera les intérêts d'augmenter : car il est au moins probable que si les métaux mêmes, ou les représentations des métaux n'augmentaient point dans un état où leur répartition est inégale, les intérêts de l'argent remonteraient dans les endroits où la circulation serait plus rare.
Si l'on a Ve des réductions d'intérêts dans des états où les papiers-monnaie se multipliaient sans-cesse, on n'en doit rien conclure contre ces principes, parce qu'alors ces réductions n'étaient pas tout à fait volontaires ; elles ne peuvent être regardées que comme l'effet de la réflexion des propriétaires sur l'impuissance nationale. Ceux qui voudront voir l'application de ces raisonnements à des faits, peuvent recourir au discours préliminaire qui se trouve à la tête du Négociant Anglais.
Les banques sont du ressort de la matière du crédit : nous ne les avons point rangées dans la classe des compagnies de commerce, parce qu'elles ne méritent pas proprement ce nom, n'étant destinées qu'à escompter les obligations des commerçans, et à donner des facilités à leur crédit.
L'objet de ces établissements indique assez leur utilité dans tout pays où la circulation des denrées est interrompue par l'absence du crédit, et si nous les séparons des inconvénients qui s'y sont presque toujours introduits.
Une banque dans sa première institution est un dépôt ouvert à toutes les valeurs mercantiles d'un pays. Les reconnaissances du dépôt de ces valeurs, les représentent dans le public, et se transportent d'un particulier à un autre. Son effet est de doubler dans le commerce les valeurs déposées. Nous venons d'expliquer son objet.
Comme les hommes ne donnent jamais tellement leur confiance qu'ils n'y mettent quelque restriction, on a exigé que les banques eussent toujours en caisse un capital numéraire. Les portions de ce capital sont représentées par des reconnaissances appelées actions, qui circulent dans le public.
Le profit des intéressés est sensible : quand même la vaine formalité d'un dépôt aisif serait exécutée à la rigueur, la banque a un autre genre de bénéfice bien plus étendu. A mesure qu'il se présente des gages, ou du papier solide de la part des négociants ; elle en avance la valeur dans ses billets, à une petite portion près qu'elle se réserve pour l'intérêt. Ces billets représentent réellement la valeur indiquée dans le public ; et n'ayant point de terme limité, ils deviennent une monnaie véritable que l'on peut resserrer ou remettre dans le commerce à sa volonté. A mesure que la confiance s'anime, les particuliers déposent leur argent à la caisse de la banque, qui lui donnent en échange ses reconnaissances d'un transport plus commode ; tandis qu'elle rend elle-même ces valeurs au commerce, soit en les prêtant, soit en remboursant ses billets. Tout est dans l'ordre ; la sûreté réelle ne peut être plus entière, puisqu'il n'y a pas une seule obligation de la banque qui ne soit balancée par un gage certain. Lorsqu'elle vend les marchandises sur lesquelles elle a prêté, ou que les échéances des lettres de change escomptées arrivent, elle reçoit en payement, ou ses propres billets, qui dès-lors sont soldés jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le commerce, ou de l'argent qui en répond lorsque le payement sera exigé, et ainsi de suite.
Lorsque la confiance générale est éteinte, et que par le resserrement de l'argent les denrées manquent de leurs signes ordinaires, une banque porte la vie dans tous les membres d'un corps politique : la raison en est facîle à concevoir.
Le discrédit général est une situation violente dont chaque citoyen cherche à se tirer. Dans ces circonstances la banque offre un crédit nouveau, une sûreté réelle toujours existante, des opérations simples, lucratives, et connues. La confiance qu'elle inspire, celle qu'elle prête elle-même, dissipent en un instant les craintes et les soupçons entre les citoyens.
Les signes des denrées sortent de la prison où la défiance les renfermait, et rentrent dans le commerce en concurrence avec les denrées : la circulation se rapproche de l'ordre naturel.
La banque apporte dans le commerce le double des valeurs qu'elle a mise en mouvement : ces nouveaux signes ont l'effet de toute augmentation actuelle dans la masse de l'argent, c'est-à-dire que l'industrie s'anime pour les attirer. Chacune de ces deux valeurs donne du mouvement à l'industrie, contribue à donner un plus haut prix aux productions, soit de l'art, soit de la nature ; mais avec des différences essentielles.
Le renouvellement de la circulation de l'ancienne masse d'argent, rend aux denrées la valeur intrinseque qu'elles auraient dû avoir relativement à cette masse, et relativement à la consommation que les étrangers peuvent en faire.
Si d'un côté la multiplication de cette ancienne masse, par les représentations de la banque, était en partie nécessaire pour la faire sortir, on conçoit d'ailleurs qu'en la doublant on hausse le prix des denrées à un point excessif en peu de temps. Ce surhaussement sera en raison de l'accroissement des signes qui circuleront dans le commerce, au-delà de l'accroissement des denrées.
Si les signes circulants sont doublés, et que la quantité des denrées n'ait augmenté que de moitié, les prix hausseront d'un quart.
Pour évaluer quel devrait être dans un pays le degré de la multiplication des denrées, en raison de celle des signes, il faudrait connaître l'étendue des terres, leur fertilité, la manière dont elles sont cultivées, les améliorations dont elles sont susceptibles, la population, la quantité d'hommes occupés, de ceux qui manquent de travail, l'industrie et les manières générales des habitants, les facilités naturelles, artificielles et politiques pour la circulation intérieure et extérieure ; le prix des denrées étrangères qui sont en concurrence ; le goût et les moyens des consommateurs. Ce calcul serait si compliqué, qu'il peut passer pour impossible ; mais plus l'augmentation subite des signes sera excessive, moins il est probable que les denrées se multiplieront dans une proportion raisonnable avec eux.
Si le prix des denrées hausse, il est également vrai de dire que par l'excès de la multiplication des signes sur la multiplication des denrées, et l'activité de la nouvelle circulation, il se rencontre alors moins d'emprunteurs que de prêteurs ; l'argent perd de son prix.
Cette baisse par conséquent sera en raison composée du nombre des prêteurs et des emprunteurs.
Elle soulage les denrées d'une partie des frais que font les négociants pour les revendre. Ces frais diminués sont l'interêt des avances des négociants, l'évaluation des risques qu'ils courent, le prix de leur travail : les deux derniers sont toujours réglés sur le taux du premier, et on les estime communément au double. De ces trois premières diminutions résultent encore le meilleur marché de la navigation, et une moindre évaluation des risques de la mer.
Quoique ces épargnes soient considérables, elles ne diminuent point intrinsequement la valeur première des denrées nationales, il est évident qu'elles ne la diminuent que relativement aux autres peuples qui vendent les mêmes denrées en concurrence, soutiennent l'interêt de leur argent plus cher en raison de la masse qu'ils possèdent. Si ces peuples venaient à baisser les intérêts chez eux dans la même proportion, ce serait la valeur première des denrées qui déciderait de la supériorité, toutes choses égales d'ailleurs.
Quoique j'aye rapproché autant qu'il a dépendu de moi les conséquences de leurs principes, il n'est point inutîle d'en retracer l'ordre en peu de mots.
Nous avons Ve la banque ranimer la circulation des denrées, et rétablir le crédit général par la multiplication actuelle des signes : d'où résultait une double cause d'augmentation dans le prix de toutes choses, l'une naturelle et salutaire, l'autre forcée et dangereuse. L'inconvénient de cette dernière se corrige en partie relativement à la concurrence des autres peuples par la diminution des intérêts.
De ces divers raisonnements on peut donc conclure, que par-tout où la circulation et le crédit jouissent d'une certaine activité, les banques sont inutiles, et même dangereuses. Nous avons remarqué en parlant de la circulation de l'argent, que ces principes sont nécessairement ceux du crédit même, qui n'en est que l'image : la même méthode les conserve et les anime. Elle consiste, 1°. dans les bonnes lois bien exécutées contre l'abus de la confiance d'autrui. 2°. Dans la sûreté des divers intérêts qui lient l'état avec les particuliers comme sujets ou comme créanciers. 3°. A employer tous les moyens naturels, artificiels et politiques, qui peuvent favoriser l'industrie et le commerce étranger ; ce qui emporte avec soi une finance subordonnée au commerce. J'ai souvent insisté sur cette dernière maxime, parce que sans elle tous les efforts en faveur du commerce seront vains. J'en ai précédemment traité dans un ouvrage particulier, auquel j'ose renvoyer ceux qui se sentent le courage de développer des germes abandonnés à la sagacité du lecteur.
Si quelqu'une de ces règles est négligée, nulle banque, nulle puissance humaine n'établira parmi les hommes une confiance parfaite et réciproque dans leurs engagements : elle dépend de l'opinion, c'est-à-dire de la persuasion ou de la conviction.
Si ces règles sont suivies dans toute leur étendue, le crédit général s'établira surement.
L'augmentation des prix au renouvellement du crédit, ne sera qu'en proportion de la masse actuelle de l'argent, et de la consommation des étrangers. L'augmentation des prix par l'introduction continuelle d'une nouvelle quantité de métaux, et la concurrence des négociants, par l'extension du commerce, conduiront à la diminution des bénéfices : cette diminution des bénéfices et l'accroissement de l'aisance générale feront baisser les intérêts comme dans l'hypothèse d'une banque : mais la réduction des intérêts sera bien plus avantageuse dans le cas présent que dans l'autre, en ce que la valeur première des denrées ne sera pas également augmentée.
Pour concevoir cette différence, il faut se rappeler trois principes déjà répétés plusieurs fois surtout en parlant de la circulation de l'argent.
L'aisance du peuple dépend de l'activité de la circulation des denrées : cette circulation est active en raison de la répartition proportionnelle de la masse quelconque des métaux ou des signes, et non en raison de la répartition proportionnelle d'une grande masse de métaux ou de signes : la diminution des intérêts est toujours en raison composée du nombre des prêteurs et des emprunteurs.
Ainsi à égalité de répartition proportionnelle d'une masse inégale de signes, l'aisance du peuple sera relativement la même ; il y aura relativement même proportion entre le nombre des emprunteurs et des prêteurs, l'intérêt de l'argent sera le même.
Cependant la valeur première des denrées sera en raison de l'inégalité réciproque de la masse des signes.
Malgré les inconvénients d'une banque, si l'état se trouve dans ces moments terribles, et qui ne doivent jamais être oubliés, d'une crise qui ne lui permet aucune action ; il parait évident que cet établissement est la ressource la plus prompte et la plus efficace, si on lui prescrit des bornes. Leur mesure sera la portion d'activité nécessaire à l'état pour rétablir la confiance publique par degrés : et il semble que des caisses d'escompte rendraient les mêmes services d'une manière irréprochable. Une banque peut encore être utîle dans de petits pays, qui ont plus de besoins que de superflu, ou qui possèdent des denrées uniques.
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des banques solides, c'est-à-dire dont toutes les obligations sont balancées par un gage mercantil. Les états qui les ont regardées comme une facilité de dépenser, n'ont joui de leur prospérité que jusqu'au moment où leur crédit a été attaqué dans son principe. Dans tous les temps et dans tous les pays, la ruine d'un pareil crédit entraînera pour longtemps celle du corps politique : mais avant que le jour en soit arrivé, il en aura toujours résulté un ravage intérieur, comme nous l'avons expliqué plus haut en parlant des dettes publiques. Art. de M. D. Voyez F. Voyez les Elements du Commerce du même auteur.
* CREDIT, (Morale) La définition du crédit, que M. Duclos a donnée dans ses considérations sur les mœurs, étant générale, l'auteur de l'article précédent n'a eu besoin que de la restraindre pour l'appliquer au commerce. Le crédit d'un homme auprès d'un autre, ajoute M. Duclos, marque quelque infériorité dans le premier. On ne dit point le crédit d'un souverain, à moins qu'on ne le considère relativement à d'autres souverains dont la réunion forme à son égard de la supériorité. Un prince aura d'autant moins de crédit parmi les autres, qu'il sera plus puissant et moins équitable ; mais l'équité peut contrebalancer la puissance, et je ne suis pas éloigné de croire que cette vertu ne soit par conséquent aussi essentielle à un souverain, surtout s'il est puissant, parmi les autres souverains, qu'à un commerçant dans la société. Rien ne ferait plus d'honneur à un grand, que le crédit qu'il accorderait à un honnête-homme, parce que le crédit étant une relation fondée ou sur l'estime ou sur l'inclination, ces sentiments marqueraient de la conformité soit dans l'esprit soit dans le cœur. Voyez le chapitre du crédit dans l'ouvrage que nous citons ; si vous êtes un grand, vous y apprendrez à bien choisir ceux à qui vous pourrez accorder du crédit ; si vous êtes un subalterne en faveur, vous y apprendrez à faire un usage convenable du crédit que vous avez.
CREDIT, (Jurisprudence) signifie en général tout ce qui est confié à autrui.
Faire crédit, vendre à crédit, c'est donner quelque chose et accorder terme pour le payement, soit que ce terme soit fixé ou indéfini.
En matière de Commerce, le terme de credit est opposé à celui de débit, le crédit est ce qui est dû au marchand, le débit est ce qu'il doit de sa part, il distingue l'un et l'autre sur le grand livre de raison ; qui contient autant de comptes particuliers que le marchand a de débiteurs. On fait un article pour chacun ; le crédit du marchand est marqué au verso d'un feuillet du grand livre, et le débit de ce même marchand, à l'égard de son créancier, est marqué sur le recto du feuillet suivant, de sorte que l'on peut voir d'un coup d'oeil le crédit marqué à gauche et le débit à droite.
Donner crédit sur soi, c'est se reconnaître débiteur envers quelqu'un. Quand le Roi crée des rentes sur ses revenus il donne crédit au prevôt des marchands. et échevins de Paris sur lui, pour aliéner de ses rentes au profit des acquéreurs jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Le clergé et les états des provinces accordent aussi quelquefois credit sur eux au Roi, comme on voit dans l'arrêt du conseil et lettres patentes du 15 Décembre 1746, qui autorisent le traité fait entre les commissaires du Roi et ceux des états de Languedoc, le 1 Décembre 1746, au sujet du crédit que cette province avait accordé sur soi à S. M. pour six millions.
Prêter son crédit, signifie prêter son nom et fournir son obligation pour emprunter des deniers qui doivent tourner au profit d'une autre personne ; on en voit un exemple dans un arrêt du conseil du 25 Aout 1733, concernant un emprunt de deux millions, pour lequel la province de Languedoc avait prêté son crédit à S. M.
Lettre de crédit, est une lettre missive, qu'un marchand négociant ou banquier adresse à un de ses correspondants établi dans une autre ville, et par laquelle il lui mande de fournir à un tiers porteur de cette lettre une certaine somme d'argent, ou bien indéfiniment tout ce dont il aura besoin.
Ceux qui ont reçu de l'argent en vertu de ces sortes de lettres, sont contraignables au payement de même que si c'étaient des lettres de change.
Il est facîle d'abuser de ces lettres, quand l'ordre de fournir de l'argent est indéfini, ou quand il est au porteur ; car la lettre peut être volée : on doit donc prendre des précautions pour limiter le crédit que l'on donne, et pour que le correspondant paye surement, en lui désignant la personne de façon qu'il ne puisse être trompé.
CREDIT, (drait de) La plupart des seigneurs avaient ce droit dans leurs terres, qui consistait en ce qu'ils pouvaient prendre chez eux des vivres et autres denrées à crédit, c'est-à-dire sans être obligés de les payer sur le champ, mais seulement après un certain temps marqué : ils étaient quelquefois obligés de donner des gages pour la sûreté du payement.
Il est parlé de ce droit de crédit dans plusieurs anciennes chartres, entr'autres dans celle que Philippe Auguste accorda en 1209 pour l'établissement de la commune de Compiègne. Il ordonne que les habitants feront crédit à l'abbé pendant trois mois, de pain, chair et poisson ; que s'il ne paye pas au bout de ce terme, on ne sera pas obligé de lui rien donner qu'il n'ait payé.
Robert comte de Dreux et de Montfort, seigneur de Saint-Valery, ordonna par des lettres de l'an 1219, que toutes les fois qu'il séjournerait à Dieppe, on serait tenu de lui faire crédit pendant quinze jours, de 10 liv. de monnaie usuelle.
A Boiscommun et dans plusieurs autres endroits, le Roi avait crédit pendant quinze jours pour les vivres qu'il achetait des habitants ; et celui auquel il avait donné des gages pour sa sûreté, et en général quiconque avait reçu des gages de quelqu'un, pouvait, en cas qu'il ne fût pas payé, les vendre huit jours après l'échéance du payement, comme il parait par des lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1351.
Plusieurs seigneurs particuliers avaient droit de crédit pendant le même temps, tels que le comte d'Anjou, le seigneur de Mailli-le-château et sa femme, et le seigneur d'Ervy.
Ce qui est de singulier, c'est que dans quelques endroits, de simples seigneurs avaient pour leur crédit, un terme plus long que le Roi ne l'avait à Boiscommun et autres lieux du même usage.
Par exemple, à Beauvoir le Dauphin avait crédit pendant un mois pour les denrées qu'il achetait pour la provision de son hôtel ; mais il était obligé de donner au vendeur un gage qui valut un tiers plus que la chose vendue.
Quelques seigneurs avaient encore un terme plus long.
Les seigneurs de Nevers avaient droit de prendre dans cette ville des vivres à crédit, sans être obligés de les payer pendant quarante jours, passé lesquels, s'ils ne les payaient pas, on n'était plus obligé de leur en fournir à credit, jusqu'à ce qu'ils eussent payé les anciens. Il en est parlé dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Février 1356.
La même chose s'observait pour les comtes d'Auxerre : on trouve seulement cela de particulier pour eux, que s'ils étaient un an sans payer, celui qui leur avait fourni des vivres, en recevait le prix sur le produit du cens.
Le seigneur d'Aussonne en Bourgogne ne pouvait rien prendre à crédit dans les jardins potagers de la ville, à moins qu'il ne donnât des gages. Lorsqu'il prenait à crédit des denrées chez les gens qui les avaient achetées pour les revendre, il devait aussi donner des gages ; et si après quarante jours il ne payait pas ce qu'il avait pris, le marchand qui avait reçu les gages, pouvait les vendre, comme il parait par des lettres du roi Jean, du mois de Janvier 1361.
Il y avait, comme on voit, une différence entre les denrées provenant du cru de celui chez qui on les avait prises à crédit, et celles qu'il avait achetées pour les revendre. Le terme que le seigneur avait pour payer les premières, n'était pas marqué, et il n'était pas dit que faute de payement le vendeur pourrait vendre les gages ; au lieu que pour les denrées qui n'étaient pas de son cru, si on ne les payait pas dans le terme de quarante jours, il pouvait vendre les gages. Cette différence était fondée sur ce que celui qui vend des denrées de son cru, n'ayant rien déboursé, peut attendre plus longtemps son payement ; au lieu que celui qui a acheté des denrées pour les revendre, ayant déboursé de l'argent, il est juste qu'il soit payé dans un temps préfix, et que faute de payement il puisse faire vendre les gages.
Le seigneur de Chagny avait crédit, comme les précédents, pendant quarante jours, passé lesquels, s'il n'avait pas payé, on n'était pas obligé, jusqu'à ce qu'il l'eut fait, de lui donner autre chose à crédit. Si quelqu'un cachait sa marchandise, de peur d'être obligé de la donner à crédit au seigneur, on le condamnait à l'amende ; ce qui ferait penser que le crédit du seigneur était apparemment déjà bien usé. Si les officiers du seigneur niaient qu'on leur eut fait crédit, celui qui prétendait l'avoir fait, était reçu à le prouver par témoins, et les officiers étaient admis à faire la preuve contraire : mais les officiers du seigneur ne pouvaient acheter des vivres des habitants, qu'ils n'en donnassent le prix courant et ordinaire, et ne les payassent sur le champ.
A Dommart (diocèse d'Amiens) le seigneur pouvait prendre du vin chez un bourgeois pour le prix qu'il revenait à celui-ci, et ce seigneur n'était obligé de le payer que lorsqu'il sortait de la ville ; s'il ne le payait pas alors, il était obligé de le payer au prix que le vin se vendait dans le marché, et il avait crédit de quinze jours. S'il achetait une pièce de vin il n'en payait que le prix qu'elle avait couté au bourgeois, mais il fallait qu'il payât sur le champ. Lorsqu'il n'avait point d'avoine, il pouvait faire contraindre, par le maïeur, les bourgeois à lui en vendre au prix courant, et il avait crédit de quinze jours, en donnant caution, s'il ne payait pas à ce terme, il n'avait plus de crédit, jusqu'à ce qu'il eut satisfait au premier achat.
A Poiz en Picardie, les bourgeois qui vendaient des denrées étaient obligés une fois en leur vie d'en fournir à crédit au seigneur, lorsqu'il le demandait, sans qu'il fût tenu de leur donner des gages ; mais cette charge une fois acquittée par les bourgeois, il ne pouvait plus prendre des denrées sans gages, et dans ces deux cas il ne pouvait se servir du droit de crédit sur les denrées qui excédaient la valeur de cinq sols, à moins que le vendeur n'y consentit.
L'archevêque de Vienne avait moins de crédit que les autres seigneurs ; car il ne pouvait rien acheter qui ne fût en vente, et qu'il n'en payât le prix qu'un autre en donnerait.
Dans les lieux où le seigneur n'avait point ce droit de crédit, il y avait des règlements pour qu'il ne put obliger les habitants de lui porter des denrées, qu'il ne put les prendre si elles n'étaient exposées en vente ; que s'il était obligé d'en user autrement, ce ne serait que par les mains des consuls, et en payant le prix suivant l'estimation.
Tous ces usages singuliers, quoique différents les uns des autres, prouvent également la trop grande autorité que les seigneurs particuliers s'étaient arrogée sur leurs sujets ; et présentement que le royaume est mieux policé, aucun seigneur ni autre personne ne peut rien prendre à crédit que du consentement du vendeur. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tomes IV. Voyez VI. VII. et VIII, à la table, au mot Crédit.
Crédit vel non : on appelait réponses par crédit vel non, celles où le témoin se contentait de répondre qu'il croyait qu'un fait était tel, sans dire affirmativement si le fait était vrai ou non. Ces sortes de réponses ont été abrogées par l'ordonnance de 1539, art. xxxvj. (A)
Articles populaires Morale
LODS et VENTES
(Jurisprudence) sont le droit que l'on paye au seigneur féodal ou censier pour la vente qui est faite d'un héritage mouvant de lui, soit en fief ou en censive.Dans les pays de droit écrit, les droits que le contrat de vente occasionne, sont appelés lods, tant pour les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la vente des fiefs en produit ; il en est de même dans la coutume d'Anjou, on y appelle lods les droits de transaction dû., tant pour le fief que pour les rotures.
Dans la plupart des autres coutumes, les lods et ventes ne sont dû. que pour les rotures, et non pour les fiefs.
Lire la suite...