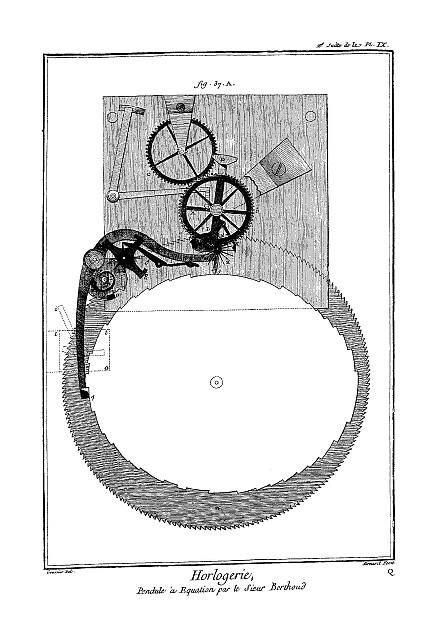S. f. (Histoire naturelle de l'homme) destruction des organes vitaux, en sorte qu'ils ne puissent plus se rétablir.
La naissance n'est qu'un pas à cette destruction :
Et le premier instant où les enfants des rois
Ouvrent les yeux à la lumière,
Est celui qui vient quelquefois
Fermer pour toujours leur paupière.
Dans le moment de la formation du foetus, cette vie corporelle n'est encore rien ou presque rien, comme le remarque un des beaux génies de l'académie des sciences. Peu-à-peu cette vie s'augmente et s'étend ; elle acquiert de la consistance, à mesure que le corps croit, se développe et se fortifie ; des qu'il commence à dépérir, la quantité de vie diminue ; enfin lorsqu'il se courbe, se desseche et s'affaisse, la vie décroit, se resserre, se réduit presque à rien. Nous commençons de vivre par degrés, et nous finissons de mourir, comme nous commençons de vivre. Toutes les causes de dépérissement agissent continuellement sur notre être matériel, et le conduisent peu-à-peu à sa dissolution. La mort, ce changement d'état si marqué, si redouté, n'est dans la nature que la dernière nuance d'un être précédent ; la succession nécessaire du dépérissement de notre corps, amène ce degré comme tous les autres qui ont précédé. La vie commence à s'éteindre, longtemps avant qu'elle s'éteigne entièrement ; et dans le réel, il y a peut-être plus loin de la caducité à la jeunesse, que de la décrépitude à la mort ; car on ne doit pas ici considérer la vie comme une chose absolue, mais comme une quantité susceptible d'augmentation, de diminution, et finalement de destruction nécessaire.
La pensée de cette destruction est une lumière semblable à celle qu'au milieu de la nuit répand un embrasement sur des objets qu'il Ve bientôt consumer. Il faut nous accoutumer à envisager cette lumière, puisqu'elle n'annonce rien qui ne soit préparé par tout ce qui la précède ; et puisque la mort est aussi naturelle que la vie, pourquoi donc la craindre si fort ? Ce n'est pas aux mécans, ni aux scélérats que je parle ; je ne connais point de remède pour calmer les tourments affreux de leur conscience. Le plus sage des hommes avait raison de dire que si l'on ouvrait l'âme des tyrants, on la trouverait percée de blessures profondes, et déchirée par la noirceur et la cruauté, comme par autant de plaies mortelles. Ni les plaisirs, ni la grandeur, ni la solitude, ne purent garantir Tibere des tourments horribles qu'il endurait. Mais je voudrais armer les honnêtes gens contre les chimères de douleurs et d'angoisses de ce dernier période de la vie : préjugé général si bien combattu par l'auteur éloquent et profond de l'histoire naturelle de l'homme.
La vraie philosophie, dit-il, est de voir les choses telles qu'elles sont ; le sentiment intérieur serait d'accord avec cette philosophie, s'il n'était perverti par les illusions de notre imagination, et par l'habitude malheureuse que nous avons prise de nous forger des fantômes de douleur et de plaisir. Il n'y a rien de charmant et de terrible que de loin ; mais pour s'en assurer, il faut avoir la sagesse et le courage de considérer l'un et l'autre de près. Qu'on interroge les médecins des villes, et les ministres de l'église, accoutumés à observer les actions des mourants, et à recueillir leurs derniers sentiments, ils conviendront qu'à l'exception d'un petit nombre de maladies aiguës, où l'agitation causée par des mouvements convulsifs, parait indiquer les souffrances du malade, dans toutes les autres on meurt doucement et sans douleur ; et même ces terribles agonies effraient plus les spectateurs, qu'elles ne tourmentent le malade ; car combien n'en a-t-on pas vus, qui, après avoir été à cette dernière extrémité, n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé, non plus que de ce qu'ils avaient senti : ils avaient réellement cessé d'être pour eux pendant ce temps, puisqu'ils sont obligés de rayer du nombre de leurs jours tous ceux qu'ils ont passé dans cet état, duquel il ne leur reste aucune idée.
Il semble que ce serait dans les camps que les douleurs affreuses de la mort devraient exister ; cependant ceux qui ont Ve mourir des milliers de soldats dans les hôpitaux d'armées, rapportent que leur vie s'éteint si tranquillement, qu'on dirait que la mort ne fait que passer à leur cou un nœud coulant, qui serre moins, qu'il n'agit avec une douceur narcotique. Les morts douloureuses sont donc très-rares, et presque toutes les autres sont insensibles.
Quand la faux de la parque est levée pour trancher nos jours, on ne la voit point, on n'en sent point le coup ; la faux, ai-je-dit ? chimère poétique ! La mort n'est point armée d'un instrument tranchant, rien de violent ne l'accompagne, on finit de vivre par des nuances imperceptibles. L'épuisement des forces anéantit le sentiment, et n'excite en nous qu'une sensation vague, que l'on éprouve en se laissant aller à une rêverie déterminée. Cet état nous effraye de loin parce que nous y pensons avec vivacité ; mais quand il se prépare, nous sommes affoiblis par les gradations qui nous y conduisent, et le moment décisif arrive sans qu'on s'en doute et sans qu'on y réfléchisse. Voilà comme meurent la plupart des humains ; et dans le petit nombre de ceux qui conservent la connaissance jusqu'au dernier soupir ; il ne s'en trouve peut-être pas un qui ne conserve en même-temps de l'espérance, et qui ne se flatte d'un retour vers la vie. La nature a, pour le bonheur de l'homme, rendu ce sentiment plus fort que la raison ; et si l'on ne réveillait pas ses frayeurs par ces tristes soins et cet appareil lugubre, qui dans la société dévancent la mort, on ne la verrait point arriver. Pourquoi les enfants d'Esculape ne cherchent-ils pas des moyens de laisser mourir paisiblement ? Epicure et Antonin avaient bien su trouver ces moyens : mais nos médecins ne ressemblent que trop à nos juges qui, après avoir prononcé un arrêt de mort, livrent la victime à sa douleur, aux prêtres, et aux lamentations d'une famille. En faut-il davantage pour anticiper l'agonie ?
Un homme qui serait séquestré de bonne heure du commerce des autres hommes, n'ayant point de moyens de s'éclairer sur son origine, croirait non seulement n'être pas né, mais même ne jamais finir. Le sourd de Chartres qui voyait mourir ses semblables, ne savait pas ce que c'était que la mort. Un sauvage qui ne verrait mourir personne de son espèce, se croirait immortel. On ne craint donc si fort la mort, que par habitude, par éducation, par préjugé.
Mais les grandes alarmes règnent principalement chez les personnes élevées mollement dans le sein des villes, et devenues par leur éducation plus sensibles que les autres ; car le commun des hommes, surtout ceux de la campagne, voient la mort sans effroi ; c'est la fin des chagrins et des calamités des misérables. La mort, disait Caton, ne peut jamais être prématurée pour un consulaire, fâcheuse ou déshonorante pour un homme vertueux, et malheureuse pour un homme sage.
Rien de violent ne l'accompagne dans la vieillesse ; les sens sont hébétés, et les vaisseaux se sont effacés, collés, ossifiés les uns après les autres ; alors la vie cesse peu-à-peu ; on se sent mourir comme on se sent dormir : on tombe en faiblesse. Auguste nommait cette mort euthanasie, expression qui fit fortune à Rome, et dont tous les auteurs se servirent depuis dans leurs ouvrages.
Il semble qu'on paye un plus grand tribut de douleur quand on vient au monde, que quand on en sort : là l'enfant pleure, ici le vieillard soupire. Du moins est-il vrai qu'on sort de ce monde comme on y vient, sans le savoir. La mort et l'amour se consomment par les mêmes voies, par l'expiration. On se reproduit quand c'est d'amour qu'on meurt ; on s'anéantit, (je parle toujours du corps, et qu'on ne vienne pas m'accuser de matérialisme) quand c'est par le ciseau d'Atropos. Remercions la nature, qui ayant consacré les plaisirs les plus vifs à la production de notre espèce : émousse presque toujours la sensation de la douleur, dans ces moments où elle ne peut plus nous conserver la vie.
La mort n'est donc pas une chose aussi formidable que nous nous l'imaginons. Nous la jugeons mal de loin, c'est un spectre qui nous épouvante à une certaine distance, et qui disparait lorsqu'on vient à en approcher de près. Nous n'en prenons que des notions fausses : nous la regardons non-seulement comme le plus grand malheur, mais encore comme un mal accompagné des plus pénibles angoisses. Nous avons même cherché à grossir dans notre imagination ses funestes images, et à augmenter nos craintes en raisonnant sur la nature de cette douleur. Mais rien n'est plus mal fondé ; car quelle cause peut la produire ou l'occasionner ? La fera-t-on résider dans l'âme, ou dans le corps ? La douleur de l'âme ne peut être produite que par la pensée, celle du corps est toujours proportionnée à sa force ou à sa faiblesse. Dans l'instant de la mort naturelle, le corps est plus faible que jamais ; il ne peut donc éprouver qu'une très-petite douleur, si même il en éprouve aucune.
Les hommes craignent la mort, comme les enfants craignent les ténèbres, et seulement parce qu'on a effaré leur imagination par des fantômes aussi vains que terribles. L'appareil des derniers adieux, les pleurs de nos amis, le deuil et la cérémonie des funérailles, les convulsions de la machine qui se dissout, voilà ce qui tend à nous effrayer.
Les Stoïciens affectaient trop d'apprêts pour ce dernier moment. Ils usaient de trop de consolations pour adoucir la perte de la vie. Tant de remèdes contre la crainte de la mort contribuent à la redoubler dans notre âme. Quand on appelle la vie une continuelle préparation à la mort, on a lieu de croire qu'il s'agit d'un ennemi bien redoutable, puisqu'on conseille de s'armer de toutes pièces ; et cependant cet ennemi n'est rien. Pourquoi l'appréhender si vivement ? enfin, pourquoi craindre la mort, quand on a assez bien vécu pour n'en pas craindre les suites ?
Je sai que la mortalité
Du genre humain est l'apanage..
Pourquoi donc serais-je excepté ?
La vie n'est qu'un pélérinage !
De son cours la rapidité
Loin de m'alarmer, me soulage ;
Sa fin, lorsque j'en envisage
L'infaillible nécessité,
Ne peut ébranler mon courage.
Brulez de l'or empaqueté,
Il n'en périt que l'emballage,
C'est tout : un si léger dommage
Devrait-il être regretté ? (D.J.)
MORT LE, (Critique sacrée) il est dit dans le Deutéronome, chap. xiv. . 1. " vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous raserez point toute la tête pour le mort ". Ce mort est Adonis parce que dans sa fête, on pratiquait toutes ces choses. Il est parlé de la fête d'Adonis dans Ezéchiel, VIIIe 14. Au reste, les Juifs avaient l'idée superstitieuse, que tous ceux qui se trouvaient dans la maison où il y avait un mort, ou qui touchaient au cadavre, étaient souillés et obligés de se purifier, comme il parait par saint Luc, xxij. 4. (D.J.)
MORT, (Mythologie) les anciens ont fait de la mort une divinité fille de la Nuit ; ils lui donnent pour frère le Sommeil éternel, dont le sommeil des vivants n'est qu'une faible image. Pausanias parle d'une statue de la Nuit, qui tenait entre ses bras ses deux enfants, le Sommeil et la Mort ; l'un qui y dort profondément, et l'autre qui fait semblant de dormir.
On peignait la Mort comme un squelete, avec une faux et des griffes : on l'habillait d'une robe semée d'étoiles, de couleur noire avec des ailes noires.
Mors atris circumvolat alis, dit Horace.
On lui sacrifiait un coq, quoiqu'on la regardât comme la plus impitoyable des divinités ; c'est ce qui fait dire à Malherbe.
La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles,
On a beau la prier,
La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.
Les Phéniciens lui bâtirent un temple dans l'île de Gadira, qui ne subsista pas longtemps ; mais il n'en sera pas de même de celui du duc de Buckingham, dont le génie de la Poésie a fait les frais : le voici.
Temple of Death.
In those cold climates, where the sun appears
Unwillingly, aud hides his face in tears ;
A dreadful Vale lies in a désert île,
On which indulgent Heav'n did never smild.
There a thick grove of age'd Cypres's-trees,
Which none without an awful horror sees,
Into its withr'd arms depriv'd of Leaves,
Whole flocks of ill-presaging birds, receives :
Paisons are all the plants the soil will bears.
And winter is the only season there.
Millions of graves cover the spacious field,
And springs of blood a thousand rivers yield,
Whose streams oppress'd with carcasses and bones,
Instead of gentle murmurs, pour forth groans ;
Within this Vale, a famous temple stands
Old the world it self wich it commands :
Round is its figure, and four iron Gates
Divide Mankind. By order of the fates,
There come in crowds, doom'd to one common grave ;
The young, the old, the monarch, and the slave.
Old age and pains which mankind most deplores,
Are faithful keepers of those sacred doors :
All clad in mournful blacks, which also load
The sacred walls of this obscure abode ;
And tapers of a pitchy substance made,
With clouds of smoak, encrease the dismal shade.
A Monster void of reason, and of sight,
The Goddess who sways this realm of night,
Her power extends o'er all things that have breath,
A cruel tyrant, and her name is Death. (D.J.)
MORT, s. m. (Médecine) la mort uniquement considérée sous le point de vue qui nous concerne, ne doit être regardée que comme une cessation entière des fonctions vitales, et par conséquent comme l'état le plus grave, le plus contre-nature, dans lequel le corps puisse se trouver, comme le dernier période des malades ; et enfin comme le plus haut degré de syncope. En l'envisageant sous cet aspect, nous allons tâcher d'en détailler les phénomènes, les causes, les signes diagnostiques et pronostics, et d'exposer la méthode curative qui est couronnée par le succès le plus constant, et qui est la plus appropriée dans les différents genres de mort. La séparation de l'âme d'avec le corps, mystère peut-être plus incompréhensible que son union est un dogme théologique certifié par la Religion, et par conséquent incontestable ; mais nullement conforme aux lumières de la raison, ni appuyé sur aucune observation de Médecine ainsi que nous n'en ferons aucune mention dans cet article purement médicinal, où nous nous bornerons à décrire les changements qui arrivent au corps, et qui seuls tombant sous les sens, peuvent être aperçus par les médecins artistes sensuels, sensuales artifices.
Symptomes. On ne connait la mort que par opposition à la vie, de même que le repos se manifeste par son contraste direct avec le mouvement ; les principaux symptômes se tirent de l'inexercice de la circulation et de la respiration ; ainsi dès qu'un homme est mort, on cherche en vain le pouls dans les différentes parties où les artères sont superficielles ; elles sont dans une immobilité parfaite. Le mouvement de la poitrine inséparable de celui des poumons, est totalement anéanti ; toutes les excrétions sont suspendues ; la chaleur est perdue ; les membres sont froids, roides, inflexibles ; les sens sont dans l'inaction ; il ne reste aucun vestige de sentiment ; une pâleur livide occupe le visage ; les yeux sont sans force, sans éclat, recouverts d'écailles, etc. Jusque-là le cadavre ne diffère de l'homme vivant, que par le défaut de mouvement : les différents organes encore dans leur entier peuvent être ranimés ; ils conservent pendant quelque temps une aptitude à renouveller les mouvements auxquels ils étaient destinés. Ils restent dans cet état jusqu'à ce que la putréfaction plus ou moins prompte, détruise leur tissu, rompe l'union des molécules organiques qui les composent, et mette par-là un obstacle invincible au retour de la vie. Lorsque la corruption commence à gagner, le corps devient successivement bleuâtre, livide, noir ; il exhale une odeur insoutenable, particulière, qu'on nomme cadavéreuse ; bien-tôt après les vers y éclosent ; les différentes parties se désunissent, perdent leur lien, leur figure, et leur cohésion ; les molécules dégagées sont volatiles, s'évaporent ; et enfin, après leur dissipation il ne reste aucun vestige d'homme. Il me parait qu'on pourrait distinguer dans la mort deux états bien différents, et établir en conséquence deux espèces ou deux degrés remarquables de mort. J'appellerai le premier degré mort imparfaite, ou susceptible de secours, qui comprendra tout ce temps où il n'y a qu'un simple inexercice des fonctions vitales, et où les organes, instruments de ces fonctions, sont encore propres à recommencer leur jeu. Le second degré le complément de la mort imparfaite, sera connu sous le nom de mort absolue, irrévocablement décidée. Il est caractérisé non-seulement par la cessation des mouvements, mais encore par un état des organes tel, qu'ils sont dans une impossibilité physique de les renouveller ; ce qui arrive le plus souvent par leur destruction opérée par la putréfaction, ou par des moyens mécaniques, quelquefois aussi par un desséchement considérable, ouvrage de l'art ou de la nature. Le temps qui se passe entre la mort imparfaite, et la mort absolue, est indéterminé ; il varie suivant les causes, les sujets, les accidents, les saisons, etc. En général, l'intervalle est plus long dans ceux qui meurent subitement ou de mort violente, que dans ceux où la mort est l'effet d'une maladie, ou de la vieillesse ; dans les enfants que dans les adultes, dans l'hiver que dans l'été, sous l'eau que dans un air libre, etc. La distinction que je viens d'établir, est fondée sur un grand nombre de faits par lesquels il conste évidemment que des personnes ont resté pendant assez longtemps dans cet état que nous avons appelé mort imparfaite, et qui après cela, ou par des secours appropriés, ou d'elles-mêmes, sont revenues à la vie. De ce nombre sont les morts volontaires ou extatiques ; quelques historiens assurent avoir Ve des personnes qui par le seul acte de la volonté, suspendaient chez eux tous les mouvements vitaux, et restaient pendant un certain temps sans pouls, sans respiration, roides, glacées, et après cela reprenaient d'elles-mêmes l'exercice des sens. Cheyne auteur connu, digne de foi, raconte qu'il a été témoin oculaire d'un semblable fait, et que la mort lui paraissait si bien décidée, qu'il avait déjà pris le parti de se retirer ; cependant l'extase finit, la mort cessa, le pouls et la respiration revinrent par degrés. Il y a des gens qui réitèrent souvent pour satisfaire les curieux ces morts imparfaites. On dit que les Lapons surtout excellent dans ce métier ; on en a cependant Ve quelquefois mourir tout à fait, victimes de ces dangereuses tentatives, de même qu'un anglais qui pouvait suspendre avec la main le mouvement de son cœur ; il mourut enfin ayant poussé trop loin cette expérience. Le traité important, quoique mal digéré, que M. Bruhier médecin a donné sur l'incertitude des signes de la mort, contient un recueil intéressant et curieux d'observations, qu'il a pris la peine de rassembler et d'extraire de différents auteurs, qui prouvent que des morts mis sur la paille, dans la bière, et dans le tombeau même, en sont sortis vivants, après plusieurs jours.
Mais ce qu'il y a de plus terrible, et qu'il est à propos de remarquer dans ces histoires, c'est que presque toutes ces résurrections naturelles sont l'effet d'un heureux hasard, ou d'un concours de circonstances inattendues. Ainsi une jeune fille morte de la petite vérole revint en vie, parce que le bedeau qui la portait laissa tomber le cercueil, dont les ais mal unis se dessassemblèrent ; la secousse de cette chute fit donner à l'enfant des signes de vie ; on la reporta chez elle, où elle revint en parfaite santé. Traité de l'incertitude des signes de la mort, §. VI. page 153. tome I. Une femme du commun étant exposée sur la paille avec un cierge aux pieds, suivant l'usage, quelques jeunes gens renversèrent en badinant le cierge sur la paille qui prit feu à l'instant : dans le même moment la morte se ranima, poussa un cri perçant, et vécut longtemps après. Ibid. §. IV. page 68. Plusieurs personnes enterrées avec des bijoux, doivent la vie à l'avidité des fossoyeurs ou des domestiques, qui sont descendus dans leurs tombeaux pour les voler ; les secousses, l'agitation, les efforts faits pour arracher les anneaux, pour les dépouiller, ont rappelé ces morts imparfaits à la vie. Voyez les observations rapportées dans l'ouvrage déjà cité, tome I. page 53, 61, 98, 134, 170. etc. Dans d'autres la mort a été dissipée par des incisions faites pour les ouvrir : une femme dont Terrili raconte l'histoire, donna des signes de vie au second coup de bistouri ; il est arrivé quelquefois que la vie s'est manifestée trop tard dans de semblables circonstances ; le mort ressuscité a perdu la vie sous le couteau anatomique. Ce fut un pareil événement qui causa tous les malheurs du grand Vésale, ayant ouvert un gentilhomme espagnol, il aperçut dès qu'il eut enfoncé le bistouri quelques signes de vie ; et la poitrine ouverte lui fit observer le mouvement du cœur revenu ; le fait devenu public excita les poursuites des parents et des juges de l'inquisition. Philippe II. roi d'Espagne, par autorité ou plutôt par prières, vint à bout de le soustraire à l'avidité de ce cruel tribunal, à condition qu'il expierait son crime par un voyage à la Terre-Sainte. On raconte du cardinal Espinosa, premier ministre de Philippe II. qu'ayant été disgracié, il mourut de douleur. Lorsqu'on l'ouvrit pour l'embaumer, il porta la main au rasoir du chirurgien, et on trouva son cœur palpitant ; ce qui n'empêcha pas le chirurgien barbare de continuer son opération, et de le mettre par là dans l'impossibilité d'échapper à la mort. Il y a plusieurs exemples de personnes qu'on allait enterrer, ou qui l'étaient déjà, que la tendresse officieuse ou l'incrédulité d'un amant, d'un parent, d'un ami, d'un mari, d'une femme, etc. ont retiré des bras de la mort. Un homme au retour d'un voyage, apprend que sa femme est morte et inhumée depuis trois jours : inconsolable de sa perte, et ne pouvant se persuader qu'elle fût réelle, il descend comme un autre Orphée dans son tombeau, et plus heureux ou plus malheureux que lui, il trouve le secret de lui rendre la vie et la santé. La même chose arriva à un négociant, qui revenant aussi d'un voyage deux jours après la mort de sa femme, la trouva exposée à sa porte dans le moment que le clergé allait s'emparer de son corps, il fit monter la bière dans sa chambre, en tira le corps de sa femme, qui ne donna aucun signe de vie. Pour mieux s'assurer de sa mort, pour tâcher de la dissiper, s'il était possible, il lui fit faire des scarifications et appliquer les ventouses ; on en avait déjà mis vingt-cinq sans le moindre succès, lorsqu'une vingt-sixième fit crier à la morte ressuscitée, ah, que vous me faites mal ! Miladi Roussel, femme d'un colonel anglais, dut la vie à l'extrême tendresse de son mari, qui ne voulut pas permettre qu'on l'enterrât, quoiqu'elle parut bien morte, jusqu'à ce qu'il se manifestât quelque signe de putréfaction. Il la garda ainsi pendant sept jours, après lesquels la morte se réveilla comme d'un profond sommeil au son des cloches d'une église voisine. Voyez d'autres observations semblables dans l'ouvrage déjà cité, tome I. pages 69, 94, 106, 108, etc. et tome II. pages 56 et 58. Quelques morts dont l'enterrement a été différé par quelque cause imprévue, sont précisément revenus à la vie dans cet intervalle : un témoin oculaire raconte et certifie qu'étant à Toulouse dans l'église de saint Etienne, il vit arriver un convoi dont on différa la cérémonie jusqu'àprès un sermon pendant lequel on déposa le corps dans une chapelle. Au milieu du sermon, le cadavre parut animé, fit quelques mouvements qui engagèrent à le reporter chez lui ; de façon, ajoute l'historien de ce fait, que sans le sermon on aurait enterré un homme vivant, ou qui était prêt à le devenir. Ibid. tom. I. p. 62. Diemerbroek rapporte qu'un paysan étant mort de la peste, on se préparait à l'enterrer après les vingt-quatre heures, suivant l'usage ; le défaut de cercueil fit différer jusqu'au lendemain ; et lorsqu'on voulut y mettre le corps, on s'aperçut qu'il commençait à reprendre l'usage de la vie. Enfin, il y a eu des personnes qui rappelées à la vie dans le tombeau, en ont été retirées, ont été assez heureuses pour faire entendre leurs cris à des gens que le hasard amenait dans le voisinage. Ainsi un régiment d'infanterie étant arrivé à Dole, plusieurs soldats manquant de logements, obtinrent la permission de se retirer dans l'église, et de coucher sur les bancs garnis du parlement et de l'université ; quelques soldats entendirent pendant longtemps des plaintes qui semblaient sortir d'un tombeau ; ils avertirent le clerc, on ouvre un caveau où l'on avait enterré le jour même une fille, on la trouve vivante, etc.
Quelques enfants étant allés jouer sur le tombeau d'un homme récemment enterré, furent épouvantés du bruit qu'ils entendirent ; ils racontèrent la cause de leur frayeur ; on exhuma la personne qui était pour lors en vie. Il est évident que si ces personnes eussent été enterrées dans un cimetière et couvertes de terre, elles n'auraient pu faire entendre leurs cris ; et même sans les circonstances imprévues qui se rencontrent, elles seraient mortes de nouveau. Quels affreux soupçons ne font pas naître de pareils événements sur le sort d'une infinité de personnes qu'on enterre trop promptement, et sans beaucoup de précautions, sans attendre surtout que la putréfaction manifestée ait décidé leur mort irrévocable. Il arrive de-là que plusieurs meurent absolument, qui auraient pu revivre si ont eu apporté à propos des secours convenables, ou du-moins si on ne les avait pas privés d'air en les ensevelissant sous la terre, ou en les mettant dans des caveaux qui sont des espèces de mouffetes ; d'autres au contraire, ce qui est encore plus terrible, revenus d'eux-mêmes à la vie, ne peuvent faire venir leurs plaintes à ceux qui pourraient les secourir, les tirer du tombeau où ils sont renfermés sans nourriture, ne revivent que pour mourir encore plus cruellement dans toutes les horreurs de la faim et du désespoir. On voit en effet souvent en exhumant les corps après plusieurs mois, qu'ils sont changés de place, de posture, de situation ; quelques-uns paraissent avec les bras, les mains rongées de rage. Dom Calmet raconte sur la foi d'un témoin oculaire, qu'un homme ayant été enterré dans le cimetière de Bar-le-Duc, on entendit du bruit dans la fosse ; elle fut ouverte le lendemain, et on trouva que le malheureux s'était mangé le bras. On vit à Alais le cercueil d'une femme dont les doigts de la main droite étaient engagés sous le couvercle de son cercueil qui en avait été soulevé. Le docteur Crafft fait mention d'une demoiselle d'Augsbourg, qui étant morte d'une suffocation de matrice, fut enterrée dans un caveau bien muré ; au bout de quelques années on ouvrit le caveau, l'on trouva la demoiselle sur les degrés près de l'ouverture, n'ayant point de doigts à la main droite. Cette histoire est fort analogue à celle d'un religieux carme, qui ayant été enterré depuis longtemps, fut trouvé à l'entrée du caveau les doigts écorchés, et la pierre qui bouchait l'ouverture un peu dérangée ; mais ce qui doit confirmer et augmenter ces soupçons, c'est le long intervalle qui peut s'écouler entre la mort imparfaite et la mort absolue, c'est-à-dire, depuis le temps où les organes ont cessé leurs mouvements, jusqu'à celui où ils perdent l'aptitude à les renouveller. On a Ve qu'il n'est pas rare de revivre après deux ou trois jours ; l'exemple de myladi Roussel prouve qu'on peut être pendant sept jours dans l'état de mort imparfaite. Il y a des observations incontestables de noyés, qui ont resté trois, quatre, et cinq jours sous l'eau. On lit dans les mélanges des curieux de la nature, un fait attesté par Kunkel, touchant un jeune homme qui étant tombé dans l'eau, n'en fut retiré qu'après huit jours ; et Pechlin assure qu'un jeune homme fut pendant plus de quarante-deux jours enseveli sous les eaux, et qu'enfin retiré la septième semaine, septimâ demum hebdommadâ extractum, on put le rappeler à la vie. Ces résurrections qu'on pourrait regarder comme des miracles de la Médecine, passeront pour des fictions, pour des événements supposés dans l'esprit de quelques lecteurs, qui confondant les bornes du possible avec celles de leur connaissance, ignorent que le vrai peut bien souvent n'être pas vraisemblable. Tous ces faits, quelque merveilleux qu'ils paraissent, n'ont rien que de naturel et de conforme aux lois de l'économie animale : les anciens avaient déjà observé qu'on peut rester sans pouls et sans respiration pendant très-longtemps ; ils ont même décrit une maladie sous le nom d', qui veut dire sans respiration, où ils assurent qu'on peut être pendant trente jours sans aucun signe de vie, ne différant d'un véritable mort, que par l'absence de la putréfaction. Il y a un traité grec sur cette maladie, , que Galien, Pline, et Diogène de Laerce, craient avoir été composé par Héraclide de Pont, et que Celse attribue à Démocrite. Cet ouvrage fut fait à l'occasion d'une femme qui reprit l'usage de la vie, après avoir été pendant sept jours sans en donner la moindre marque. L'histoire naturelle nous fournit dans les animaux des exemples qui confirment ceux que nous avons rapportés : tout le monde sait que les loirs restent pendant tout l'hiver au fond d'une caverne, ou enterrés sous la neige, sans manger et sans respirer ; et qu'après ce temps lorsque la chaleur revient, ils sortent de l'engourdissement, parfaite image de la mort dans laquelle ils étaient ensevelis : plusieurs oiseaux passent aussi tout l'hiver sous les eaux ; telles sont les hirondelles entr'autres, qui loin d'aller suivant l'erreur populaire fort accréditée, dans des climats plus chauds, se précipitent au fond de la mer, des lacs, et des rivières, et y passent ainsi sans plumes et sans vie jusqu'au retour du printemps, lorsque la chute des feuilles annonce les approches du froid, dit un poète latin.
Avolat (hirundo) et se credit aquis praecepsque sub illas.
Mersa, in dumosâ mortua valle jacet
Flebilis, exanimis, deplumis, nuda, neque ullam
Vivifici partem moesta caloris habens
Et tamen huic redeunt in sensus munera vitae,
Cum novus herbosam flosculus ornat humum, &c.
David Herlicius, épigram. lib. VI.
M. Falconet, médecin de Paris, étant en Bresse, vit apporter une masse de terre que les pêcheurs avaient tirée de l'eau ; et après l'avoir lavée et débrouillée, il aperçut que ce n'était autre chose qu'un amas d'hirondelles qui approchées du feu se déroidirent et reprirent la vie. On lui assura qu'il n'était pas rare d'en pêcher de la sorte en cette province. Traité de l'incertitude, etc. tome I. page 131. Tous ces faits vérifient bien la remarque de Pline, qui sert d'épigraphe à l'ouvrage de M. Bruhier : " telle est la condition des hommes, dit ce savant naturaliste, ils sont exposés à des jeux de hasard, tels qu'on ne peut même se fier à la mort ".
Causes. Il n'est pas possible de déterminer quelles sont les causes qui occasionnent la mort, et quelle est leur manière d'agir, sans connaître auparavant celles qui entretiennent cette continuité et cette réciprocité d'actions qui forment la vie. Voyez VIE, ÉCONOMIE ANIMALE. On peut regarder du-moins dans l'homme, et dans les animaux dont la structure est à-peu-près semblable, la circulation du sang ou le mouvement du cœur ou des artères, comme le signe le plus assuré, la mesure la plus exacte, et la cause la plus évidente de la vie. Deux autres fonctions surnommées aussi vitales ; savoir la respiration et l'action du cerveau, concourent essentiellement à l'intégrité de cette première, qui est la fonction par excellence. La nécessité de la respiration est fondée sur ce que tout le sang qui Ve se distribuer dans les différentes parties du corps, est obligé, depuis l'instant de la naissance, de passer par les poumons : aussi dès que le mouvement de ce viscère, sans lequel ce passage du sang ne peut avoir lieu, vient à cesser, la circulation est entièrement arrêtée par tout le corps, le cœur et les artères cessent tout de suite leurs battements ; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que dès le moment qu'on fait recommencer la respiration, on renouvelle les contractions alternatives du cœur. Quelques écrivains, observateurs peu exacts et anatomistes mal instruits, ont pensé que dans les personnes qui restaient longtemps sans respirer, le trou ovale ouvert et le canal artériel conservant les propriétés et les usages qu'il avait dans le foetus, suppléaient à la respiration, en donnant lieu à une circulation particulière, telle qu'on l'observe dans le foetus ; mais c'est un fait gratuitement avancé, qui n'a d'autre fondement que la difficulté de trouver une explication plus conforme aux préjugés qu'on s'est formé sur les causes de la vie et de la mort. Il est d'ailleurs contraire aux observations anatomiques et à l'expérience qui fait voir que dans les noyés et les pendus, les mouvements du cœur et les artères ne sont pas moins interceptés que ceux des organes de la respiration. On n'a encore rien de bien décidé sur la manière dont le cerveau influe sur les organes de la circulation ou de la vie : le fluide nerveux si universellement admis n'est appuyé sur aucune preuve satisfaisante ; et le solidisme des nerfs rejeté sans examen plus conforme au témoignage des sens et à la plupart des phénomènes de l'économie animale, souffre encore quelques difficultés ; mais quel que soit le mécanisme de cette action, il est certain qu'elle est nécessaire au jeu des nerfs : les observations et les expériences concourent à prouver la nécessité d'une libre communication des nerfs cardiaques entre le cerveau et le cœur, pour continuer les mouvements de cet organe ; mais il est à-propos de remarquer que le cœur continue de battre quelquefois assez longtemps, malgré la ligature, la section, l'entière destruction de tous ces nerfs ou d'une grande partie. Willis lia dans un chien les nerfs de la paire vague ou de la huitième paire, qui, de concert avec les rameaux de l'intercostal, vont former le plexus cardiaque et se distribuer au cœur ; le chien après cette opération tomba muet, engourdi, eut des frissons, des mouvements convulsifs dans les hypocondres : ces mêmes nerfs entièrement coupés, il ne laissa pas de vivre plusieurs jours, refusant constamment de manger. Cerebr. anatom. page 234. Lower a réitéré cette expérience avec le même succès, de corde, pag. 90. Vieussens est encore allé plus loin, pour ôter lieu à tout vain subterfuge : il coupa ces nerfs et ceux qui concourent à la formation de l'intercostal, et malgré cela le chien qu'il soumit à ce martyre philosophique vécut plus de vingt heures. Nevrograph. pag. 179. On observe que les jeunes animaux, plus muqueux et par conséquent plus irritables, résistent encore plus longtemps à ces épreuves ; ils sont beaucoup plus vivaces. Il est certain que dans les apoplexies fortes l'action du cerveau est très dérangée, souvent anéantie : il arrive cependant quelquefois que le cœur continue de battre à l'ordinaire, tandis que tous les autres mouvements sont interrompus. L'exemple d'une personne qui garda pendant longtemps un abcès au cervelet, joint aux expériences que nous avons rapportées, font voir évidemment que l'ingénieuse distinction des nerfs qui naissent du cervelet d'avec ceux qui tirent leur origine du cerveau, fondement peu solide de la fameuse théorie des maladies soporeuses proposée par Boerhaave, si accréditée dans les écoles, que cette distinction, dis-je, est purement arbitraire, absolument nulle. Il résulte de-là que la cause du mouvement du cœur ne réside point dans les nerfs qui s'y distribuent ; ils ne me paraissent avoir d'autre usage que celui de produire et d'entretenir son extrême et spéciale contractilité, principe fondamental et nécessaire de tout mouvement animal. Voyez SENSIBILITE. Le principal, ou pour mieux dire l'unique moteur actif du cœur, est le sang qui y aborde, qui irritant les parois sensibles des ventricules, en détermine conséquemment aux lois de l'irritabilité les contractions alternatives. Voyez COEUR. Ce que je dis du cœur doit s'appliquer aux artères qui suivent les mêmes lais, et qui semblent n'être qu'une continuation ou une multiplication de cet organe.
Toutes les causes de mort tendent à suspendre les mouvements du cœur, les unes agissant sur les nerfs ou sur le cerveau, attaquent et détruisent l'irritabilité, paralysent pour ainsi dire le cœur, le rendent insensible à l'impression du sang, ou le mettent hors d'état d'exécuter les mouvements accoutumés ; les autres opposent des obstacles invincibles à l'expulsion du sang, ou empêchent son retour dans les ventricules. On peut compter quatre espèces, quatre causes générales de mort, ou quatre façons particulières de mourir : 1°. la mort naturelle ou de vieillesse ; 2°. la mort violente ; 3°. la mort subite ; 4°. la mort de maladie, qui se rapportent aux deux causes premièrement établies.
I. La mort de vieillesse est celle qui arrive naturellement aux vieillards décrépits, par le défaut des organes propres à cet âge, indépendamment de toute maladie étrangère. Quelques auteurs aussi peu au fait de la vraie morale que de la saine physique, pour trouver une raison de cette mort, ont eu recours à des causes finales toujours incertaines, à des volontés expresses de Dieu ; ayant à expliquer comment on mourait dans ces circonstances, ils ont mal déterminé le pourquoi : d'autres, aussi mauvais physiciens, ont gratuitement attribué cette mort aux fatigues de l'âme, au dégoût qu'ils lui ont supposé de rester trop longtemps emprisonnée dans notre frêle machine. Van-Helmont l'a déduit de l'extinction de la flamme vitale et un chaud inné : cette idée est dumoins plus naturelle, mais elle n'explique encore rien. Il reste à déterminer quelle est la cause de cette extinction.
On trouve dans la structure du corps humain et dans l'examen de ses propriétés, des raisons très-simples de cette mort : on n'a qu'à observer les changements qui arrivent dans l'organisation du corps et dans le mécanisme des fonctions lorsque l'âge augmente ; on verra que depuis le premier instant que l'on commence à vivre, les fibres deviennent plus fortes, plus serrées, moins sensibles, moins irritables. Dans la vieillesse, la plupart des petits vaisseaux s'oblitèrent, les viscères se durcissent, les secrétions diminuent, la peau n'est plus humectée, la maigreur augmente de plus en plus jusqu'au point du marasme senîle ; la circulation est plus lente, plus faible, bien moins universelle que dans les enfants ; le pouls est dur, faible, petit, inégal, pour l'ordinaire intérieur : lorsque la vieillesse devient décrépite, l'irritabilité diminue considérablement ; les vaisseaux deviennent plus ou moins durs : on en a Ve près de l'origine du cœur qui avaient acquis la dureté de l'os du cartilage, des pierres. Lorsque la mort est prochaine, le pouls est intermittent, extrêmement lent et faible ; et ces caractères augmentent ainsi par nuances, jusqu'à ce que la sensibilité du cœur entièrement detruite, les forces tout à fait épuisées, le mouvement de cet organe cesse, et ces vieillards meurent alors sans presque s'apercevoir qu'ils cessent de vivre, le passage de la vie à la mort n'étant presque pas sensible chez eux. On voit parlà que notre merveilleuse machine a cela de commun avec toutes les autres ; que la manière dont les mouvements s'y exécutent est une raison suffisante pour en empêcher la perpétuité : chaque moment de vie prépare et dispose à la mort. Il est facîle d'apercevoir combien peu on doit compter sur tous ces élixirs admirables, ces secrets précieux que des empiriques ignorants ou fripons débitent pour prolonger la vie, pour rajeunir et conduire à l'immortalité.
II. Sous le titre de mort violente nous comprenons toutes celles qui sont occasionnées par quelque cause extérieure dont l'action est évidente et prompte, nous comptons d'abord en conséquence toutes les blessures qui empêchent le mouvement du cœur, par la section des nerfs, le dérangement du cerveau ; par l'effusion du sang, les plaies des ventricules, des gros vaisseaux, les épanchements intérieurs, les chutes sur la tête ou l'épine, avec commotion ou luxation, etc. les opérations chirurgicales mal faites ou imprudemment entreprises ; celles qui interceptent la respiration, comme celles qui pénètrent fort avant dans la poitrine, qui coupent, détruisent la trachée-artère. Nous mettrons aussi au nombre des morts qui viennent par défaut de respiration, celles des noyés, de ceux qui sont exposés à la vapeur du vin fermentant, du charbon, des mines, des tombeaux qui ont resté longtemps fermés, des mouffettes, et très-rarement ou plutôt jamais la mort des pendus ; car ils meurent le plus souvent par la luxation de la première vertèbre du col : cette opération est un coup de maître, un tour délicat de bourreau expérimenté, qui ne veut pas faire languir le patient. Quelquefois aussi les pendus meurent apoplectiques, le sang étant retenu et accumulé dans le cerveau par la compression que fait la corde sur les jugulaires. Le froid est quelquefois et dans certains pays si violent, que les personnes les plus robustes ne sauraient y être exposées pendant quelque temps sans perdre la vie de tout le corps ou de quelque partie : son effet le plus sensible est de suspendre le mouvement des humeurs, et d'exciter une gangrène locale ou universelle ; cependant lorsqu'il est poussé au dernier degré d'intensité, il empêche la putréfaction, il desseche les solides, les resserre puissamment, et gèlepour ainsi dire les fluides. Ceux qui sont morts de cette façon se conservent pendant longtemps : on en a trouvé qui étaient encore frais après bien des années. On pourrait enfin rapporter aux morts violentes celle qui est l'effet des poisons actifs pris intérieurement ou introduits par quelque blessure ou morsure extérieure ; leur action est extrêmement variée et fort obscure. Voyez POISON.
III. La mort subite est une cessation prompte des mouvements vitaux, sans aucun changement considérable extérieur ; c'est un passage rapide souvent sans cause apparente de l'exercice le plus florissant des différentes fonctions, à une inaction totale. On cesse de vivre dans le temps où la santé parait la mieux affermie et le danger plus éloigné, au milieu des jeux, des festins, des divertissements, ou dans les bras d'un sommeil doux et tranquille : c'est ce qui faisait souhaiter aux anciens philosophes de mourir de cette façon ; et en effet, à ne considérer que le présent, c'est la mort la moins désagréable, qui évite les souffrances, les horreurs que ne peuvent manquer d'entraîner les approches de la mort ; qui ne donne pas le temps de tomber dans cet anéantissement affreux, dans cet affaissement souvent honteux pour un philosophe, qui la précède dans d'autres circonstances ; et enfin on n'a pas le temps de regretter la vie, la promptitude de la mort ne permet pas toutes les tristes réflexions qui se présentent à un homme qui la voit s'approcher insensiblement.
On a Ve des morts subites déterminées par des passions d'ame vives, par la joie, la terreur, la colere, le dépit, etc. Une dame vaporeuse mourut dans l'instant qu'on lui donnait le coup de lancette pour la saigner, avant même que le sang sortit. Quelques personnes sont mortes ainsi sans qu'on put accuser aucune cause précédente, sans que rien parut avoir donné lieu à un changement si prodigieux ; dans la plupart de ceux qu'on a ouverts, on a trouvé des abscès qui avaient crevé, du sang épanché dans la poitrine ou dans le cerveau, des polypes considérables à l'embouchure des gros vaisseaux. Frédéric Hoffman raconte, sur le témoignage de Graff, médecin de l'électeur Palatin, qu'un nombre considérable de soldats étant morts subitement, on en fit ouvrir cinquante ; il n'y en eut pas un de ceux-là qui n'eut dans le cœur un polype d'une grandeur monstrueuse, monstrosâ magnitudine. Georges Greisell assure qu'il a trouvé de semblables concrétions dans le cœur ou le cerveau de tous ceux qui sont morts d'apoplexie ou de catarre, Miscell. nat. curios. 1670, observ. LXXIV. Wepfer dit avoir Ve dans le cadavre d'un homme mort subitement apoplectique, un polype d'une étendue immense, qui non-seulement occupait les carotides et les vaisseaux un peu considérables du cerveau, mais se distribuait encore dans tous les sinus et anfractuosités de ce viscère ; on comprend facilement comment de semblables dérangements peuvent suspendre tout à-coup le mouvement progressif du cœur et faire cesser la vie ; mais il arrive quelquefois que tous les viscères paraissent dans un état sain et naturel, on ne trouve aucun éclaircissement dans l'ouverture du cadavre sur la cause de la mort ; c'est principalement dans le cas de mort subite excitée par des passions d'ame vives, par des douleurs aiguës inattendues, il n'y a alors qu'une affection nerveuse ; il y a lieu de présumer que le même spasme qui s'observe à l'intérieur occupe les extrémités du cœur, et les empêche d'admettre le sang ou de réagir contre lui. Il est à propos d'observer ici que la mort subite peut aussi arriver dans le cours d'une indisposition, d'une maladie, par les mêmes causes qui la déterminent en santé, indépendamment de celle de la maladie ; un malade trompe quelquefois le pronostic le mieux fondé, il meurt avant le temps ordinaire et sans que les signes mortels aient précédé, ou par une passion d'ame, ou par quelque dérangement interne qu'on ne saurait prévoir : on voit des exemples de cette mort dans quelques fièvres malignes, ceux qui en sont attaqués meurent dès le troisième ou quatrième jour, au grand étonnement des assistants et du médecin même qui ne s'attendait à rien moins ; le cadavre ouvert ne laisse apercevoir aucune cause de mort, pas le moindre vice dans aucun viscère : ces cas méritent d'être sérieusement examinés ; n'y a-t-il pas lieu de soupçonner qu'on se presse trop d'ouvrir et d'enterrer ceux qui sont morts ainsi ?
IV. La mort qui doit être uniquement appelée mort de maladie, est celle qui arrive dans les derniers temps, lorsque les symptômes, les accidents, la faiblesse sont parvenus au plus haut période ; dans les maladies aiguës, la mort arrive d'ordinaire dans le temps où la maladie ayant parcouru ses différents périodes, se terminait par quelque crise salutaire si elle avait tourné heureusement ; de façon qu'on peut la regarder comme une des terminaisons des crises de la maladie où la nature a eu le dessous. On pourrait juger et raisonner d'une fièvre aiguë comme d'une inflammation ; car comme cette affection locale se termine par la résolution, ou par la suppuration, ou enfin par la gangrene, de même les maladies aigues se guérissent entièrement ou dégénèrent en maladies chroniques, ou enfin finissent par la mort de tout le corps ; en approfondissant cette matière on trouverait beaucoup de rapport dans la façon dont ces différentes terminaisons s'opposent dans l'un et l'autre cas. Voyez INFLAMMATION et MALADIE AIGUE. Toutes les maladies aiguës se ressemblent assez par leurs causes, leur marche, leurs effets, et leur terminaison ; elles ne me paraissent différer qu'accidentellement par un siege particulier, par la lesion spéciale, primitive, chronique de quelque viscère, par l'altération plus ou moins forte du sang, causes qui en rendent le danger plus ou moins pressant. L'effet le plus heureux, le plus complet de l'augmentation qu'on observe alors dans le mouvement du sang, du cœur et des artères, est de ramener ou de suppléer l'excrétion dont la suppression avait donné naissance à la maladie, de corriger et de refondre, pour ainsi dire, les humeurs, et enfin de rétablir l'exercice des organes affectés. Lorsque la gravité du mal, le dérangement considérable des viscères, la faiblesse des forces empêchent la réussite de ces efforts, l'altération du sang augmente, il ne se fait aucune coction, ou elle n'est qu'imparfaite, suivie d'aucune excrétion ; le sang n'obéit que difficilement aux coups redoublés du cœur et des vaisseaux, et leurs pulsations deviennent plus fréquentes, à mesure que la lenteur de la pesanteur du sang augmente, les obstacles opposés à la circulation se multiplient, les forces continuellement dissipées et jamais reparées vont en décroissant ; le mouvement progressif du sang diminue peu-à-peu, et enfin cesse entièrement ; les battements du cœur et des artères sont suspendus, la gangrene universelle se forme, et la mort est décidée. Tous ces changements que nous venons d'exposer se manifestent par différents signes qui nous font connaître d'avance le sort funeste de la maladie. Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans le détail de tous les signes mortels, qui varient dans les différentes maladies, on pourra les trouver exposés aux articles de seméiotique, comme pouls, respiration, urine, etc. dont on les tire, et aux maladies qu'ils caractérisent : nous n'en rapporterons à présent que quelques généraux qui se rencontrent presque toujours chez les mourants, qui précèdent et annoncent une mort prochaine. La physionomie présente un coup-d'oeil frappant, surtout pour le médecin expérimenté, dont les yeux sont accoutumés à l'image de la mort ; une pâleur livide défigure le visage ; les yeux sont enfoncés, obscurs, recouverts d'écailles, la pupille est dilatée, les tempes sont affaissées, la peau du front dure, le nez effilé, les lèvres tremblantes ont perdu leur coloris ; la respiration est difficile, inégale, stercoreuse ; le pouls est faible, fréquent, petit, intermittent ; quelquefois les pulsations sont assez élevées, mais on sent un vide dans l'artère, le doigt s'y enfonce sans resistance ; bien-tôt après le pouls fuit de dessous le doigt ; les pulsations semblent remonter ; elles deviennent insensibles au poignet ; en appliquant la main au pli du coude, lorsque l'artère n'est pas trop enfoncée, on les y aperçoit encore ; c'est un axiome proposé par Hippocrate, et fort accrédité chez le peuple, que la mort ne tarde pas lorsque le pouls est remonté au coude, enfin tous ces battements deviennent imperceptibles, le nez, les oreilles et les extrémités sont froides, on n'aperçoit plus qu'un léger sautillement au côté gauche de la poitrine, avec un peu de chaleur, qui cessent enfin tout à fait, et le malade meurt dans des efforts inutiles pour respirer. Il n'est pas rare de trouver dans les cadavres des engorgements inflammatoires, des dépôts, des gangrenes dans les viscères, qui ont souvent accéléré et déterminé la mort ; ces désordres sont plutôt l'effet que la cause de la maladie ; il est cependant assez ordinaire aux médecins qui font ouvrir les cadavres, d'appuyer sur ces accidents secondaires, souvent effets de l'art, l'impossibilité de la guérison, ils montrent à des assistants peu instruits tous ces désordres comme des preuves de la gravité de la maladie, et justifient à leurs yeux leur mauvais succès. Il y a quelquefois des maladies pestilentielles, des fièvres malignes qui se terminent au trois ou quatrième jour par la mort ; le plus souvent on trouve des gangrenes internes, causes suffisantes de mort. Ces gangrenes paraissent être une source d'exhalaisons mephitiques, qui se portant sur les nerfs, occasionnent un relâchement mortel ; ces maladies si promptes semblent aussi attaquer spécialement les nerfs, et empêcher principalement leur action ; le symptôme principal est une faiblesse extrême, un affaissement singulier ; on peut rapporter à la mort qui termine les maladies aiguës, celle qui est déterminée par une abstinence trop longue, qui suit l'inanition ; il est bien difficîle de décider en quoi et comment les aliments donnent, entretiennent et rétablissent les forces ; leur effet est certain, quoique la raison en soit inconnue : dès qu'on cesse de prendre les aliments, ou qu'ils ne parviennent point dans le sang, ou enfin quand la nutrition n'a pas lieu, les forces diminuent, les mouvements ne s'exécutent qu'avec peine et lassitude, les contractions du cœur s'affoiblissent, le mouvement intestin du sang n'étant pas retenu par l'abord continuel d'un nouveau chyle, se développe, les différentes humeurs s'altèrent, la salive acquiert une âcreté très-marquée, la machine s'affaisse insensiblement, les défaillances sont fréquentes, la faiblesse excessive, enfin le malade reste enseveli dans une syncope éternelle.
Dans les maladies chroniques la mort vient plus lentement que dans les aiguës, elle se prépare de loin, et d'autant plus surement ; elle s'opère à-peu-près de même ; quand la maladie chronique est prête à se terminer par la santé ou par la mort, elle devient aiguë. Toute la maladie chronique qui est établie, fondée sur un vice particulier, une obstruction de quelques viscères, surtout du bas-ventre, qui donne lieu à l'état cachectique qui les accompagne toujours, à des jaunisses, des hydropisies, etc. qui empêche toujours la nutrition, la parfaite élaboration du sang, de façon qu'il est rapide, sans ton, sans force, et sans activité ; le mouvement intestin languit, les nerfs sont relâchés, les vaisseaux affoiblis, peu sensibles, la circulation est dérangée ; les forces, produit de l'action réciproque de tous les viscères manquent, diminuent de jour en jour, le pouls est concentré, muet, et conservant toujours un caractère d'irritation ; lorsque la maladie tend à sa fin il devient inégal, intermittent, faible, et se perd enfin tout à fait ; il ne sera pas difficîle de comprendre pourquoi la lesion d'un viscère particulier entraîne la cessation des mouvements vitaux, si l'on fait attention, 1°. qu'ils sont tous nécessaires à la vie ; 2°. que la circulation influe sur les actions de tous les autres viscères, et qu'elle est réciproquement entretenue et différemment modifiée par leur concours mutuel ; 3°. que le moindre dérangement dans l'action d'un viscère fait sur les organes de la circulation une impression sensible que le médecin éclairé peut apercevoir dans le pouls : ainsi la circulation peut être et est effectivement quelquefois troublée, diminuée, et totalement anéantie par un vice considérable dans un autre organe. On trouve ordinairement dans ceux qui sont morts de maladies chroniques, beaucoup de désordres dans le bas-ventre ; le foie, la ratte engorgés, abscédés, corrompus, les glandes du mésentère durcies, le pancréas skirrheux, etc. les poumons sont souvent remplis de tubercules, le cœur renferme des polipes, etc.
Avant de terminer ce qui regarde les causes de la mort, je ne puis m'empêcher de faire observer qu'on accuse très-souvent les Médecins d'en augmenter le nombre. Cette accusation est pour l'ordinaire dictée par la haine, le caprice, le chagrin, la mauvaise humeur, presque toujours portée sans connaissance de causes ; cependant, hélas ! elle n'est que trop souvent juste ; quoique passionnément attaché à une profession que j'ai pris par goût et suivi avec plaisir, quoique rempli d'estime et de vénération pour les Médecins, la force de la vérité ne me permet pas de dissimuler ce qu'une observation constante m'a appris pendant plusieurs années, c'est que dans les maladies aiguës il arrive rarement que la guérison soit l'ouvrage du médecin, et au contraire, la mort doit souvent être imputée à la quantité et à l'inopportunité des remèdes qu'il a ordonnés. Il n'en est pas de même dans les chroniques, ces maladies au-dessus des forces de la nature, exigent les secours du médecin ; les remèdes sont quelquefois curatifs, et la mort y est ordinairement l'effet de la maladie, abandonnée à elle-même sans remèdes actifs ; en général on peut assurer que dans les maladies aiguës on médicamente trop et à contre-temps, et que dans les chroniques on laisse mourir le malade faute de remèdes qui agissent efficacement, il ne manquerait pas d'observations pour constater et confirmer ce que nous avons avancé. Un médecin voit un malade attaqué d'une fluxion de poitrine, c'est-à-dire d'une fièvre putride inflammatoire ; persuadé que la saignée est le secours le plus approprié pour résoudre l'inflammation, il fait faire dans trois ou quatre jours douze ou quinze saignées, la fièvre diminue, le pouls s'affaisse, les forces s'épuisent ; dans cet état de faiblesse, ni la coction ni la crise ne peuvent avoir lieu, et le malade meurt. Un autre croit que l'inflammation est soutenue par un mauvais levain dans les premières voies ; partant de cette idée, il purge au-moins de deux jours l'un ; heureusement les purgatifs peu efficaces qu'il emploie ne font que lâcher le ventre, chasser le peu d'excréments qui se trouvent dans les intestins ; les efforts de la nature dans le temps d'irritation n'en sont que faiblement dérangés ; la coction se fait assez passablement, l'évacuation critique se prépare par les crachats ; on continue les purgatifs parce que la langue est toujours chargée et qu'il n'y a point d'appétit ; mais à-présent ils cessent d'être indifférents, ils deviennent mauvais, ils empêchent l'évacuation critique ; la matière des crachats reste dans les poumons, s'y accumule, y croupit ; le sang ne se dépure point, la fièvre continue devient hectique, les forces manquent totalement, et la mort survient. Une jeune dame de considération est attaquée d'une fièvre putride qui porte légèrement à la gorge ; le pouls est dans les commencements petit, enfoncé, ne pouvant se développer ; comme la malade a de quoi payer, on appelle en consultation plusieurs médecins qui regardaient la maladie comme un mal de gorge gangreneux ; croyant même déjà voir la gangrene décidée à la gorge, ils prognostiquent une mort prochaine, et ordonnent dans la vue de la prévenir, des potions camphrées, et font couvrir la malade des vésicatoires : cependant on donne l'émétique, et on fait même saigner, par l'avis d'un autre médecin appelé ; il y a un peu de mieux, la gorge est entièrement dégagée ; on se réduit à dire vaguement et sans preuves, que le sang est gangrené ; on continue les vésicatoires, les urines deviennent rougeâtres, sanglantes, leur excrétion se fait avec peine et beaucoup d'ardeur ; la malade sent une chaleur vive à l'hypogastre ; les délires et convulsions surviennent ; on voit paraitre en même temps d'autres symptômes vaporeux ; le pouls reste petit, serré, muet, convulsif ; la maladie se termine par la mort ; on ouvre le cadavre, on s'attend de trouver dépôt dans le cerveau, gangrene à la gorge, toutes ces parties sont très-saines ; mais les voies urinaires, et surtout la vessie et la matrice paraissent phlogosées et gangrenées. Il n'est personne qui ne voie que ces désordres sont l'effet de l'action spécifique des mouches cantharides. Dans les maladies chroniques la nature ne faisant presque aucun effort salutaire, il est rare qu'on la dérange ; mais comme elle est affaissée, engourdie, elle aurait besoin d'être excitée, ranimée : on l'affadit encore par des laitages et d'autres remèdes aussi indifférents qui, loin de suivre cette indication, ne touchent point à la cause du mal, et qui laissent la maladie tendre à la destruction de la machine.
Un homme a depuis longtemps le bas-ventre rempli d'obstructions, il est cachectique, une fièvre lente commence à se déclarer, les jambes sont oedémateuses, on lui donne des apozemes adoucissants, des bouillons de grenouille, on hasarde quelques légères décoctions de plantes apéritives ; la maladie ne laisse pas d'empirer, et le malade meurt enfin hydropique ; on néglige les remèdes héroïques, les fondants savonneux, martiaux, etc. Un autre est attaqué d'une phtisie tuberculeuse, il commence à cracher du pus ; le médecin ne fait attention qu'à l'état de suppuration où il croit voir le poumon, il pense que les humeurs sont acres, qu'il ne faut que combattre ces acretés, invisquer par un doux mucilage, et engainer, pour ainsi dire, les petites pointes des humeurs, il donne en conséquence du lait ; s'il entrevait un peu d'épaississement joint à l'acreté, il donne le petit lait ou le lait d'anesse ; enfin, il combine les différentes espèces, met son malade à la diete lactée ; mais ces secours inefficaces n'arrêtent point les progrès ni la funeste terminaison de la maladie ; au moins on ne peut pas dire que le médecin dans les chroniques tue ses malades ; tout au plus pourrait-on avancer qu'il les laisse quelquefois mourir. Il serait bien à souhaiter qu'on fût réduit à un pareil aveu dans les maladies aiguës.
Quelle que soit la cause de la mort, son effet principal immédiat est l'arrêt de la circulation, la suspension des mouvements vitaux : dès que cette fonction est interrompue, toutes les autres cessent à l'instant ; l'action réciproque des solides entr'eux et sur les humeurs est détruite, le sang reste immobile, les vaisseaux dans l'inaction ; tous les mouvements animaux sont suspendus. La chaleur et la souplesse des membres qui en sont une suite se perdent, &, par la même raison, l'exercice des sens est aboli, il ne reste plus aucun vestige de sentiment ; mais la sensibilité ou irritabilité, principe du sentiment et du mouvement, subsistent pendant quelque temps ; les parties musculeuses piquées, agacées en donnent des marques incontestables ; le cœur lui-même après qu'il a cessé de se mouvoir peut, étant irrité, recommencer ses battements. C'est dans la continuation de cette propriété que je fais consister la mort imparfaite ; tant qu'elle est présente, la vie peut revenir, si quelque cause constante peut la remettre en jeu ; il faut pour cela que tous les organes soient dans leur entier, que le mouvement du sang renouvellé ne trouve plus d'obstacles qui l'arrêtent et le suspendent derechef ; que l'action des causes qui ont excité la mort cesse ; c'est ce qui arrive dans tous les cas où elle doit être attribuée au spasme du cœur, dès que la mort a suspendu les mouvements, un relâchement considérable succede à cet état de constriction, la moindre cause peut alors rendre la vie et la santé ; le sang lui-même, altéré par le développement du mouvement intestin, peut servir d'aiguillon pour ressusciter les contractions du cœur.
Lorsque le sang est arrêté quelque-temps, laissé à lui-même, sans mouvement progressif, sans sécrétion, sans être renouvellé par l'abord du chyle ; son mouvement intestin se développe, devient plus actif, et tend enfin à une putréfaction totale, qui détruit le tissu de tous les viscères, rompt l'union, la cohésion des fibres, bannit toute irritabilité, et met le corps dans l'état apparent de mort absolue : il est bien des cas où même avant que la putréfaction se soit manifestée, les organes ont entièrement perdu leur sensibilité, ils ne peuvent recommencer leurs mouvements quelque secours qu'on emploie. On peut observer cela surtout après les maladies aiguës, où le sang altéré est dans un commencement de putréfaction, où quelques viscères sont gangrenés ; et il est à-propos de remarquer que dans ces circonstances, la mort absolue suit de près la mort imparfaite, et que l'on aperçoit bientôt des signes de pourriture. Il en est de même lorsqu'une blessure a emporté, coupé, déchiré les instruments principaux de la vie, ou enfin lorsqu'on a fait dissiper toutes les humeurs, qu'on a desséché ou embaumé le corps.
Diagnostic ; Il n'est pas possible de se méprendre aux signes qui caractérisent la mort ; les changements qui différencient l'homme vivant d'avec le cadavre sont très-frappans et très-sensibles ; on peut assurer la mort, dès qu'on n'aperçoit plus aucune marque de vie, que la chaleur est éteinte, les membres roides, inflexibles, que le pouls manque absolument, et que la respiration est tout à fait suspendue : pour être plus certain de la cessation de la circulation, il faut porter successivement la main au poignet, au pli du coude, au col, aux tempes, à l'aine et au cœur, et plonger les doigts profondément pour bien saisir les artères qui sont dans ces différentes parties ; et pour trouver plus facilement les battements du cœur s'ils persistaient encore, il faut faire pancher le corps sur un des côtés ; on doit prendre garde, pendant ces tentatives, de ne pas prendre le battement des artères qu'on a au bout de ses propres doigts, et qui devient sensible par la pression, pour le pouls du corps qu'on examine, et de ne pas juger vivant celui qui est réellement mort ; on constate l'immobilité du thorax, et le défaut de respiration en présentant à la bouche un fil de coton fort délié, ou la flamme d'une bougie, ou la glace d'un miroir bien polie ; il est certain que la moindre expiration ferait vaciller le fil et la flamme de la bougie et ternirait la glace ; on a aussi coutume de mettre sur le creux de l'estomac un verre plein d'eau, qui ne pourrait manquer de verser s'il restait encore quelque vestige de mouvement ; ces épreuves suffisent pour décider la mort imparfaite ; la mort absolue se manifeste par l'insensibilité constante à toutes les incisions, à l'application du feu ou des ventouses, des vésicatoires, par le peu de succès qu'on retire de l'administration des secours appropriés. On doit cependant être très-circonspect à décider la mort absolue, parce que un peu plus de constance peut-être vaincrait les obstacles. Nous avons Ve que dans pareil cas, vingt-cinq ventouses ayant été appliquées inutilement, la vingt-sixième rappela la vie, et dans ces circonstances il n'y a aucune comparaison entre le succès et l'erreur ; la mort absolue n'est plus douteuse quand la putréfaction commence à se manifester.
Prognostic. L'idée de pronostic emportant nécessairement avec soi l'attente d'un évènement futur, pourra paraitre, lorsque la mort est arrivée, singulière et même ridicule à ceux qui pensent que la mort détruit entièrement toute espérance, confirme les dangers, et réalise les craintes : mais qu'on fasse attention qu'il est un premier degré de mort, pendant lequel les résurrections sont démontrées possibles, et par un raisonnement fort simple, et par des observations bien constatées. Il s'agit de déterminer les cas où l'on peut, avec quelque fondement, esperer que la mort imparfaite pourra se dissiper, et ceux au contraire où la mort absolue parait inévitable. Je dis plus, il est des circonstances où l'on peut assurer que la mort est avantageuse, qu'elle produit un bien réel dans la machine, pourvu qu'on puisse après cela la dissiper ; et pour ôter à cette assertion tout air de paradoxe, il me suffira de faire observer que souvent les maladies dépendent d'un état habituel de spasme dans quelque partie, qu'un engorgement inflammatoire est assez ordinairement entretenu et augmenté par la constriction et le resserrement des vaisseaux, la mort détruisant efficacement tout spasme, lui faisant succéder le relâchement le plus complet, doit être censée avantageuse dans tous les cas d'affection spasmodique ; d'ailleurs la révolution singulière, le changement prodigieux qui se fait alors dans la machine peut être utîle à quelques personnes habituellement malades ; ce que j'avance est confirmé par plusieurs observations, qui prouvent que des personnes attaquées de maladies très-serieuses, dès qu'elles ont eu resté quelque-temps mortes, ont été bien-tôt remises après leur résurrection, et ont jouï pendant plusieurs années d'une santé florissante. Voyez le traité de l'incertitude des signes de la mort, §. 4. 5. et 6. On a Ve aussi quelquefois dans les hémorrhagies considérables la cessation de tout mouvement devenir salutaire. Les jugements qu'on est obligé de porter sur les suites d'une mort imparfaite sont toujours très-fâcheux et extrêmement équivoques ; on ne peut donner que des espérances fort légères, qu'on voit même rarement se vérifier. Les morts où ces espérances sont les mieux fondées, sont celles qui arrivent sans lésion, sans destruction d'aucun viscère, qui dépendent de quelqu'affection nerveuse, spasmodique, qui sont excitées par des passions d'ame, par la vapeur des mines, du charbon, du vin fermentant, des mouffetes, par l'immersion dans l'eau ; lorsqu'il n'y a dans les pendus que la respiration d'interceptée, ou même une accumulation de sang dans le cerveau sans luxation des vertèbres, on peut se flatter de les rappeler à la vie ; il en est de même de la mort qui vient dans le cours d'une maladie, sans avoir été prévenue et annoncée par les signes mortels ; les morts volontaires ou extatiques n'ont, pour l'ordinaire, aucune suite fâcheuse ; elles se dissipent d'elles-mêmes. S'il en faut croire les historiens, il y a des personnes qui en font métier, sans en éprouver aucun inconvénient ; il est cependant à craindre que le mouvement du sang, souvent suspendu ne donne naissance à des concrétions polypeuses, dans le cœur et le gros vaisseau. La mort naturelle qui termine les vieillesses décrépites ne peut pas se dissiper, le retour de la vie est impossible, de même que dans les morts violentes où les nerfs cardiaques sont coupés, le cerveau considérablement blessé, la partie médullaire particulièrement affectée, la destruction du cœur, des poumons de la trachée artère, des gros vaisseaux, des viscères principaux, etc. entraîne aussi nécessairement la mort absolue, il est rare qu'elle ne succede pas promptement à la mort imparfaite, lorsqu'elle est amenée par quelque maladie, et qu'elle est précédée des signes mortels. Il y a cependant quelques observations qui font voir que la mort arrivée dans ces circonstances, a été dissipée. Enfin il n'y a plus d'espoir lorsque la putréfaction est décidée ; nous n'avons aucune observation dans les fastes de la Médecine de résurrection opérée après l'apparition des signes de pourriture.
Curation. C'est un axiome généralement adopté que
Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis.
qu'à la mort il n'y a point de remède ; nous osons cependant assurer, fondés sur la connaissance de la structure et des propriétés du corps humain, et sur un grand nombre d'observations, qu'on peut guérir la mort, c'est-à-dire, r'appeler le mouvement suspendu du sang et des vaisseaux, jusqu'à ce que la putréfaction manifestée nous fasse connaître que la mort est absolue, que l'irritabilité est entièrement anéantie, nous pouvons espérer d'animer ce principe, et nous ne devons rien oublier pour y réussir. Je n'ignore pas que ce sera fournir dans bien des occasions un nouveau sujet de badinage et de raillerie à quelques rieurs indiscrets, et qu'on ne manquera pas de jeter un ridicule sur les Médecins, qui étendront jusqu'aux morts l'exercice de leur profession. Mais en premier lieu, la crainte d'une raillerie déplacée ne balancera jamais dans l'esprit d'un médecin sensé l'intérêt du public, et ne le fera jamais manquer à son devoir. 2°. Quoique dans le plus grand nombre de cas les secours administrés soient inutiles pour dissiper la mort ; ils servent de signes pour constater la mort absolue, et empêchent de craindre que les morts reviennent à la vie dans un tombeau où il ne serait pas possible de s'en apercevoir, et où ils seraient forcés de mourir une seconde fais, de faim, de rage et de désespoir. 3°. Enfin, l'espérance de réussir doit engager les Médecins à ne pas abandonner les morts ; un seul succès peut dédommager de mille tentatives infructueuses ; l'amour propre peut-il être plus agréablement flatté que par la satisfaction vive et le plaisir délicat d'avoir donné la vie à un homme, de l'avoir tiré des bras même de la mort ? Y a-t-il rien qui rende les hommes plus approchants de la divinité que des actions semblables ? D'ailleurs rien n'est plus propre à augmenter la réputation et l'intérêt qui en est d'ordinaire la suite, attraits plus solides, mais moins séduisans. Toute l'antiquité avait une admiration et une vénération pour Empedocle, parce qu'il avait rendu l'usage de la vie à une fille qui n'en donnait depuis quelque temps aucun signe, et qu'on croyait morte. Apollonius de Tyane soutint par une résurrection très-naturelle qui opéra avec un peu de charlatanisme, sa réputation de sorcier, et fit croire qu'il avait des conversations avec le diable ; voyant passer le convoi d'une femme morte subitement le jour de ses nôces, il fait suspendre la marche, s'approche de la bière, empoigne la femme, la sécoue rudement, et lui dit d'un air mystérieux quelques paroles à l'oreille ; la morte donne à l'instant quelques signes de vie, et attire par-là une grande vénération au rusé charlatan ; c'est par de semblables tours d'adresse qu'on donne souvent un air de surnaturel et de magique à des faits qui n'ont rien d'extraordinaire. Asclépiade, médecin, fut dans un pareil cas aussi heureux et moins politique, ou charlatan ; il vit dans une personne qu'on portait en terre quelques signes de vie, ou des espérances de la rappeler, la fait reporter chez elle, malgré la résistance des héritiers avides, et lui rendit, par les secours convenables, la vie et la santé. Pour compromettre encore moins sa réputation et l'efficacité des remèdes appropriés, un médecin doit faire attention aux circonstances où ils seraient tout à fait inutiles, comme lorsque la mort absolue est décidée, ou qu'elle parait inévitable ; lorsque la pourriture se manifeste, lorsque quelque viscère principal est détruit, lorsque la mort est le dernier période de la vieillesse, etc. il serait, par exemple, très-absurde de vouloir rappeler à la vie un homme à qui on aurait tranché la tête, arraché le cœur, coupé l'aorte, l'artère pulmonaire, la trachée-artère, les nerfs cardiaques, etc. on ne peut raisonnablement s'attendre à quelqu'effet des secours, que pendant le temps que l'irritabilité subsiste, et que les différents organes conservent leur structure, leur force et leur cohésion ; l'expérience nous montre les moyens dont nous devons nous servir pour renouveller les mouvements suspendus ; elle nous apprend que l'irritation faite sur les parties musculeuses sur le cœur, en fait recommencer les contractions ; ainsi un médecin qui se propose de rappeler un mort à la vie, après s'être assuré que la mort est imparfaite, doit au plutôt avoir recours aux remèdes les plus actifs ; ils ne sauraient pécher par trop de violence ; et choisir surtout ceux qui agissent avec force sur les nerfs, qui les sécouent puissamment ; les émétiques et les cordiaux énergiques seraient d'un grand secours, si on pouvait les faire avaler, mais souvent on n'a pas cette ressource, on est borné à l'usage des secours exterieurs et moyens. Alors, il faut secouer, piquer, agacer les différentes parties du corps, les irriter par les stimulants appropriés ; 1°. les narines par les sternutatoires violents, le poivre, la moutarde, l'euphorbe, l'esprit de sel ammoniac, etc. 2°. les intestins par des lavements acres faits avec la fumée ou la décoction de tabac, de sené, de coloquinte, avec une forte dissolution de sel marin ; 3°. le gosier, non pas avec des gargarismes, comme quelques auteurs l'ont conseillé, sans faire attention qu'ils exigent l'action des muscles du palais, de la langue et des joues, mais avec les barbes d'une plume, ou avec l'instrument fait exprès qui, à cause de son effet, est appelé la ratissoire ou le balai de l'estomac ; et souvent ces chatouillements font une impression plus sensible que les douleurs les plus vives ; 4°. enfin tout le corps par des frictions avec des linges chauds imbibés d'essences spiritueuses aromatiques, avec des brosses de crin, ou avec la main simplement, par des ventouses, des vésicatoires, des incisions, et enfin par l'application du feu ; toutes ces irritations extérieures doivent être faites dans les parties les plus sensibles, et dont la lésion est la moins dangereuse : les incisions, par exemple, sur des parties tendineuses, à la plante des pieds, les frictions, les vésicatoires et les ventouses font plus d'effet sur l'épine du dos et le mamelon. Une sage-femme a rappelé plusieurs enfants nouveau-nés à la vie, en frottant pendant quelque-temps, avec la main séche, le mamelon gauche ; personne n'ignore à quel point cette partie est sensible ; et lorsque la friction ne suffisait pas, elle suçait fortement à plusieurs reprises ce mamelon, ce qui faisait l'effet d'une ventouse. On ne doit pas se rebuter du peu de succès qui suit l'administration de ces secours, on doit les continuer, les varier, les diversifier ; le succès peut amplement dédommager des peines qu'on aura prises ; quelquefois on s'est bien trouvé de plier les morts dans des peaux de moutons récemment égorgés, dans des linges bien chauds, trempés d'eau-de-vie, leur ayant fait avaler auparavant, par force, quelque élixir spiritueux, puissant, sudorifique. On ne doit pas négliger l'application des épithèmes, des épicarpes composés avec des cordiaux les plus vifs, parce qu'on n'a aucun mauvais effet à en redouter, et quelques observations en constatent l'efficacité ; Borel assure s'être servi avec succès de roties de pain pénétrées d'eau-de-vie chaude, qu'on appliquait sur la région du cœur, et qu'on changeait souvent. Il est encore un secours imaginé par la tendresse, consacré par beaucoup d'expériences et d'observations, et par l'usage heureux qu'en faisaient les Prophètes, au rapport des historiens. Ils se couchaient sur la personne qu'ils voulaient résusciter, soufflaient dans la bouche, et rappelaient ainsi l'exercice des fonctions vitales ; c'est par cet ingénieux stratagème qu'un valet rendit la vie à un maître qu'il chérissait : lorsqu'il vit qu'on allait l'enterrer, il se jette avec ardeur sur son corps, l'embrasse, le secoue, appuie sa bouche contre la sienne, l'y laisse collée pendant quelque temps, il renouvelle par ce moyen le jeu des poumons, qui ranime la circulation, et bien-tôt il s'aperçoit que la vie revient. On a substitué à ce secours, qui pourrait être funeste à l'ami généreux qui le donne, l'usage du soufflet, qui peut, par le même mécanisme, opérer dans les poumons les mouvements alternatifs d'inspiration et d'expiration. Ce secours peut être principalement utîle aux noyés et à ceux qui meurent par le défaut de respiration dans les mouffettes, dans les caves, dans les tombeaux, etc. quelquefois il n'est pas possible d'introduire l'air dans les poumons, l'épiglotte abaissé fermant exactement l'orifice du larinx ; si alors on ne peut pas la soulever, il faut en venir promptement à l'opération de la trachéotomie, et se servir du trou fait à la trachée-artère pour y passer l'extrémité du soufflet ; outre ces secours généraux, qu'on peut employer assez indifféremment dans toutes sortes de morts, il y en a de particuliers qui ne conviennent que dans certains cas. Ainsi, pour rappeler à la vie ceux qui sont morts de froid, il ne faut pas les présenter au feu bien fort tout de suite ; il ne faut les réchauffer que par nuances, les couvrir d'abord de neige, ensuite de fumier dont on peut augmenter graduellement la chaleur. Lorsqu'il arrive à quelque voyageur dans le Canada de mourir ainsi de froid, on l'enterre dans la neige, où on le laisse jusqu'au lendemain, et il est pour l'ordinaire en état de se remettre en chemin. Le secours le plus avantageux aux pendus, sont les frictions, les bains chauds et la saignée ; ils ne manquent guère de reussir quand ils sont appliqués à temps, et qu'il n'y a point de luxation ; lorsque la mort n'est qu'une affection nerveuse, c'est-à-dire dépendante d'un spasme universel ou particulier au cœur, on la dissipe par la simple aspersion de l'eau froide, par l'odeur fétide de quelques résineux, et par les sternutatoires. Je remarquerai seulement à l'égard de ces morts, qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup se presser de les secourir ; la mort imparfaite est assez longue, l'irritabilité se soutient assez longtemps ; je crois même qu'il serait plus prudent d'attendre que la constriction spasmodique eut été détruite par la mort même ; les remèdes appliqués pour lors opéreraient plutôt et plus efficacement ; en effet, on observe que souvent la mort récente résiste aux secours les plus propres précipitamment administrés, tandis que deux ou trois jours après, elle se dissipe presque d'elle-même. D'ailleurs, par une guerison trop prompte, on prévient les bons effets qui pourraient résulter d'une suspension totale de mouvement dans la machine. La précipitation est encore plus funeste dans les morts qui sont la suite d'une blessure considérable, et l'effet d'une grande hémorragie ; il est certain que dans ce cas toute l'espérance du salut est dans la mort ; l'hémorragie continue tant qu'il y a du mouvement dans les humeurs ; leur repos permet au contraire aux vaisseaux de se consolider, et au sang de se cailler ; c'est aussi une méthode très-pernicieuse que d'essayer de tirer par des cordiaux actifs les malades de la syncope, ou de la mort salutaire où ils sont ensevelis ; ces remèdes ne font qu'un effet passager, qui est bien-tôt suivi d'une mort absolue ; ainsi, lorsque la blessure n'est pas extérieure, et qu'on ne peut pas y appliquer des styptiques, il faut laisser longtemps les morts à eux-mêmes, et après cela ne les ranimer qu'insensiblement, et les soutenir, autant qu'on pourra, dans cet état de faiblesse. Nous avertissons en finissant, qu'on doit varier les différents secours que nous avons proposés suivant les causes qui ont excité la mort, l'état du corps qui l'a précédé, et les symptômes qu'on observe. (m)
MORT CIVILE, (Jurisprudence) est l'état de celui qui est privé de tous les effets civils, c'est-à-dire de tous les droits de citoyen, comme de faire des contrats qui produisent des effets civils, d'ester en jugement, de succéder, de disposer par testament : la jouissance de ces différents droits compose ce que l'on appelle la vie civîle ; de manière que celui qui en est privé est reputé mort selon les lais, quant à la vie civîle ; et cet état opposé à la vie civile, est ce que l'on appelle mort civile.
Chez les Romains la mort civîle provenait de trois causes différentes ; ou de la servitude, ou de la condamnation à quelque peine qui faisait perdre les droits de cité, ou de la fuite en pays étranger.
Elle était conséquemment encourue par tous ceux qui souffraient l'un des deux changements d'état appelés en Droit maxima et minor, seu media capitis diminutio.
Le mot caput était pris en cette occasion pour la personne, ou plutôt pour son état civil pour les droits de cité ; et diminutio signifiait le changement, l'altération qui survenait dans son état.
Le plus considérable de ces changements, celui que l'on appelait maxima capitis diminutio, était lorsque quelqu'un perdait tout-à-la-fais les droits de cité et la liberté, ce qui arrivait en différentes manières. 1°. Par la condamnation au dernier supplice ; car dans l'intervalle de la condamnation à l'exécution, le condamné était mort civilement. 2°. Lorsque pour punition de quelque crime on était déclaré esclave de peine, servus poenae : on appelait ainsi ceux qui étaient damnati ad bestias, c'est-à-dire condamnés à combattre contre les bêtes. Il en était de même de tous ceux qui étaient condamnés à servir de spectacle au peuple. Le czar Pierre I. condamnait des gens à être fous, en leur disant je te fais fou. Ils étaient obligés de porter une marotte, des grelots et autres signes, et d'amuser la cour. Il condamnait quelquefois à cette peine, les plus grands seigneurs ; ce que l'on pourrait regarder comme un retranchement de la société civile. Ceux qui étaient condamnés in metallum, c'est-à-dire à tirer les métaux des mines ; ou in opus metalli, c'est-à-dire à travailler aux métaux tirés des mines. La condamnation à travailler aux salines, à la chaux, au soufre, emportait aussi la privation des droits de cité, lorsqu'elle était prononcée à perpétuité. Les affranchis qui s'étaient montrés ingrats envers leurs patrons, étaient aussi déclarés esclaves de peine. 3°. Les hommes libres qui avaient eu la lâcheté de se vendre eux-mêmes, pour toucher le prix de leur liberté, en la perdant étaient aussi déchus des droits de cité.
La novelle XIII. chap. VIIIe abrogea la servitude de peine ; mais en laissant la liberté à ceux qui subissaient les condamnations dont on vient de parler, elle ne leur rendit pas la vie civile.
L'autre changement d'état qui était moindre, appelé minor, seu capitis media diminutio, était lorsque quelqu'un perdait seulement les droits de cité, sans perdre en même temps sa liberté ; c'est ce qui arrivait à ceux qui étaient interdits de l'eau et du feu, interdicti aqua et igne. On regardait comme retranchés de la société ceux à qui il était défendu d'assister de l'usage de deux choses si nécessaires à la vie naturelle. Ils se trouvaient par-là obligés de sortir des terres de la domination des Romains. Auguste abolit cette peine à laquelle on substitua celle appelée deportatio in insulam. C'était la peine du bannissement perpétuel hors du continent de l'Italie, ce qui emportait mort civile, à la différence du simple exil, appelé relegatio, lequel soit qu'il fût à temps, ou seulement perpétuel, ne privait point des droits de cité.
Il y avait donc de deux sortes de mort civîle chez les Romains ; l'une qui emportait tout à la fois la perte de la liberté et des droits de cité ; l'autre qui emportait la perte des droits de cité seulement. Du reste, la mort civîle opérait toujours les mêmes effets quant à la privation des droits de cité. Celui qui était mort civilement, soit qu'il restât libre ou non, n'avait plus ses enfants sous sa puissance : il ne pouvait plus affranchir ses esclaves : il ne pouvait ni succéder, ni recevoir un legs, ni laisser sa succession, soit ab intestat, ou par testament : tous ses biens étaient confisqués : en un mot, il perdait tous les privilèges du Droit civil, et conservait seulement ceux qui sont du Droit des gens.
En France, il n'y a aucun esclave de peine, ni autres ; les serfs et mortaillables, quoique sujets à certains devoirs personnels et réels envers leur seigneur, conservent cependant en général la liberté et les droits de cité. Il y a néanmoins dans les colonies françaises des esclaves, lesquels ne jouissent point de la liberté, ni des droits de cité ; mais lorsqu'ils viennent en France, ils deviennent libres, à moins que leurs maîtres ne fassent leur déclaration à l'amirauté que leur intention est de les r'emmener aux iles. Voyez ESCLAVES.
La mort civîle peut procéder de plusieurs causes différentes ; ou de la profession religieuse, ou de la condamnation à quelque peine qui fait perdre les droits de cité ; ou de la sortie d'un sujet hors du royaume, pour fait de religion, ou pour quelque autre cause que ce sait, lorsqu'elle est faite sans permission du Roi, et pour s'établir dans un pays étranger.
Chez les Romains, la profession religieuse n'emportait point mort civile, au lieu que parmi nous, elle est encourue du moment de l'émission des vœux.
Un religieux ne recouvre pas la vie civile, ni par l'adeption d'un bénéfice, ni par la sécularisation de son monastère, ni par la promotion à l'épiscopat.
Les peines qui opèrent en France la mort civîle sont 1°. toutes celles qui doivent emporter la mort naturelle : 2°. les galeres perpétuelles : 3°. le bannissement perpétuel hors du royaume : la condamnation à une prison perpétuelle.
Dans tous ces cas la mort civîle n'est encourue que par un jugement contradictoire, ou par contumace.
Quand la condamnation est par contumace, et que l'accusé est décédé après les cinq ans sans s'être représenté, ou avoir été constitué prisonnier, il est reputé mort civilement du jour de l'exécution du jugement de contumace.
Il y a pourtant une exception pour certains crimes énormes, tels que celui de lese-majesté divine ou humaine, le duel, le parricide, etc. dans ces cas la mort civîle est encourue du jour du délit ; mais elle ne l'est pas ipso facto, et ce n'est toujours qu'après un jugement comme il vient d'être dit : tout ce que l'on a ajouté de plus à l'égard de ces crimes, c'est que la mort civîle qui résulte des peines prononcées par le jugement, a un effet rétroactif au jour du délit.
Hors ces cas, celui qui est in reatu n'est pas reputé mort civilement ; cependant si les dispositions qu'il a faites sont en fraude, on les déclare nulles.
Celui qui est mort civilement demeure capable de tous les contrats du Droit des gens ; mais il est incapable de tous les contrats qui tirent leur origine du droit civil : il est incapable de succéder soit ab intestat, ou par testament, ni de recevoir aucuns legs : il ne peut pareillement tester, ni faire aucune donation entre-vifs, ni recevoir lui-même par donation, si ce n'est des aliments.
Le mariage contracté par une personne morte civilement est valable quant au sacrement ; mais il ne produit point d'effets civils.
Enfin celui qui est mort civilement ne peut ni ester en jugement, ni porter témoignage ; il perd les droits de puissance paternelle ; il est déchu du titre et des privilèges de noblesse, et la condamnation qui emporte mort civile, fait vaquer tous les bénéfices et offices dont le condamné était pourvu.
La mort civile, de quelque cause qu'elle procede, donne ouverture à la succession de celui qui est ainsi reputé mort.
Lorsqu'elle procede de quelque condamnation, elle emporte la confiscation dans les pays où la confiscation a lieu, et au profit de ceux auxquels la confiscation appartient. Voyez CONFISCATION.
Les biens acquis par le condamné depuis sa mort civile, appartiennent après sa mort naturelle, par droit de déshérence, au seigneur du lieu où ils se trouvent situés.
L'ordonnance de 1747 décide que la mort civîle donne ouverture aux substitutions.
La mort civîle éteint l'usufruit en général, mais non pas les pensions viageres, parce qu'elles tiennent lieu d'aliments : par la même raison le douaire peut subsister, lorsqu'il est assez modique pour tenir lieu d'aliments.
Toute la société finit par la mort civîle ; ainsi en cas de mort civîle du mari ou de la femme, la communauté de biens est dissoute, chacun des conjoints reprend ce qu'il a apporté.
Si c'est le mari qui est mort civilement, il perd la puissance qu'il avait sur sa femme, celle-ci peut demander son augment de dot et ses bagues et joyaux coutumiers, en donnant caution ; mais elle ne peut pas demander ni deuil, ni douaire, ni préciput.
Il y avait chez les Romains différents degrés de restitution, contre les condamnations pénales : quelquefois le prince ne remettait que la peine, quelquefois il remettait aussi les biens ; enfin il remettait quelquefois aussi les droits de cité, et même les honneurs et dignités.
Il en est de même parmi nous ; les lettres d'abolition, de commutation de peine, de pardon, de rappel de ban ou des galeres, les lettres de réhabilitation, celles de rémission, rendent la vie civile, lorsqu'elles sont valablement enthérinées.
Les lettres de révision opèrent le même effet, lorsque le premier jugement est déclaré nul, et que l'accusé est renvoyé de l'accusation.
Les lettres pour ester à droit, après les cinq ans de la contumace, ne donnent que la faculté d'ester en jugement.
La représentation du condamné par contumace, dans les cinq ans, lui rend de droit la vie civile.
Quoique la peine du crime se prescrive par vingt ans, lorsqu'il n'y a point eu de condamnation, et par trente ans lorsqu'il y a eu condamnation, la prescription ne rend pas la vie civile.
Sur la mort civile, voyez les lois civiles, liv. prélimin. Le Brun, des successions, liv. I. chap. j. sect. 2. Ferrières sur l'art. 229 de la coutume de Paris. Augeard, tom. II. chap. lxvij. Franc. Marc, tom. I. quest. 911. le traité de M. Richer de la mort civile. M. Duparc Poulain, sur l'art. 610 de la coutume de Bretagne. Hevin sur Frein, page 887. Voyez aussi les mots BANNISSEMENT, CONTUMACE, GALERES, LETTRES DE GRACE ET RAPPEL, REHABILITATION. (A)
MORT, se dit figurément en plusieurs manières dans le Commerce. On appelle un argent mort, un fonds mort, l'argent et le fonds qui ne portent aucun intérêt. Voyez INTERET. On dit que le commerce est mort, quand il est tombé et qu'il ne s'en fait presque plus. Dictionnaire de Comm.
MORT, au jeu de Tontine, sont les joueurs qui ont perdu toute leur reprise, et n'ont d'autre espérance que dans les cas que leurs voisins peuvent avoir, que dans les jetons qu'ils leurs procurent. Les joueurs qui sont morts n'ont point de cartes devant eux, et ne mêlent point à leur tour comme les autres.
MORT
- Détails
- Écrit par Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie parente: Physique particulière
- Catégorie : Anatomie & Physiologie