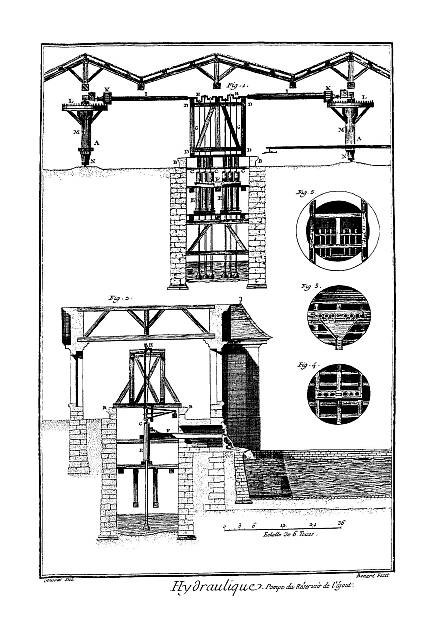ou SCEPTIQUE PHILOSOPHIE, (Histoire, Philosophie) les Grecs étaient fatigués de tant de disputes sur le vrai et le faux, sur le bien et le mal, sur le beau et sur le laid, lorsqu'il s'éleva parmi eux une secte qui fit en peu de temps beaucoup de prosélytes. Ce fut la pyrrhonienne ou sceptique. Dans les autres écoles, on avait un système reçu, des principes avoués, on prouvait tout, on ne doutait de rien : dans celle-ci, on suivit une méthode de philosopher toute opposée, on prétendit qu'il n'y avait rien de démontré ni de démontrable ; que la science réelle n'était qu'un vain nom ; que ceux qui se l'arrogeaient n'étaient que des hommes ignorants, vains ou menteurs ; que toutes les choses dont un philosophe pouvait disputer, restaient malgré ses efforts couvertes des ténébres les plus épaisses ; que plus on étudiait, moins on savait, et que nous étions condamnés à flotter éternellement d'incertitudes en incertitudes, d'opinions en opinions, sans jamais trouver un point fixe d'où nous pussions partir et où nous pussions revenir et nous arrêter. D'où les sceptiques concluaient qu'il était ridicule de définir ; qu'il ne fallait rien assurer ; que le sage suspendait en tout son jugement ; qu'il ne se laisserait point leurrer par la chimère de la vérité ; qu'il réglerait sa vie sur la vraisemblance, montrant par sa circonspection que si la nature des choses ne lui était pas plus claire qu'aux dogmatiques les plus décidés, du-moins l'imbecillité de la raison humaine lui était mieux connue. Le sceptique était donc un ennemi commun.
Pyrrhon, disciple d'Anaxarque de la secte éléatique, exerça le premier cette philosophie pusillanime et douteuse, qu'on appelle de son nom Pyrrhonisme, et de sa nature Scepticisme. Si l'on examine la méthode des académiciens, on ne la trouvera pas fort éloignée de celle de Pyrrhon.
Pyrrhon naquit à Elée de parents obscurs. Il fut mauvais peintre avant que d'être philosophe. Il eut pour premier maître Brison, fils de Stilpon, disciple de Clinomaque, qui l'instruisit de cette dialectique épineuse, particulière aux Eristiques. Il entendit ensuite Anaxarque, disciple de Métrodore de Chio, et s'attacha à ce philosophe. Ils suivirent ensemble Alexandre dans l'Inde, et conférèrent avec les Brachmanes et les Gymnosophistes. Il ne retint de la doctrine de ses maîtres que les principes qui favorisaient son penchant naturel à ce doute. Il débuta d'une manière qui ne dut guère moins offenser que surprendre : il dit qu'il n'y avait rien d'honnête ni de déshonnête, rien d'injuste ni de juste, rien de beau ni de laid, rien de vrai ni de faux, et ce furent ses premiers mots. L'éducation, l'usage commun, l'habitude étaient, selon lui, les seuls fondements des actions et des assertions des hommes. On assure que sa conduite fut conséquente à sa philosophie ; qu'il ne se précautionnait contre rien ; qu'il ne se détournait point ; qu'il allait droit à un char, à un précipice, à un bucher, à une bête féroce ; qu'il bravait dans les occasions les plus périlleuses le témoignage évident de ses sens, et que souvent il dut son salut à ses amis qui l'accompagnaient. Si cela est, il faut regarder Pyrrhon comme une de ces têtes qui naissent étonnées, et pour qui tout est confondu : mais il n'en est rien ; il raisonnait comme un insensé, et se conduisait comme tout le monde. On lui remarqua seulement plus d'indifférence, plus d'indulgence et plus de résignation. N'ayant point d'avis, il n'était pas difficîle de le déterminer ; nulle notion du bien et du mal, comment pouvait-on l'offenser ? de quoi se serait plaint un homme qui ne distinguait pas la peine et le plaisir ? La suprême tranquillité d'ame qu'il avait acquise étonnait Epicure. Ses concitoyens le créérent grand-prêtre. Quelle que fût sa philosophie, le bien était donc la règle de sa vie : il n'en faut pas douter. L'Acatalepsie de Pyrrhon ne s'étendait pas au rapport des sens : c'était une arme qu'il avait inventée contre l'orgueil des dogmatiques, et qu'il n'employait qu'avec eux. Il avait ses sentiments particuliers dans l'école, et la conduite commune dans la société. Il fleurit dans la cent dixième olympiade ; il mourut âgé de 90 ans. Les Athéniens lui élevèrent une statue auprès du portique : il eut aussi un monument dans sa patrie.
Pyrrhon avait appris sous Démocrite qu'il n'y avait rien de réel que les atomes ; que ce que nous regardons comme des qualités propres des corps n'étaient que des affections de notre entendement, des opinions, une disposition, un ordre, une perception ; dans l'école éléatique, que le témoignage des sens était trompeur ; sous Stilpon, l'art funeste de disputer pour et contre presqu'avec un même avantage ; c'était un homme d'un caractère dur ; il voyait les philosophes répandus en une infinité d'écoles opposées, et les uns sous le lycée, les autres sous le portique, criant : " C'est moi qui possède la vérité ; c'est ici qu'on apprend à être sage ; venez, messieurs, donnez-vous la peine d'entrer : mon voisin n'est qu'un charlatan qui vous en imposera ". Et ces circonstances concoururent à le conduire au Scepticisme qu'il professa.
Pyrrhon eut beaucoup de sectateurs. Le premier dont on fasse mention est Euriloque : c'était un homme violent, dont la conduite rendit de temps en temps ridicule une secte qui prêchait le doute dans la recherche de la vérité, et l'ataraxie dans l'usage des passions : il avait gardé pour les sophistes la haine de son maître ; cependant ils le harcelèrent tellement en Elide par leurs questions épineuses, que d'impatience Euriloque jeta par terre son manteau et se précipita dans l'Alphée, laissant un fleuve entr'eux et lui.
Il y eut un Pyrrhon d'Athènes, disciple de Pyrrhon d'Elée, aimant la solitude comme son maître, et fuyant aussi les disputes de l'école et le tumulte du monde.
Timon le Phliasien fut danseur avant que d'être sceptique ; mais dégouté de cet art frivole, il alla à Mégare étudier la dialectique sous Stilpon, et de Mégare en Elide, écouter Pyrrhon. Il aima la table : il se faisait un honneur de bien boire : ses débauches le réduisirent à la mendicité ; alors il se mit à courir l'Hellespont et la Propontide, professant la Philosophie et prêchant la sobriété. Il se fit de la réputation dans ce voyage ; il rétablit ses affaires, et reparut dans Athènes où il demeura jusqu'à sa mort. Ce fut un homme de grande pénétration ; personne ne saisissait plus rapidement et plus surement le vice d'un raisonnement, ni le faible d'un système. Maitre dans l'art de manier l'ironie, il accablait de ridicule ceux qu'il avait terrassés : il se plut à écrire des satyres. La calomnie et la médisance n'y étaient pas épargnées : il déchira les plus honnêtes gens, et n'en fut que plus agréable au peuple athénien. Il donna une des plus fortes preuves qu'on puisse exiger de la sincérité de son indifférence philosophique ; c'est qu'auteur d'ouvrages, il en soignait si peu les copies, qu'elles étaient pourries, rongées des rats, perdues, et que souvent il était obligé de suppléer les endroits défectueux, de mémoire. Il mourut âgé de 90 ans.
La secte pyrrhonienne dura peu. Elle s'éteignit depuis Timon le Phliasien jusqu'à Enésideme, contemporain de Ciceron. En voici les principaux axiomes.
Le Scepticisme est l'art de comparer entr'elles les choses qu'on voit et qu'on comprend, et de les mettre en opposition.
On peut opposer ou les choses qu'on voit à celles qu'on voit, ou les choses qu'on entend à celles qu'on entend, ou les choses qu'on entend à celles qu'on voit.
L'Ataraxie est le but du Scepticisme.
Son grand axiome, c'est qu'il n'y a point de raison qui ne puisse être contrebalancée par une raison opposée et de même poids.
Le sceptique ne décide rien ; ce n'est pas qu'il ne soit affecté comme les autres hommes, et que la sensation n'entraîne son jugement ; mais il réserve son doute, pour l'opposer à l'orgueil des dogmatiques, pour qui tout est évident dans les sciences.
Sous ce point de vue, le sceptique ne forme point une secte ; toute secte supposant un système de plusieurs dogmes liés entr'eux, et énonçant des choses conformes aux objets des sens.
C'est un sectaire, en ce qu'il y a des apparences d'après lesquelles il se croit obligé de régler sa conduite.
Il ne nie point les apparences, mais bien tout ce qu'on affirme de l'objet apparent.
Il a trois motifs qui le déterminent à acquiescer aux apparences ; l'instruction naturelle ; l'effort des passions ; les lais, les usages et la tradition des arts.
Celui qui prononcera qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais en soi, sera troublé toute sa vie, tantôt par l'absence du bon, tantôt par la présence du mauvais ; il cherchera à éloigner une chose, et en rapprocher une autre, et il sera tout à ce travail.
Le sceptique peut se promettre l'ataraxie, en saisissant l'opposition des choses qu'on aperçoit par le sens et de celles qu'on connait par la raison, ou par la suspension du jugement lorsque l'opposition dont il s'agit ne peut être saisie.
Il y a dix lieux communs qui conduisent à la suspension du jugement.
Le premier, c'est que les images varient selon la différence des animaux.
Le second, c'est que les images varient selon la différence des hommes ; elles ne sont pas les mêmes d'un homme à un autre.
Le troisième se tire de la différence des sens ; ce qui est agréable à l'odorat est souvent désagréable au gout.
Le quatrième, des circonstances ; comme les habitudes, les dispositions, les conditions, le sommeil, la veille, l'âge, le mouvement, le repos, l'amour, la haine, la faim, la satiété, la confiance, la crainte, la joie, le chagrin. Toutes ces choses influent d'un homme à un autre dans le même moment, et d'un homme à lui-même en différents moments, où il est d'expérience que les images varient.
Le cinquième, des positions, des temps, des lieux, et des intervalles.
Le sixième, de la combinaison, car aucun objet ne tombe solitaire sous nos sens, peut-être pouvons-nous prononcer sur cette combinaison, mais non sur les objets combinés.
Le septième, des quantités et des constitutions des sujets.
Le huitième, des rapports.
Le neuvième, de la fréquence et de la rareté des sensations.
Le dixième, des constitutions, des coutumes, des lais, des superstitions, des préjugés, des dogmes qui présentent une foule d'oppositions qui doivent suspendre le jugement de tout homme circonspect, sur le fond.
A ces lieux des anciens sceptiques, ceux qui vinrent après en ajoutèrent cinq autres, la diversité des opinions du philosophe et du peuple, du philosophe au philosophe, du philosophe à l'homme du peuple, et de l'homme du peuple à l'homme du peuple ; le circuit des raisons à l'infini ; la condition de celui qui voit ou comprend relativement à l'objet Ve ou compris ; les suppositions qu'on prend pour des principes démontrés, la pétition de principe dans laquelle on prouve une chose par une autre et celle-ci par la première.
Les étiologies des dogmatiques peuvent se réfuter de huit manières ; en montrant 1° que l'espèce de la cause assignée n'est pas de choses évidentes, ni une suite avouée de choses évidentes ; 2° qu'entre différents partis qu'on pourrait prendre, si l'on connaissait toutes les raisons de se déterminer, on suit celui qu'il plait aux dogmatiques qui celent ou qui ignorent les raisons qui rendraient perplexe ; 3° que tout ce qui est, est soumis à un ordre, et que leurs raisons n'en montrent point ; 4° qu'ils admettent les apparences comme elles se font, et qu'ils imaginent avoir conçu la manière dont se font les non-apparents, tandis que les apparents et les non-apparents ont peut-être une même manière d'être, peut-être une manière particulière et diverse ; 5° que presque tous rendent raison d'après des éléments supposés, et non d'après des lois générales, communes et avouées ; 6° qu'ils choisissent les phenomenes qui s'expliquent facilement d'après leurs suppositions, mais qu'ils ferment les yeux sur ceux qui les contredisent et les renversent ; 7° que les raisons qu'ils rendent répugnent quelquefois non-seulement aux apparences, mais à leurs propres hypothèses ; 8° qu'ils concluent des apparences à ce qui est en question, quoiqu'il n'y ait pas plus de clarté d'un côté que de l'autre.
Il est impossible d'apporter une raison qui convienne généralement à toutes les sectes de philosophes, aux sens, à la chose, aux apparences.
Le sceptique ne définit point son assentiment, il s'abstient même d'expressions qui caractérisent une négation ou une affirmation formelle. Ainsi il a perpétuellement à la bouche, " je ne définis rien, pas plus ceci que cela ; peut-être oui, peut-être non ; je ne sais si cela est permis ou non-permis, possible ou impossible ; qu'est-ce qu'on connait ? être et voir est peut-être une même chose ".
Dans une question proposée par le dogmatique, le pour et le contre lui conviennent également.
Quand il dit qu'on ne comprend rien, cela signifie que de toutes les questions agitées entre les dogmatiques, il n'en a trouvé aucune parmi celles qu'il a examinées, qui soit compréhensible.
Il ne faut confondre le Scepticisme ni avec l'Héraclicisme, ni avec le Démocritisme, ni avec le système de Protagoras, ni avec la philosophie de l'académie, ni avec l'empirisme.
Il n'y a aucun caractère théorétique du vrai et du faux, il y en a un pratique. Le caractère théorétique qu'on apporte du vrai et du faux, doit avoir le sien ; je raisonne de même de celui-ci, et ainsi à l'infini.
Le caractère théorétique du vrai ou du faux, dans celui qui juge, ou dans l'homme, ne se peut ni entendre ni démontrer.
Quel est entre tant d'avis opposés, celui auquel il faut se conformer.
Le caractère du vrai et du faux considéré relativement au sens et à l'entendement n'est pas moins obscur. L'homme ne juge pas par le sens seul, par l'entendement seul, ni par l'un et l'autre conjointement.
Le caractère du vrai et du faux relativement à l'imagination est trompeur ; car qu'est-ce que l'image ? Une impression faite dans l'entendement par l'objet aperçu. Comment arrive-t-il que ces impressions tombent successivement les unes sur les autres, et ne se brouillent point ? Quand d'ailleurs cette merveille s'expliquerait, l'imagination prise comme une faculté de l'entendement ne se concevrait pas plus que l'entendement qui ne se conçoit point.
Quand nous conviendrions qu'il y a quelque caractère de la vérité, à quoi servirait-il ? les dogmatiques nous disant que la vérité abstraite ne subsiste pas, elle n'est rien.
Une chose obscure n'a point de caractère qui démontre que cette chose soit plutôt cela qu'autre.
Mais la liaison dans le raisonnement ne se connait pas plus que l'objet ; il faut toujours en venir à prouver une liaison par une autre, ou celle-ci par celle-là, ou procéder à l'infini, ou s'arrêter à quelque chose de non démontré.
D'où il s'ensuit qu'on ne sait pas même encore ce que c'est qu'une démonstration, car toutes les parties du raisonnement ne coexistent pas ensemble, ni la démonstration qui en résulte, ni la force conclusive, ni séparément.
Le syllogisme simple est vicieux ; on l'appuie sur une base ruineuse, ou des propositions universelles, dont la vérité est admise sur une induction faite des singuliers, ou des propositions singulières, dont la vérité est admise sur une concession précédente de la vérité des universelles.
L'induction est impossible, car elle suppose l'exhaustion de tous les singuliers : or les singuliers sont infinis en nombre.
Les définitions sont inutiles ; car celui qui définit ne comprend pas la chose par la définition qu'il en donne, mais il applique la définition à une chose qu'il a comprise ; et puis si nous voulons tout définir, nous retomberons dans l'impossibilité de l'infini ; et si nous accordons qu'il y a quelque chose qu'on peut comprendre sans définition, il s'ensuivra qu'alors les définitions sont inutiles, et que par conséquent il n'y en a point de nécessaire.
Autre raison pour laquelle les définitions sont inutiles ; c'est qu'il faut commencer par établir la vérité des définitions, ce qui engage dans des discussions interminables.
Le genre ou l'espèce sont ou des notions de l'entendement ou des substances. Si c'est le premier, il y a la même incertitude que s'il s'agissait de l'entendement ; si c'est le second, les espèces ne peuvent être comprises dans les genres, et il n'y a plus ni espèces ni genres.
Des différents sophismes qu'on peut faire, la dialectique ne résout que ceux dont la solution est inutîle ; ce n'est point le dialecticien, c'est l'homme versé dans l'art ou la science qui les résout.
Il en faut dire autant des amphibologies. Les distinctions du dialecticien sont utiles dans le cours de la vie ; c'est l'homme instruit de l'art ou de la science qui apercevra l'amphibologie qui tromperait.
Si le sceptique ne voit que de l'incertitude dans la philosophie naturelle, croit-on que la philosophie morale lui soit moins suspecte ?
Il se conforme à la vie commune, et il dit avec le peuple, il y a des dieux, il faut les adorer, leur providence s'étend sur tout ; mais il dispute de ces choses contre le dogmatique, dont il ne peut supporter le ton décisif.
Entre les dogmatiques, les uns disent que Dieu est corporel, d'autres qu'il est incorporel ; les uns qu'il a forme, les autres qu'il n'en a point ; les uns qu'il est dans le lieu, les autres qu'il n'y est pas ; les uns qu'il est dans le monde, les autres qu'il est hors du monde : mais que peut-on prononcer sur un être dont la substance, la nature, la forme, et le lieu sont inconnus ?
Les preuves que les dogmatiques apportent de son existence sont mauvaises ; ou l'on procede par l'évident ou par l'obscur ; par l'évident, c'est une absurdité, car si l'on conçoit ce que l'on se propose de démontrer, la démonstration ne signifie rien ; par l'obscur, c'est une impossibilité.
On ne peut ni démontrer l'existence de Dieu, ni la reconnaître par la providence, car s'il se mêlait des choses d'ici bas, il n'y aurait ni mal physique ni mal moral.
Si Dieu ne se montre point par sa providence, si l'on ne remarque point des vestiges de son existence dans quelques effets ; si on ne le conçoit ni en lui, ni par quoi que ce soit hors de lui, d'où sait-on qu'il est ?
Il faut ou nier qu'il existe, ou le rendre auteur du mal qu'il n'a point empêché, s'il l'a pu, ou le rendre impuissant, s'il s'est fait sans qu'il put l'empêcher. Le dogmatique est serré entre l'impuissance d'un côté, ou la mauvaise volonté de l'autre.
Il est vraisemblable qu'il y a cause ; car sans cause comment y aurait-il accroissement, décroissement, génération, corruption, mouvement, repos, effets. Mais d'un autre côté, on peut soutenir avec le même avantage et la même vraisemblance qu'il n'y a point de cause, car la cause ne se connait que par l'effet ; l'effet ne se conçoit que par la cause : comment sortir de ce cercle ?
D'ailleurs puisqu'il s'agit de l'existence de la cause, dès le premier pas on sera forcé de remonter à la cause de cette cause, et à la cause de celle-ci, et ainsi de suite à l'infini : or ce progrès de causes à l'infini est impossible.
Les principes matériels ne se comprennent pas davantage ; les dogmatiques en parlent d'une infinité de manières diverses ; il n'y a aucun caractère de vérité qui décide plutôt en faveur d'une opinion que d'une autre.
Le corps est incompréhensible par lui-même. Il n'est rien sans la longueur, la largeur, la profondeur, et l'impénétrabilité, et ces qualités ne sont rien sans le corps.
Voilà pour les corps simples ; l'incertitude est bien autre sur les composés. On ne sait ce que c'est que le contact, la combinaison, l'affinité, la simpathie, le mélange ; et la diversité des opinions est infiniment plus grande encore. Ceux qui assurent qu'il y a mouvement ont pour eux l'expérience ; ceux qui le nient ont pour eux la raison. Comme homme qui juge d'après les apparences, le sceptique l'admet ; comme philosophe qui demande la démonstration de tout ce qu'il admet, il le rejette.
Le raisonnement qui suit, entr'autres, suspend surtout son jugement dans la question du mouvement. S'il y a quelque chose de mu, il l'est ou de lui-même ou par un autre. S'il est mu par un autre, celui-ci le sera ou de lui-même ou par un autre, et ainsi de suite jusqu'à-ce qu'on soit arrivé à un être mu de lui-même, ce qui ne se conçoit pas.
L'accroissement, la diminution, la soustraction, la translation offrent les mêmes difficultés que le mouvement.
Le tout ne se comprend point ; car qu'est-ce que le tout, sinon l'agrégation de toutes les parties ? Toutes les parties ôtées, le tout se réduit à rien.
Mais les parties ou elles sont parties du tout, ou parties les unes des autres, ou parties d'elles-mêmes. Parties du tout, cela ne se peut, car le tout et ses parties c'est une même chose ; parties les unes des autres ou d'elles-mêmes, cela ne se peut.
Mais s'il n'y a notion certaine ni du tout ni de ses parties, il n'y aura notion certaine ni d'addition ni de soustraction, ni d'accroissement, ni de diminution, ni de corruption, ni de génération, ni d'aucun autre effet naturel.
Si la substance est fluxile, comme le prétendent les dogmatiques, et que sans-cesse il s'en échappe quelque chose, et que sans-cesse quelque chose s'y joigne, il n'y a point de corps en repos, aucun état permanent dans la substance.
Si le lieu est l'espace que le corps occupe, ou il a les dimensions mêmes du corps, ou il ne les a pas ; s'il les a, c'est la même chose que le corps ; s'il ne les a pas, le lieu et le corps sont inégaux.
Les dogmatiques ne savent ce que c'est que le lieu, l'espace et le vide, surtout s'ils distinguent le lieu du vide ; l'espace ayant des dimensions, il s'ensuit ou que des corps se pénètrent, ou que le corps est son propre espace.
A juger du temps par les apparences, c'est quelque chose ; par ce qu'en disent les dogmatiques, on ne sait plus ce que c'est.
La notion du temps est liée à celle du mouvement et du repos. Si de ces trois idées il y en a une d'incertaine, les autres le deviennent.
Le temps peut-il être triple ? Le passé et le futur ne sont pas : l'un n'est plus, l'autre n'est pas encore. Le présent s'échappe, et sa vitesse le dérobe à notre conception.
Le sceptique compte dans la société, il sait ce que c'est que nombre quand il n'en dispute pas avec les dogmatiques ; mais il ne les a pas plutôt entendus sur ce sujet, que toutes ses notions se confondent.
Lorsque les dogmatiques rapportent le bien à ce qui excite notre désir, à ce qui nous est utile, à ce qui fait notre bonheur, ils spécifient bien les effets du bien, mais ils ne désignent point ce que c'est.
Chacun a son bien particulier. Il n'y a aucun bien qui soit bien et qui le soit de la même manière pour deux individus : la notion du bien est donc aussi vague qu'aucune autre.
Le désir du bien n'est pas le bien, sans quoi nous aurions le bien que nous désirons ; ce n'est pas la chose désirée, car la chose désirée n'est en elle-même ni le bien ni le mal. Le bien n'est donc ni en nous, ni hors de nous : ce n'est donc rien.
Quand le sceptique établit entre les choses les distinctions de bien et de mal, de juste et d'injuste, il se conforme à l'usage, au-lieu que le dogmatique croit se conformer à l'évidence et à la raison.
Le sceptique est sans passion relativement à certaines choses, et très-modéré dans sa passion relativement à d'autres. Tout est affaire de convention pour lui. Il sait que ce qui est bien dans un moment et pour lui, dans le même moment est mal pour un autre, et dans le moment suivant sera mal pour lui ; que ce qui est estimé honnête ou déshonnête dans Athènes ou dans Rome, prend ailleurs le nom d'indifférent. Quoi qu'il voye, quoi qu'il entende, quoi qu'on fasse, il reste immobîle ; tout lui parait également bien ou mal, ou rien en soi.
Mais si le bien et le mal ne sont rien en soi, il n'y a plus de règle ni des mœurs ni de la vie.
La vertu est une habitude ; or on ne sait ce que c'est qu'une habitude ni en soi ni dans ses effets.
Les mots d'arts et de sciences sont pour le sceptique vides de sens. Au reste, il ne soutient ces paradoxes que pour se détacher des choses, écarter les troubles de son âme, réduire ce qui l'environne à sa juste valeur, ne rien craindre, ne rien désirer, ne rien admirer, ne rien louer, ne rien blâmer, être heureux, et faire sentir au dogmatique sa misere et sa témérité.
D'où l'on voit que le doute avait conduit le sceptique à la même conclusion que le stoïcien tenait de la nécessité.
Que ces philosophes avaient rendu à la Philosophie un service très-important en découvrant les sources réelles de nos erreurs, et en marquant les limites de notre entendement.
Qu'au sortir de leur école on devait prononcer avec beaucoup de circonspection sur les choses qu'on croyait entendre le mieux.
Que leur doctrine indiquait les objets sur lesquels nous étions dans les ténébres et que nous ne connaitrions jamais.
Qu'elle tendait à rendre les hommes indulgens les uns envers les autres, et tempérer en tous l'impétuosité des passions.
Et que la conclusion qu'on en tirait, c'est qu'il y a dans l'usage de la raison une sorte de sobriété dont on ne s'écarte point impunément.
Il n'était pas possible qu'une secte qui ébranlait tout principe, qui disait que le vice et la vertu étaient des mots sans idées, et qu'il n'y avait rien en soi de vrai et de faux, de bon et de mauvais, de bien et de mal, de juste et d'injuste, d'honnête et de déshonnête, fit de grands progrès chez aucun peuple de la terre. Le sceptique avait beau protester qu'il avait une manière de juger dans l'école et une autre dans la société, il est sur que sa doctrine tendait à avilir tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes. Nos opinions ont une influence trop immédiate sur nos actions, pour qu'on put traiter le scepticisme avec indifférence. Cette philosophie cessa promptement dans Athènes ; elle fit peu de progrès dans Rome, surtout sous les empereurs. Auguste favorisa les Stoïciens et les Péripatéticiens ; ses courtisans étaient tous épicuriens ; le superstitieux Tibere inclina pour le pythagorisme et sa divination ; Caius, Claude, et Néron ne firent aucun cas de la Philosophie et des Philosophes ; les Pythagoriciens et les Stoïciens furent en honneur à la cour de Vespasien et de Tite ; Trajan et Adrien les aimèrent tous indistinctement. Les Antonins professèrent eux-mêmes la philosophie dogmatique et stoïcienne. Julie concilia la faveur de Sévère aux Platoniciens ; il parut cependant de temps-en-temps quelques sceptiques.
On donne ce nom à Claude Ptolémée. Il est sur qu'il fit assez peu de cas de la raison et des lumières de l'entendement. Corneille Celse avait une érudition trop variée et trop superficielle pour être dogmatique. Nous ne dirons rien de Sextus Empiricus ; qui est-ce qui ne connait pas ses hypotyposes ? Sextus Empiricus était africain. Il écrivit au commencement du troisième siècle. Il eut pour disciple Saturninus, et pour sectateur Théodose Tripolite. Le sceptique Uranius parut sous le règne de Justinien.
Le Scepticisme s'assoupit depuis ce temps jusqu'en 1562, que naquit le portugais, François Sanchez. Il publia un ouvrage intitulé, de multùm nobili et primâ universali scientiâ quod nihil scitur. Ce fut une manière adroite d'attaquer l'Aristotélisme sans se compromettre. Sanchez en voulait aux erreurs qui regnaient de son temps. Jérôme Hirnhaym en voulait à toute connaissance humaine, comme il parait par le titre de son ouvrage, de tytho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac ventoso humore, difficultate, labilitate, falsitate, jactantiâ, praesumptione, incommodis et periculis, tractatus brevis, in quo etiam vera sapientia à falsa discernitur, et simplicitas mundo contempta extollitur, idiotis in solatium, doctis in cautelam conscriptus. Hirnhaym était chanoine de l'ordre de Prémontré, et abbé de Strahow en Boheme. Ce pieux sceptique poussa le doute aussi loin qu'il peut aller. Il n'y a pour lui aucun axiome de Philosophie qui soit infaillible. Il oppose la Philosophie à la Théologie, la révélation à la raison, la création à l'axiome ex nihilo nihil fit ; l'Eucharistie à l'axiome il est impossible qu'un même corps soit en plusieurs lieux à la fois ; la Trinité à l'axiome que un et un font deux, et deux et un font trois. Selon lui les apôtres qui ont vécu avec Jesus-Christ, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont touché, avec qui ils ont mangé, ne sont surs de ces faits que par la foi, et non par le témoignage de leurs sens qui a pu les tromper. Il rapporte tout à l'infaillibilité de l'Eglise : le bon homme ne s'aperçoit pas que cette proposition, l'Eglise est infaillible, ne peut jamais acquérir l'évidence qu'il refuse à celle-ci ; il est impossible qu'une chose soit et ne soit pas en même temps ; le tout est plus grand que sa partie, et autres qu'il combat de bonne foi.
Le pyrrhonien, François la Mothe le Vayer, naquit à Paris en 1586 ; c'est le Plutarque français. Il avait beaucoup lu et beaucoup réfléchi. Il est sceptique dans son Horatius Tuberon, cynique dans son Hexameron rustique. Libre dans ses écrits et sévère dans ses mœurs, c'est un des exemples à objecter à ceux qui se hâtent de juger des actions des hommes par leurs discours.
Pierre-Daniel Huet marcha sur les traces de la Mothe le Vayer, et se montra parmi nous un très-hardi contempteur de la raison.
Huet naquit à Caèn en 1630, ce fut un des hommes les plus savants que nous ayons eu ; les Lettres, la Philosophie, les Mathématiques, l'Astronomie, la Poésie, les langues hébraïque, grecque et latine, l'érudition, toutes les connaissances lui furent presque également familières. Il eut les liaisons les plus étroites avec la plupart des grands hommes de son siècle, Petau, Labbé, Cossart, Bochart, Vavassor, et Rapin. Il inclina de bonne heure au scepticisme, prenant la force de son esprit qu'il trouvait souvent au-dessous des difficultés des questions, pour la mesure de l'étendue de l'esprit humain ; ce en quoi il y avait bien peu d'hommes à qui il faisait injustice, il en concluait au dedans de lui-même, que nous ne sommes pas destinés à connaître la vérité. De jour en jour ce préjugé secret se fortifiait en lui, et il ne connut peut-être qu'il était sceptique, qu'au moment où il écrivit son ouvrage de la faiblesse de l'entendement humain. On arrive au Pyrrhonisme par deux voies tout à fait opposées, ou parce qu'on ne sait pas assez, ou parce qu'on sait trop. Huet suivit la dernière, et ce n'est pas la plus commune.
Mais parmi les sectateurs du Pyrrhonisme, nous avons oublié Michel de Montagne, l'auteur de ces essais qui seront lus tant qu'il y aura des hommes qui aimeront la vérité, la force, la simplicité. L'ouvrage de Montagne est la pierre de touche d'un bon esprit. Prononcez de celui à qui cette lecture déplait, qu'il a quelque vice de cœur ou d'entendement ; il n'y a presqu'aucune question que cet auteur n'ait agitée pour et contre, et toujours avec le même air de persuasion. Les contradictions de son ouvrage, sont l'image fidèle des contradictions de l'entendement humain. Il suit sans art l'enchainement de ses idées ; il lui importe fort peu d'où il parte, comment il aille, ni où il aboutisse. La chose qu'il dit, c'est celle qui l'affecte dans le moment. Il n'est ni plus lié, ni plus décousu en écrivant, qu'en pensant ou en rêvant. Or il est impossible que l'homme qui pense ou qui rêve, soit tout à fait décousu. Il faudrait qu'un effet put cesser sans cause, et qu'un autre effet put commencer subitement et de lui-même. Il y a une liaison nécessaire entre les deux pensées les plus disparates ; cette liaison est, ou dans la sensation, ou dans les mots, ou dans la mémoire, ou au dedans, ou au dehors de l'homme. C'est une règle à laquelle les fous mêmes sont assujettis dans leur plus grand désordre de raison. Si nous avions l'histoire complete de tout ce qui se passe en eux, nous verrions que tout y tient, ainsi que dans l'homme le plus sage et le plus sensé. Quoique rien ne soit si varié que la suite des objets qui se présentent à notre Philosophe, et qu'ils semblent amenés par le hasard, cependant ils se touchent tous d'une ou d'autre manière ; et quoi qu'il y ait bien loin de la matière des coches publics, à la harangue que les Mexiquains firent aux Européens, quand ils mirent le pied pour la première fois dans le nouveau monde, cependant on arrive de Bordeaux à Cusco sans interruption ; mais à la vérité, par de bien longs détours. Chemin faisant, il se montre sous toutes sortes de faces, tantôt bon, tantôt dépravé, tantôt compatissant, tantôt vain, tantôt incrédule, tantôt superstitieux. Après avoir écrit avec force contre la vérité des miracles, il fera l'apologie des augures ; mais quelque chose qu'il dise, il intéresse et il instruit. Mais le Scepticisme n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes, aucun athlete plus redoutable que Bayle.
Bayle naquit dans l'année 1647. La nature lui donna l'imagination, la force, la subtilité, la mémoire, et l'éducation, tout ce qui peut contribuer à faire sortir les qualités naturelles. Il apprit les langues grecque et latine ; il se livra de bonne heure et presque sans relâche à toutes sortes de lectures et d'études. Plutarque et Montagne furent ses auteurs favoris. Ce fut-là qu'il prit ce germe de Pyrrhonisme, qui se développa dans la suite en lui d'une manière si surprenante. Il s'occupa de la dialectique avant vingt ans. Il était bien jeune encore, lorsqu'il fit connaissance avec un ecclésiastique, qui profitant des incertitudes dans lesquelles il flottait, lui prêcha la nécessité de s'en rapporter à quelque autorité qui nous décidât, et le détermina à abjurer publiquement la religion qu'il avait reçue de ses parents. A peine eut-il fait ce pas, que l'esprit de proselitisme s'empara de lui. Bayle qui s'est tant déchainé contre les convertisseurs, le devint ; et il ne tint pas à lui qu'il n'inspirât à ses frères, à ses parents et à ses amis, les sentiments qu'il avait adoptés. Mais son frère, qui n'était pas un homme sans mérite, et qui exerçait les fonctions de ministre parmi les réformés, le ramena au culte de sa famille. Le Catholicisme n'eut point à s'affliger, ni le Protestantisme à se glorifier de ce retour. Bayle ne tarda pas à connaître la vanité de la plupart des systèmes religieux, et à les attaquer tous, sous prétexte de défendre celui qu'il avait embrassé. Le séjour de la France l'eut exposé aux persécutions, il se retira à Geneve. Ce fut-là, que passant d'une première abjuration à une seconde, il quitta l'Aristotélisme pour le Cartésianisme, mais avec aussi peu d'attachement à l'une de ces doctrines, qu'à l'autre ; car on le vit dans la suite, opposer les sentiments des Philosophes les uns aux autres, et s'en jouer également. Nous ne pouvons nous empêcher de regretter ici le temps qu'il perdit à deux éducations dont il se chargea successivement. Celui qu'il passa à professer la Philosophie à Sedan, ne fut guère mieux employé. Ce fut dans ces circonstances que Poiret publia son ouvrage sur Dieu, sur l'âme et sur le mal. Bayle proposa ses difficultés à l'auteur ; celui-ci répondit, et cette controverse empoisonna la vie de l'un et de l'autre. Bayle traduisit Poiret comme un fou, et Poiret, Bayle comme un athée ; mais on est fou et non athée impunément. Poiret aimait la Bourignon ; Bayle disait que la Bourignon était une mauvaise cervelle de femme troublée ; et Poiret, que Bayle était un fauteur secret du Spinosisme. Poiret soupçonnait Bayle d'avoir excité la sévérité des magistrats contre la Bourignon, et il se vengeait par une accusation qui compromettait à leurs yeux son adversaire d'une manière beaucoup plus dangereuse. La Bourignon eut peut-être été renfermée, mais Bayle eut été brulé. Le principe de Descartes qui constitue l'essence du corps dans l'étendue, l'engagea dans une autre dispute. En 1681, parut cette comete fameuse par sa grandeur, et plus peut-être encore par les pensées de Bayle, ouvrage où, à l'occasion de ce phénomène, et des terreurs populaires dont il était accompagné, notre philosophe agite les questions les plus importantes, sur les miracles, sur la nature de Dieu, sur la superstition. Il s'occupa ensuite à l'examen de l'histoire du Calvinisme, que Mainbourg avait publiée. Mainbourg même louait son ouvrage. Le grand Condé ne dédaigna pas de le lire ; tout le monde le dévorait et le gouvernement le faisait bruler. Il commença en 1684 sa république des Lettres. Engagé par ce genre de travail à lire toutes sortes d'ouvrages, à approfondir les matières les plus disparates, à discuter des questions de Mathématiques, de Philosophie, de Physique, de Théologie, de Jurisprudence, d'histoire ; quel champ pour un pyrrhonien ! Le théosophe Malebranche parut alors sur la scène. Entre un grand nombre d'opinions qui lui étaient particulières, il avait avancé que toute volupté était bonne. Arnaud crut voir dans cette maxime le renversement de la morale, et l'attaqua. Bayle intervint dans cette querelle, expliqua les termes, et disculpa Malebranche de l'accusation d'Arnaud. Il lui était déjà échappé dans quelques autres écrits, des principes favorables à la tolérance : il s'expliqua nettement sur ce sujet important, dans son commentaire philosophique. Cet ouvrage parut par parties. Il plut d'abord également à tous les partis ; il mécontenta ensuite les Catholiques, et continua de plaire aux Réformés ; puis il mécontenta également les uns et les autres, et ne conserva d'approbateurs constants, que les Philosophes : cet ouvrage est un chef d'œuvre d'éloquence. Nous ne pouvons cependant dissimuler qu'il avait été précédé d'une brochure, intitulée, Junii Bruti, poloni, vindiciae pro libertate religionis, qui contient en abrégé tout ce que Bayle a dit. Si Bayle n'est pas l'auteur de ce discours anonyme, sa gloire se réduit à en avoir fait un commentaire excellent. Il y avait longtemps que le ministre Jurieu était jaloux de la réputation de Bayle. Il croyait avoir des raisons particulières de s'en plaindre. Il regardait ses principes sur la tolérance, comme propres à inspirer l'indifférence en fait de religion. Il était dévoré d'une haine secrète, lorsque l'avis important aux réfugiés sur leur retour prochain en France, ouvrage écrit avec finesse, où l'on excusait les vexations que la cour de France avait ordonnées contre les Protestants, et où la conduite de ces transfuges n'était pas montrée sous un coup d'oeil bien favorable, excita dans toutes les églises réformées le plus grand scandale. On chercha à en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui à Pelisson. Jurieu persuada à tout le monde qu'il était de Bayle, et cette imputation pensa le perdre. Bayle avait formé depuis longtemps le plan de son dictionnaire historique et critique. Les disputes dans lesquelles il avait misérablement vécu, commençant à s'apaiser, il s'en occupa nuit et jour, et il en publia le premier volume en 1697. On connaissait son esprit, ses talents, sa dialectique, on connut alors l'immensité de son érudition, et son penchant décidé au Pyrrhonisme. En effet, quelles sont les questions de Politique, de Littérature, de Critique, de Philosophie ancienne et moderne, de Théologie, d'Histoire, de Logique et de Morale, qui n'y soient examinées pour et contre ? C'est-là qu'on le voit semblable au Jupiter d'Homère qui assemble les nuages ; au milieu de ces nuages on erre étonné et désespéré. Tout ce que Sextus Empiricus et Huet disent contre la raison, l'un dans ses hypotyposes, l'autre dans son traité de la faiblesse de l'entendement humain, ne vaut pas un article choisi du dictionnaire de Bayle. On y apprend bien mieux à ignorer ce que l'on croit savoir. Les ouvrages dont nous venons de rendre compte, ne sont pas les seuls que cet homme surprenant ait écrit ; et cependant il n'a vécu que cinquante-neuf ans : il mourut en Janvier 1706.
Bayle eut peu d'égaux dans l'art de raisonner, peut-être point de supérieur. Personne ne sut saisir plus subtilement le faible d'un système, personne n'en sut faire valoir plus fortement les avantages ; redoutable quand il prouve, plus redoutable encore quand il objecte : doué d'une imagination gaie et féconde, en même temps qu'il prouve, il amuse, il peint, il séduit. Quoiqu'il entasse doute sur doute, il marche toujours avec ordre : c'est un polype vivant qui se divise en autant de polypes qui vivent tous ; il les engendre les uns des autres. Quelle que soit la thèse qu'il ait à prouver, tout vient à son secours, l'histoire, l'érudition, la philosophie. S'il a la vérité pour lui, on ne lui résiste pas ; s'il parle en faveur du mensonge, il prend sous sa plume toutes les couleurs de la vérité : impartial ou non, il le parait toujours ; on ne voit jamais l'auteur, mais la chose.
Quoi qu'on dise de l'homme de lettres, on n'a rien à reprocher à l'homme. Il eut l'esprit droit et le cœur honnête ; il fut officieux, sobre, laborieux, sans ambition, sans orgueil, ami du vrai, juste, même envers ses ennemis, tolérant, peu dévot, peu crédule, on ne peut moins dogmatique, gai, plaisant, conséquemment peu scrupuleux dans ses récits, menteur comme tous les gens d'esprit, qui ne balancent guère à supprimer ou à ajouter une circonstance légère à un fait, lorsqu'il en devient plus comique ou plus intéressant, souvent ordurier. On dit que Jurieu ne commença à être si mal avec lui, qu'après s'être aperçu qu'il était trop bien avec sa femme ; mais c'est une fable qu'on peut sans injustice croire ou ne pas croire de Bayle, qui s'est complu à en accréditer un grand nombre de pareilles. Je ne pense pas qu'il ait jamais attaché grand prix à la continence, à la pudeur, à la fidélité conjugale, et à d'autres vertus de cette classe ; sans quoi il eut été plus réservé dans ses jugements. On a dit de ses écrits, quamdiu vigebunt, lis erit ; et nous finirons son histoire par ce trait.
Il suit de ce qui précède que les premiers sceptiques ne s'élevèrent contre la raison que pour mortifier l'orgueil des dogmatiques ; qu'entre les sceptiques modernes, les uns ont cherché à décrier la philosophie, pour donner de l'autorité à la révélation ; les autres, pour l'attaquer plus surement, en ruinant la solidité de la base sur laquelle il faut l'établir, et qu'entre les sceptiques anciens et modernes, il y en a quelques-uns qui ont douté de bonne foi, parce qu'ils n'apercevaient dans la plupart des questions que des motifs d'incertitude.
Pour nous, nous conclurons que tout étant lié dans la nature, il n'y a rien, à proprement parler, dont l'homme ait une connaissance parfaite, absolue, complete , pas même des axiomes les plus évidents, parce qu'il faudrait qu'il eut la connaissance de tout.
Tout étant lié, s'il ne connait pas tout, il faudra nécessairement que de discussions en discussions, il arrive à quelque chose d'inconnu : donc en remontant de ce point inconnu, on sera fondé à conclure contre lui ou l'ignorance, ou l'obscurité, ou l'incertitude du point qui précède, et de celui qui précède celui-ci, et ainsi jusqu'au principe le plus évident.
Il y a donc une sorte de sobriété dans l'usage de la raison, à laquelle il faut s'assujettir, ou se résoudre à flotter dans l'incertitude ; un moment où sa lumière qui avait toujours été en croissant, commence à s'affoiblir, et où il faut s'arrêter dans toutes discussions.
Lorsque de conséquences en conséquences, j'aurai conduit un homme à quelque proposition évidente, je cesserai de disputer. Je n'écouterai plus celui qui niera l'existence des corps, les règles de la logique, le témoignage des sens, la distinction du vrai et du faux, du bien et du mal, du plaisir et de la peine, du vice et de la vertu, du décent et de l'indécent, du juste et de l'injuste, de l'honnête et du déshonnête. Je tournerai le dos à celui qui cherchera à m'écarter d'une question simple, pour m'embarquer dans des dissertations sur la nature de la matière, sur celle de l'entendement, de la substance, de la pensée, et autres sujets qui n'ont ni rive ni fond.
L'homme un et vrai n'aura point deux philosophies, l'une de cabinet et l'autre de société ; il n'établira point dans la spéculation des principes qu'il sera forcé d'oublier dans la pratique.
Que dirai-je à celui qui prétendant que, quoi qu'il voye, quoi qu'il touche, qu'il entende, qu'il aperçoive, ce n'est pourtant jamais que sa sensation qu'il aperçoit : qu'il pourrait avoir été organisé de manière que tout se passât en lui, comme il s'y passe, sans qu'il y ait rien au-dehors, et que peut-être il est le seul être qui soit ? Je sentirai tout-à-coup l'absurdité et la profondeur de ce paradoxe ; et je me garderai bien de perdre mon temps à détruire dans un homme une opinion qu'il n'a pas, et à qui je n'ai rien à opposer de plus clair que ce qu'il nie. Il faudrait pour le confondre, que je pusse sortir de la nature, l'en tirer, et raisonner de quelque point hors de lui et de moi, ce qui est impossible. Ce sophiste manque du moins à la bienséance de la conversation, qui consiste à n'objecter que des choses auxquelles on ajoute soi-même quelque solidité. Pourquoi m'époumonerai-je à dissiper un doute que vous n'avez pas ? Mon temps est-il de si peu de valeur à vos yeux ? En mettez-vous si peu au vôtre ? N'y a-t-il plus de vérités à chercher ou à éclaircir ? Occupons-nous de quelque chose de plus important ; ou si nous n'avons que de ces frivolités présentes, dormons et digérons.
PYRRHONIENN
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Philosophie
- Affichages : 2616