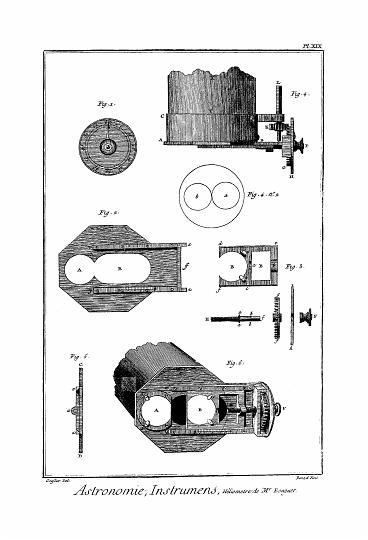S. f. (Métaphysique) M. Locke définit la connaissance la perception de la liaison et convenance, ou de l'opposition et disconvenance qui se trouve entre deux de nos idées : par-tout où se trouve cette perception, il y a de la connaissance ; et où elle n'est pas, nous ne saurions parvenir à la connaissance.
On peut réduire cette convenance ou disconvenance à ces quatre espèces, selon M. Locke : 1°. identité ou diversité ; 2°. relation ; 3°. coexistence ; 4°. existence réelle : et pour ce qui est de la première espèce de convenance ou de disconvenance, qui est l'identité ou la diversité, le premier pas que fait l'esprit humain dans la connaissance de la vérité, c'est d'apercevoir les idées qu'il a, et de voir ce que chacune est en elle-même ; et par conséquent de connaître qu'une idée n'est pas l'autre, quand ces deux idées sont différentes. Ces premières connaissances s'acquièrent sans peine, sans effort, sans faire aucune déduction, et dès la première vue, par la puissance naturelle que nous avons d'apercevoir et de distinguer les choses.
Mais en quoi consiste la convenance ou l'identité d'une idée avec une autre ? Elle consiste en ce qu'un objet de notre pensée formé par un acte de notre esprit, soit le même qu'un objet formé par un autre acte de notre esprit, en sorte que l'esprit ne trouve nulle différence entre l'objet formé par ces deux actes. Par exemple, si l'objet de ma pensée est le nombre deux, et que par un autre acte de mon esprit l'objet de ma pensée se trouve encore le nombre deux ; je connais que deux est deux : voilà le premier pas, et l'exercice le plus simple dont notre esprit soit capable dans l'action de penser.
Lorsque mon esprit par un second acte me représente un objet différent de l'objet représenté par le premier, alors je juge que l'un n'est pas l'autre. Par exemple, si dans le second acte je me représente le nombre trois, après m'être représenté par le premier acte le nombre deux ; je juge que le nombre trois n'est pas le nombre deux, comme le nombre deux n'est pas le nombre trois.
Cette connaissance, qu'un objet est ce qu'il est, est le principe de toute connaissance réflexive de Logique, et elle renferme la lumière la plus vive dont notre esprit soit capable : toute autre évidence ou certitude de Logique se trouvera avoir d'autant plus ou d'autant moins de certitude et d'évidence, qu'elle approchera plus ou moins de cette première certitude ou évidence, qu'un objet est ce qu'il est, et n'est pas un autre. Cette connaissance est appelée intuitive, parce qu'elle se forme du premier et du plus simple regard de l'esprit.
M. Locke ne me parait pas exact, quand il apporte pour exemple de connaissance intuitive que trois est plus que deux, et trois est égal à deux et un. Il semble qu'il y a quelque chose de plus intime ou de plus immédiat à l'esprit que ces deux connaissances, savoir que trois est trois, et que trois n'est pas deux. Cette différence semble imperceptible, mais elle n'en est pas moins réelle.
Cette proposition, trois n'est point deux, énonce seulement que trois et deux ne sont point la même pensée, et elle n'énonce que cela : la proposition trois est plus que deux, énonce de plus par quel endroit l'objet deux n'est point l'objet trois, en indiquant que pour égaler deux à trois, il faudrait ajouter une unité à deux, ou en retrancher une à trois. Or c'est-là une circonstance ou modification qui ne se trouve point dans la première proposition ; trois n'est point deux.
De même encore il se trouve quelque différence entre dire trois est trois, et trois est égal à deux et un. Dans le premier jugement, l'esprit en deux perceptions aperçoit également pour objet de l'une et de l'autre le nombre trois, et se dit simplement, l'objet de mes deux perceptions est le même : au lieu qu'en disant trois est égal à deux et un, l'objet de ces deux perceptions, savoir trois, puis deux et un, n'est plus tout à fait et précisément le même. La seconde perception représente séparé en deux ce qui est réuni dans la première. J'avoue que cette modification de trois considéré comme séparé en deux est un, est si imperceptible, que l'esprit voit presqu'aussi-tôt que trois est deux et un, qu'il voit que trois est trois. Mais quelque imperceptible qu'elle sait, elle fait la différence essentielle entre les propositions identiques et les propositions logiques. Les propositions identiques ne sont autres que celles qui expriment une connaissance intuitive, par laquelle notre esprit, dans les deux perceptions, trouve également en l'une et en l'autre précisément le même objet, sans aucune ombre de modification d'un côté qui ne soit pas de l'autre côté. Ainsi trois est trois fait une proposition identique, qui exprime une connaissance intuitive ; au lieu que trois est égal à deux et un, fait une proposition qui n'est plus identique, mais conjonctive et logique, parce qu'il se trouve dans celle-ci une modification qui n'est pas dans l'autre.
A mesure que ces sortes de modifications surviennent à la connaissance intuitive, à mesure aussi se forme une connaissance conjonctive plus composée, et par conséquent plus obscure, étant plus éloignée de la simplicité de la connaissance intuitive. En effet, l'esprit alors est plus occupé pour découvrir certains endroits par lesquels deux idées soient les mêmes, tandis qu'elles sont différentes par d'autres endroits : or ces endroits sont justement les idées des modifications survenues à la connaissance intuitive. Ce sont aussi ces endroits qu'il faut écarter, ou du moins auxquels il ne faut point avoir d'égard, pour découvrir et retrouver pleinement dans la connaissance conjonctive, l'identité ou ressemblance d'idées qui fait la connaissance intuitive. Ainsi pour retrouver la connaissance intuitive dans cette proposition, l'homme est animal, j'écarte de l'idée totale de l'homme les idées partiales, qui sont de surérogation à l'idée totale d'animal ; telles que l'idée de capable d'admiration, l'idée de raisonnable, etc. et alors il ne reste plus dans l'idée d'homme, que les idées de végétal, vivant, etc. qui forment l'idée d'animal, et qui sont communes à l'idée d'homme et à l'idée d'animal.
Ces réflexions aussi vraies que subtiles, sont tirées de la logique du P. Buffier.
La seconde sorte de convenance ou de disconvenance que l'esprit aperçoit dans quelqu'une de ses idées, peut être appelée relative ; et ce n'est que la perception du rapport qui est entre deux idées, de quelque espèce qu'elles soient, substances, modes, ou autres. Ainsi deux est deux, trois est trois, ont un rapport de convenance, parce que dans ces deux propositions c'est le même objet formé par deux actes de l'esprit : toute la différence qui se trouve entre la convenance d'identité et la convenance de relation, c'est que l'une est une identité numérique, et l'autre une identité spécifique ou de ressemblance. La première se trouve marquée dans cette proposition, le cercle A est le cercle A ; et la seconde dans celle-ci, le cercle A est le même que le cercle B.
La troisième espèce de convenance ou de disconvenance, qu'on peut trouver dans nos idées, et sur laquelle s'exerce la perception de notre esprit, c'est la coexistence, ou la non-coexistence dans le même sujet ; ce qui regarde particulièrement les substances. Ainsi quand nous affirmons touchant l'or, qu'il est fixe, la connaissance que nous avons de cette verité se réduit uniquement à ceci, que la fixité ou la puissance de demeurer dans le feu sans se consumer, est une idée qui se trouve toujours jointe avec cette espèce particulière de jaune, de pesanteur, de fusibilité, de malléabilité, et de capacité d'être dissous dans l'eau régale, qui compose notre idée complexe, que nous désignons par le mot or.
La dernière et quatrième espèce de convenance, c'est celle d'une existence actuelle et réelle, qui convient à quelque chose dont nous avons l'idée dans l'esprit. Toutes nos connaissances sont renfermées dans ces quatre sortes de convenance ou de disconvenance.
Avant d'examiner les différents degrés de notre connaissance, il ne sera pas hors de propos de parler des divers sens du mot de connaissance. Il y a différents états dans lesquels l'esprit se trouve imbu de la vérité, et auxquels on donne le nom de connaissance.
1°. Il y a une connaissance actuelle qui est la perception présente, que l'esprit a de la convenance, ou de la disconvenance de quelqu'une de ses idées, ou du rapport qu'elles ont l'une à l'autre.
2°. On dit qu'un homme connait une proposition, lorsque cette proposition ayant été une fois présente à son esprit, il a aperçu évidemment la convenance ou la disconvenance des idées dont elle est composée, et qu'il l'a placée de telle manière dans sa mémoire, que toutes les fois qu'il vient à réfléchir sur cette proposition, il la voit par le bon côté, sans douter ni hésiter le moins du monde ; c'est ce qu'on appelle connaissance habituelle. Suivant cela, on peut dire d'un homme, qu'il connait toutes les vérités, dont sa mémoire conserve le précieux dépôt, en vertu d'une pleine et évidente perception qu'il en a eue auparavant, et sur laquelle l'esprit se repose hardiment sans avoir le moindre doute ; que s'il n'en a pas une perception actuelle, du moins il a un sentiment intime d'avoir eu cette perception. En effet, nos lumières étant aussi bornées qu'elles le sont, et notre perception actuelle ne pouvant s'étendre qu'à peu de choses à-la-fais, si nous ne connaissions que ce qui est l'objet actuel de nos pensées, nous serions tous extrêmement ignorants, et nous ne pourrions nullement étendre nos connaissances.
Il y a aussi deux degrés de connaissance habituelle.
L'un regarde ces vérités mises comme en réserve dans la mémoire qui ne se présentent pas plutôt à l'esprit qu'il voit le rapport qui est entre ces idées : ce qui se rencontre dans toutes les vérités dont nous avons une connaissance intuitive.
Le deuxième degré de connaissance habituelle appartient à ces vérités, dont l'esprit ayant été une fois convaincu, conserve le souvenir de la conviction sans en retenir les preuves. Ainsi un homme qui se souvient certainement qu'il a démontré que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits, est assuré qu'il connait la vérité de cette proposition, parce qu'il ne saurait en douter. Il ne faut pas s'imaginer que cette croyance, qu'on donne plus à la mémoire qu'à la perception de la vérité même, soit une connaissance mêlée de quelques nuages, et qui tienne le milieu entre l'opinion et la certitude. Cette connaissance renferme une parfaite certitude. Ce qui d'abord pourrait nous faire illusion ; c'est que l'on n'a pas une perception actuelle de toutes les idées intermédiaires, par le moyen desquelles on avait rapproché les idées contenues dans la proposition lorsqu'on se la démontra pour la première fais. Par exemple, dans cette proposition, les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits ; quiconque a Ve et aperçu clairement la démonstration de cette vérité, connait que cette proposition est véritable, lors même que la démonstration lui est échappée de l'esprit, qu'il ne la voit plus, et qu'il ne peut se la rappeler ; mais il le connait d'une autre manière qu'il ne faisait auparavant. C'est par l'intervention d'autres idées, que celles qui avaient accompagné sa démonstration, qu'il aperçoit la convenance des deux idées qui sont jointes dans la proposition. L'immutabilité des mêmes rapports entre les mêmes choses immuables, est présentement l'idée qui fait voir que si les trois angles d'un triangle ont été une fois égaux à deux droits, ils ne cesseront jamais de l'être, parce que les essences des choses sont éternelles et immuables.
C'est sur ce fondement que dans les Mathématiques les démonstrations particulières fournissent des connaissances générales. En effet, si la connaissance n'était pas si fort établie sur cette perception, que les mêmes idées doivent toujours avoir les mêmes rapports, il ne pourrait y avoir aucune connaissance de propositions générales dans les Mathématiques : car nulle démonstration mathématique ne serait que particulière ; et lorsqu'un homme aurait démontré une proposition touchant un triangle ou un cercle, sa connaissance ne s'étendrait point au-delà de cette figure particulière. Personne ne niera que M. Newton ne connut certainement que cette suite de propositions, qu'il avait liées et enchainées, ne fût véritable, quoiqu'il n'eut pas actuellement devant les yeux cette chaîne admirable d'idées moyennes, par lesquelles il en avait découvert la vérité. Mais parce que le simple souvenir n'est pas toujours si clair que la perception actuelle ; et que par succession de temps elle déchait plus ou moins, dans la plupart des hommes ; il me semble qu'il en résulte nécessairement que la connaissance démonstrative n'a pas la même vivacité d'évidence que la connaissance intuitive, comme nous l'allons voir.
On ne peut nier que l'évidence n'ait différents degrés ; et cette différence de clarté que je confonds ici avec l'évidence, consiste dans la différente manière dont notre esprit aperçoit la convenance ou la disconvenance de ses propres idées. Car si nous réfléchissons sur notre manière de penser, nous trouverons que quelquefois l'esprit aperçoit la convenance ou la disconvenance des deux idées, immédiatement par elles-mêmes, sans l'intervention d'aucune autre ; c'est-là ce qu'on appelle connaissance intuitive. L'esprit ne fait aucun effort pour saisir une telle vérité ; il l'aperçoit comme l'oeil voit la lumière. Cette connaissance est la plus claire et la plus certaine dont la faiblesse humaine soit capable. Elle agit d'une manière irrésistible, semblable à l'éclat d'un beau jour, elle se fait voir immédiatement, et comme par force, dès que l'esprit se tourne vers elle, sans qu'il lui soit possible de se soustraire à ses rayons qui le percent de toutes parts. C'est-là le plus haut degré de certitude où nous puissions prétendre. La certitude dépend si fort de cette intuition, que dans le degré suivant de connaissance, que je nomme démonstration, cette intuition est absolument nécessaire dans toutes les connexions des idées moyennes ; de sorte que sans elle nous ne saurions parvenir à aucune connaissance ou certitude.
Il se présente ici une question, savoir si parmi les connaissances intuitives l'une est plus aisée à former que l'autre. Il ne parait pas d'abord que cela puisse se faire ; car la connaissance intuitive ne consistant qu'à découvrir d'une simple vue, telle chose est telle chose, toutes les connaissances intuitives devraient, ce me semble, être également aisées à former.
Il est vrai, qu'il est également aisé de voir le rapport qu'a une chose avec celle qui est la même en ressemblance ; c'est-à-dire, à trouver une parfaite ressemblance entre deux actes de notre esprit, qui ont précisément le même objet : mais certain objet est plus aisé à découvrir que l'autre ; et un objet simple s'aperçoit plus aisément qu'un objet composé.
Lorsque deux tableaux représentent parfaitement le même objet, si l'objet de ces deux tableaux n'est qu'un seul personnage, je verrai plus aisément que les deux tableaux représentent le même sujet, que si l'objet dans les deux tableaux était composé de différents personnages : la facilité ou la difficulté ne tombe donc pas sur l'identité de rapport entre l'un et l'autre, mais sur la multiplicité des objets partiaux dont est composé chaque objet total. L'objet total ne pouvant s'apercevoir d'une simple vue, demande en quelque sorte autant d'attentions différentes de l'esprit, qu'il se trouve d'objets partiaux d'un côté ; entre chacun desquels il faut voir le rapport avec chacun des objets partiaux qui sont de l'autre côté.
La connaissance démonstrative et de raisonnement consiste dans la ressemblance, ou identité d'idées que l'esprit aperçoit en deux objets, dans l'un desquels se trouve quelque modification d'idées qui ne sont pas dans l'autre : au lieu que s'il ne se trouvait ni dans l'un ni dans l'autre, nulle modification d'idées, ou nulle idée particulière différente, alors la connaissance serait intuitive, et non pas seulement démonstrative ou conjonctive, quoique la démonstrative supposant l'intuitive, doive la renfermer par certain endroit. Lors donc que dans un des deux objets il se trouve quelque modification d'idées qui ne sont pas dans l'autre, l'esprit a quelquefois besoin, pour apercevoir leur convenance ou leur disconvenance, de l'intervention d'une ou de plusieurs autres idées ; et c'est ce que nous appelons raisonner ou démontrer. Ces idées qu'on fait intervenir pour montrer la convenance des deux autres, on les nomme des preuves, et c'est de la facilité qu'on a à trouver ces idées moyennes qui montrent la convenance ou la disconvenance de deux autres idées, que dépend la sagacité de l'esprit.
Cette espèce de connaissance ne frappe pas si vivement ni si fortement les esprits, que la connaissance intuitive. Elle ne s'acquiert que par ceux qui s'appliquent fortement et sans relâche, qui envisagent leur objet par toutes ses faces, et qui s'engagent dans une certaine progression d'idées, dont tout le monde n'est pas capable de suivre le fil aussi longtemps qu'il est nécessaire pour découvrir la vérité.
Une autre différence qu'il y a entre la connaissance intuitive et la connaissance démonstrative, c'est qu'encore qu'il ne reste aucun doute dans cette dernière, lorsque par l'intervention des idées moyennes on aperçoit une fois la convenance ou la disconvenance des idées qu'on considère, il y en avait avant la démonstration ; ce qui dans la connaissance intuitive ne peut arriver à un esprit attentif. Il est vrai que la perception qui est produite par voie de démonstration, est aussi fort claire : mais cette évidence est bien différente de cette lumière éclatante qui sort de la connaissance intuitive. Cette première perception, qui est produite par voie de démonstration, peut être comparée à l'image d'un visage réflechi par plusieurs miroirs de l'un à l'autre. Aussi longtemps qu'elle conserve de la ressemblance avec l'objet, elle produit de la connaissance, mais toujours en perdant, à chaque réflexion successive, quelque partie de cette parfaite clarté qui est dans la première image, jusqu'à ce qu'enfin après avoir été éloignée plusieurs fois elle devient fort confuse, et n'est plus d'abord si reconnaissable, et surtout à des yeux faibles. Il en est de même à l'égard de la connaissance qui est produite par une longue suite de preuves. Quand les conséquences sont si fort éloignées du principe dont on les tire, il faut avoir une certaine étendue de génie pour trouver le nœud des objets qui paraissent desunis ; pour saisir d'un coup-d'oeil tous les rameaux des choses ; pour les réunir à leur source et dans un centre commun, et pour les mettre sous un même point de vue. Or cette disposition est extrêmement rare, et par conséquent aussi le nombre de ceux qui peuvent saisir des démonstrations compliquées, et remonter des conséquences jusqu'aux principes.
Mais pourquoi certaines conséquences sont-elles plus éloignées que d'autres du principe, dont on les tire toutes ?
Voici sur cela les raisonnements du père Buffier. Il suppose d'abord que le principe est une connaissance dont on tire une autre connaissance, qu'on appelle conséquence. Une première connaissance, dit-il, sert de principe à une seconde connaissance qui en est la conséquence, quand l'idée de la première contient l'idée de la seconde ; en sorte qu'il se trouve entre l'une et l'autre une idée commune, ou semblable, ou la même idée. Cependant la première connaissance renferme outre cette idée commune, d'autres idées particulières ou circonstances et modifications d'idées, lesquelles ne se trouvent pas dans la seconde connaissance : or plus la première, qui sert de principe, renferme de ces idées particulières différentes de l'idée qui est commune au principe et à la conséquence, plus aussi la conséquence est éloignée : moins elle est chargée de ces idées particulières, et moins la conséquence est éloignée.
Ce qui unit donc la conséquence au principe, c'est une idée commune à l'un et à l'autre : mais cette idée commune est enveloppée, dans le principe, de modifications, parmi lesquelles il est plus difficîle dans les conséquences éloignées, de reconnaître et de démêler cette idée commune ; au lieu que dans les conséquences prochaines, l'idée commune n'est accompagnée dans le principe, que d'un petit nombre de modifications particulières qui la laissent plus aisément discerner. Une épingle ne se trouve pas aussi facilement dans un tas de foin, que dans une boite où il n'y aura que cette épingle avec une aiguille ; quoique l'épingle soit aussi véritablement dans le tas de foin, que dans l'enceinte de la boite.
On voit aussi plus facilement la ressemblance qu'une figure représentée seule dans un tableau, peut avoir avec la même figure représentée dans un second tableau, lorsque dans le premier tableau elle n'est point accompagnée de diverses autres figures, parmi lesquelles il faudrait plus de soin et d'attention à la reconnaître : la multiplicité d'objets dont un objet particulier est environné, l'empêche d'être aperçu lui-même si aisément et si distinctement.
Quoi qu'il en sait, une conséquence qui ne diffère de son principe que par une ou deux circonstances ou idées particulières, lui ressemble bien plus qu'une connaissance qui en diffère par cinq ou six circonstances. Celle qui ne diffère que par une ou deux circonstances, sera la conséquence immédiate ou prochaine ; et celle qui diffère par cinq ou six circonstances, sera une conséquence plus éloignée.
Si je dis, par exemple, cet homme use de finesses, donc il mérite punition ; cette conséquence mérite punition, est par un endroit la même idée que son principe, il use de finesses. Mais le principe est revêtu de diverses circonstances qui empêchent que l'identité ou ressemblance d'idées ne soit reconnue d'abord. On reconnaitra cette identité ou ressemblance, en écartant peu-à-peu les circonstances qui font differer le principe de la conséquence. Découvrant ainsi peu-à-peu l'identité des idées, c'est-à-dire l'idée commune qui se trouve des deux côtés, je dirai, 1°. un homme qui use de finesses se prévaut de l'inattention d'autrui : 2°. celui qui se prévaut de l'inattention d'autrui agit par surprise : 3°. agissant par surprise, il abuse de leur bonne foi : 4°. abusant de leur bonne foi il les trompe : 5°. les trompant il est coupable : 6°. étant coupable il mérite punition.
Il est aisé d'apercevoir comment un homme qui use de finesses, et un homme qui se prévaut de l'inattention des autres, est la même idée, à peu de circonstances près ; de sorte qu'en certaines occasions on leur donne le même nom : cependant le terme homme qui use de finesses, renferme quelques circonstances que ne renferme point l'homme qui profite de l'inattention d'autrui : mais ces circonstances ne sont pas en assez grand nombre pour empêcher de reconnaître bien-tôt ce qu'ils ont de commun. De même aussi, entre profiter de l'inattention des autres et les surprendre, il y a peu de circonstances différentes, de sorte qu'on aperçoit encore aisément ce qu'ils ont de commun. Il faut dire le même de la différence qui se trouve entre surprendre et tromper, entre tromper et être coupable, entre être coupable et mériter punition. Ainsi l'idée de mériter punition, était renfermée dans l'idée user de finesses ; mais on ne le démêlait pas d'abord, à cause de beaucoup d'idées de circonstances qui accompagnent l'idée d'être fin ou user de finesses ; comme d'avoir de l'esprit, de la vigilance, de l'adresse, du discernement des choses, de la souplesse, du manège ; c'est au milieu de tout cela qu'il fallait découvrir l'idée de mériter punition ; c'est ce qu'on fait peu-à-peu et par degrés, employant des idées qui servent de milieu entre le principe et la conséquence, chacune desquelles est dite pour cela moyen terme. Voilà donc comment les conséquences se tirent plus ou moins immédiatement, selon que le même principe qui renferme la conséquence, est plus ou moins chargé de circonstances particulières, en sorte que les conséquences seront d'autant plus immédiates, qu'elles différeront moins du principe en nombre de circonstances.
On peut supposer des esprits si pénétrants, qu'ils reconnaissent par-tout et tout d'un coup la même idée en plusieurs propositions, soit qu'elle se trouve d'un côté avec plus ou moins, avec peu ou beaucoup de circonstances qui ne seront point de l'autre côté. Ceux-là voient tout d'un coup toutes les conséquences d'un principe, c'est-à-dire toutes les connaissances qui peuvent se tirer d'une première connaissance. Il en est peu de ce caractère, ou pour mieux dire point du tout ; mais ceux qui en approchent le plus, sont les plus grands esprits et les plus grands philosophes. Ce qui est certain, c'est que les esprits étant différents, les uns voient plutôt certaines conséquences, et d'autres certaines autres conséquences. Par-là ce qui est conséquence immédiate pour l'un, ne le sera pas pour l'autre ; parce que l'un verra plutôt que l'autre la ressemblance ou identité d'idées qui se trouve entre deux objets, au-travers de la multiplicité d'idées particulières qui sont d'un côté plutôt que de l'autre.
Quelque éloignée que soit une conséquence de son principe, il n'y a cependant guère de personnes qui ne puissent parcourir tous les milieux qui sont l'entre-deux, si ce n'est pas en volant comme les intelligences supérieures, du moins en se trainant lentement et avec effort d'une vérité à l'autre. Les démonstrations qui rebutent si fort par les difficultés dont elles sont hérissées, ne consistant que dans un tissu de connaissances ou propositions liées et assorties si immédiatement l'une à l'autre, qu'il n'y ait pas plus de difficulté pour atteindre la dixième que quand on sait la neuvième, ni la vingt et unième quand on sait la vingtième, qu'il n'y a de difficulté à savoir la seconde quand on sait la première de toutes. Or il n'est aucun esprit raisonnable qui ne soit capable d'avancer d'une première proposition à une seconde.
S'il se trouve quelquefois plus de difficulté dans la liaison de certaines propositions, par exemple, entre la neuvième et la dixième, qu'il n'y en aura eu entre la première et la seconde, c'est qu'alors la proposition qu'on a mise pour la dixième, n'aurait pas dû suivre immédiatement la neuvième ; il fallait mettre entre les deux quelques idées intermédiaires, qui menassent l'esprit de la dernière proposition conçue nettement à celle où il se trouve de la difficulté, en sorte que les degrés fussent plus voisins et plus immédiats par rapport à celui qui est instruit.
Quoi qu'il en sait, tout homme est capable d'acquérir une connaissance, qui par rapport à lui suive immédiatement une autre connaissance : il est donc capable d'atteindre degré à degré et de connaissance immédiate en connaissance immédiate à toutes les vérités et à toutes les sciences du monde.
La difficulté qu'il y a à étendre ses connaissances, ne vient pas, comme on se figure d'ordinaire, du côté de l'intelligence, mais du côté de la mémoire. On pourrait conduire par degrés et par la méthode géométrique tout esprit raisonnable à chacune des connaissances, dont le total forme ce qui s'appelle posséder une science. Le grand point serait de lui faire retenir en même temps toutes ces diverses connaissances. L'inconvénient donc le plus ordinaire dans le progrès des sciences est le défaut de mémoire, qui laissant échapper une idée précédente, nous empêche de concevoir ce qu'on nous dit actuellement ; parce qu'il est nécessairement lié avec cette idée précédente qui ne se présente plus à l'esprit.
Il faut observer qu'une démonstration n'est exacte, qu'autant que la raison aperçoit par une connaissance intuitive la convenance ou la disconvenance de chaque idée, qui lie ensemble les idées entre lesquelles elle intervient, pour montrer la convenance ou la disconvenance des deux idées extrêmes ; car sans cela, on aurait encore besoin de preuves pour faire voir la convenance ou la disconvenance que chaque idée moyenne a avec celles entre lesquelles elle est placée, puisque sans la perception d'une telle convenance ou disconvenance il ne saurait y avoir aucune connaissance. Si elle est aperçue par elle-même, c'est une connaissance intuitive ; et si elle ne l'est pas il faut que quelqu'autre idée moyenne intervienne pour servir, en qualité de mesure commune, à montrer leur convenance ou leur disconvenance ; d'où il parait évidemment, que dans le raisonnement chaque degré qui produit de la connaissance, a une certitude intuitive. Ainsi pour n'avoir aucun doute sur une démonstration, il est nécessaire que l'esprit retienne exactement cette perception intuitive de la convenance ou disconvenance des idées intermédiaires dans tous les degrés par lesquels il s'avance. Mais parce que la mémoire dans la plupart des hommes, surtout quand il est question d'une longue suite de preuves, n'est pas souple et docîle pour recevoir tant d'idées dont elle est comme surchargée, il arrive que cette connaissance, qu'enfante la démonstration, est toujours couverte de quelques nuages, qui empêchent qu'elle ne soit aussi claire et aussi parfaite que la connaissance intuitive. De-là les erreurs que les hommes prennent souvent de la meilleure foi du monde pour autant de vérités.
Voilà donc les deux degrés de notre connaissance, l'intuition et la démonstration. Mais à ces deux degrés on peut en ajouter encore deux autres, qui vont jusqu'à la plus parfaite certitude, je veux dire le rapport uniforme de nos sens, et les événements connus, incontestables et authentiques. Ces deux connaissances embrassent la Physique, le Commerce, tous les Arts, l'Histoire et la Religion. Dans ce que nous apprenons par le rapport de nos sens, comme dans ce que nous connaissons au-dedans de nous-mêmes, l'objet peut être très-obscur : mais le motif qui nous détermine à en porter quelque jugement peut être clair et distinct. Ce motif, c'est le rapport réitéré de nos sens ; c'est l'expérience qui nous assure la réalité et l'usage de chaque chose. Rien n'empêche que nous ne donnions le nom d'évidence à tout ce qui nous est attesté par les sens et par le témoignage des hommes : il n'y a même rien qui nous touche davantage que ce qui nous est évident en cette manière, ou ce qui vient en notre connaissance par le témoignage des sens : et il est aisé de voir que c'est pour suppléer à l'embarras et à l'incertitude des raisonnements, que Dieu nous rappelle par-tout à la simplicité de la preuve testimoniale et sensible. Elle fixe tout dans la société, dans la Physique, dans la règle de la foi, et dans la règle des mœurs.
Nous avons donc quatre sortes de connaissances, dont nous acquérons les unes par la simple intuition de nos idées, les autres par le raisonnement pur, les troisiemes par le rapport uniforme de nos sens, et les dernières enfin par des témoignages surs et incontestables. La première s'appelle connaissance intuitive, la seconde démonstrative, la troisième sensitive, et la quatrième testimoniale.
Après avoir fixé les différents degrés par lesquels nous pouvons nous élever à la vérité, il est nécessaire de nous assurer jusqu'où nous pouvons étendre nos connaissances, et quelles sont les bornes insurmontables qui nous arrêtent.
1°. La connaissance consistant, comme nous l'avons déjà dit, dans la perception de la convenance ou disconvenance de nos idées, il s'ensuit de-là,
1°. Que nous ne devons avoir aucune connaissance où nous n'avons aucune idée.
2°. Que nous ne saurions avoir de connaissance, qu'autant que nous apercevons cette convenance ou cette disconvenance ; ce qui se fait 1°. ou par intuition, en comparant immédiatement deux idées ; 2°. ou par raison, en examinant la convenance ou la disconvenance de deux idées, par l'intervention de quelques autres idées moyennes ; 3°. par sensation, en apercevant l'existence des choses particulières ; 4°. ou enfin par des événements connus, incontestables et authentiques.
3°. Que nous ne saurions avoir une connaissance intuitive qui s'étende à toutes nos idées, parce que nous ne pouvons pas apercevoir toutes les relations qui se trouvent entr'elles, en les comparant immédiatement les unes avec les autres ; par exemple, si j'ai des idées de deux triangles, l'un oxygone et l'autre amblygone, tracés sur une base égale et entre deux lignes parallèles, je puis apercevoir par une simple connaissance de vue que l'un n'est pas l'autre : mais je ne saurais connaître par ce moyen si ces deux triangles sont égaux ou non, parce qu'on ne saurait apercevoir leur égalité ou inégalité en les comparant immédiatement. La différence de leurs figures rend leurs parties incapables d'être exactement et immédiatement appliquées l'une sur l'autre ; c'est pourquoi il est nécessaire de faire intervenir une autre quantité pour les mesurer, ce qui est démontrer ou connaître par raison.
4°. Que notre connaissance raisonnée ne peut point embrasser toute l'étendue de nos idées, parce que nous manquons d'idées intermédiaires que nous puissions lier l'une à l'autre par une connaissance intuitive dans toutes les parties de la déduction ; et partout où cela nous manque, la connaissance et la démonstration nous manquent aussi.
Nous avons observé que la convenance ou disconvenance de nos idées consistait, 1°. dans leur identité ou diversité ; 2°. dans leur relation ; 3°. dans leur co-existence ; 4°. dans leur existence réelle.
1°. A l'égard de l'identité et de la diversité de nos idées, notre connaissance intuitive est aussi étendue que nos idées mêmes ; car l'esprit ne peut avoir aucune idée qu'il ne voie aussi-tôt par une connaissance simple de vue, qu'elle est ce qu'elle est, et qu'elle est différente de toute autre.
2°. Quant à la connaissance que nous avons de la convenance, ou de la disconvenance de nos idées, par rapport à leur co-existence ; il n'est pas si aisé de déterminer quelle est son étendue. Ce qu'il y a de certain, 1°. c'est que dans les recherches que nous faisons sur la nature des corps, notre connaissance ne s'étend point au-delà de notre expérience. La connaissance intuitive de la nature est refusée à notre intelligence. Ce degré de lumière qui nous manque, a été remplacé par les témoignages de nos sens, qui nous apprennent de tous les objets ce que nous avons besoin d'en savoir. Nous ne comprenons rien à la nature, ou à l'opération de l'aimant, qui nous indique le pôle dans le temps le plus ténébreux. Nous n'avons aucune idée de la structure du soleil, cet astre qui nous procure la chaleur, les couleurs et la vue de l'univers ; mais une expérience sensible nous force à convenir de son utilité. 2°. Les idées complexes que nous avons des substances se bornent à un certain nombre d'idées simples, qu'une expérience suivie et constante nous fait apercevoir réunies et coexistantes dans un même sujet. 3°. Les qualités sensibles, autrement dites les secondes qualités, font presque seules toute la connaissance que nous avons des substances. Or comme nous ignorons la liaison, ou l'incompatibilité qui se trouve entre ces secondes qualités, attendu que nous ne connaissons pas la source d'où elles découlent, je veux dire, la grosseur, la figure et la contexture des parties insensibles d'où elles dépendent ; il est impossible que nous puissions connaître quelles autres qualités procedent de la même constitution de ces parties insensibles, ou sont incompatibles avec celles que nous connaissons déjà. 3°. La liaison, qui se trouve entre les secondes qualités des corps, se dérobe entièrement à nos regards : de sorte que nous ne saurions nous assurer si ces qualités, que nous voyons coexister dans un même sujet, ne pourraient pas exister isolées les unes des autres, ou si elles doivent toujours s'accompagner. Par exemple, toutes les qualités dont nous avons formé l'idée complexe de l'or, savoir, la couleur jaune, la pesanteur, la malléabilité, la fusibilité, la fixité, et la capacité d'être dissous dans l'eau régale ; toutes ces qualités, dis-je, sont-elles tellement liées et unies ensemble, qu'elles soient inséparables, ou bien ne le sont-elles pas ? M. Locke prétend que nous ne pouvons le savoir ; et que par conséquent, nous ne pouvons nous assurer qu'elles sont rassemblées et réunies dans plusieurs substances semblables, si ce n'est par l'expérience que nous ferons sur chacune d'elles en particulier. Ainsi voilà deux pièces d'or ; je ne puis connaître si elles ont toutes deux toutes les qualités que nous renfermons dans l'idée complexe de l'or, à moins que nous ne tentions des expériences sur chacune d'elles. Avant l'expérience, nous ne connaissons qu'elles ont toutes les qualités de l'or, que d'une manière à la vérité fort probable, mais qui pourtant ne Ve pas jusqu'à la certitude ; ainsi pense M. Locke. 4°. Quoique nous n'ayons qu'une connaissance fort imparfaite et fort défectueuse des premières qualités des corps ; il en est cependant quelques-unes dont nous connaissons la liaison intime ; connaissance qui nous est absolument interdite par rapport aux secondes qualités, dont aucune ne nous parait supposer l'autre. Ainsi la figure suppose nécessairement l'étendue ; et la réception ou la communication de mouvement par voie d'impulsion suppose la solidité ; ainsi la divisibilité découle nécessairement de la multiplicité de parties substantielles. 5°. La connaissance de l'incompatibilité des idées dans un même sujet, s'étend plus loin que celle de leur co-existence. Par exemple, une étendue particulière, une certaine figure, un certain nombre de parties, un mouvement particulier exclut toute autre étendue, toute autre figure, tout autre mouvement et nombre de parties. Il en est certainement de même de toutes les idées sensibles particulières à chaque sens ; car toute idée de chaque sorte qui est présente dans un sujet, exclut toute autre de cette espèce. Par exemple, aucun sujet ne peut avoir deux odeurs, ou deux couleurs dans un même temps, et par rapport à la même personne. 6°. L'expérience seule peut nous fournir des connaissances sures et infaillibles, sur les puissances tant actives que passives des corps ; c'est-là le seul fonds où la Physique puise ses connaissances.
Ces choses ainsi supposées, on peut en quelque façon déterminer quelle est l'étendue de nos connaissances par rapport aux substances corporelles. Ce qui contribue à les étendre beaucoup plus que ne se l'est imaginé M. Locke, c'est que nous avons pour connaître les corps, outre les sens, le témoignage des hommes avec qui nous vivons, et l'analogie : moyens que le philosophe anglais n'a point fait entrer dans les secours que nous fournit l'auteur de notre être, pour perfectionner nos connaissances. Les sens, le témoignage et l'analogie ; voilà les trois fondements de l'évidence morale que nous avons des corps. Aucun de ces moyens n'est par lui-même, c'est-à-dire, par sa nature, la marque caractéristique de la vérité ; mais réunis ensemble, ils forment une persuasion convaincante, qui entraîne tous les esprits. Voyez ANALOGIE.
L'être souverainement bon, dit M. s'Gravesande, a accordé une grande abondance de biens aux hommes, dont il a voulu qu'ils fissent usage durant leur séjour sur la terre ; mais si les hommes n'avaient point les sens, il leur serait impossible d'avoir la moindre connaissance de ces avantages ; et ils seraient privés des commodités que l'usage leur en peut procurer ; par où il parait que Dieu a donné aux hommes les sens, pour s'en servir dans l'examen de ces choses, et pour y ajouter foi.
La sagesse suprême tomberait en contradiction avec elle-même, si après avoir accordé tant de biens aux hommes, et leur avoir donné les moyens de les connaître, ces moyens mêmes induisaient en erreur ceux à qui ces bienfaits ont été accordés. Ainsi, les sens conduisent à la connaissance de la vérité, parce que Dieu l'a voulu ainsi ; et la persuasion de la conformité des idées, que nous acquérons dans l'ordre naturel par les sens, avec les choses qu'elles représentent, est complete .
Cependant la manière dont les sens nous mènent à la connaissance des choses, n'est pas évidente par elle-même. Un long usage et une longue expérience sont nécessaires pour cela. Voyez l'art. des SENS, où nous expliquons comment dans chaque circonstance nous pouvons déterminer exactement ce que nous pouvons déduire de nos sensations, d'une manière qui ne nous laisse pas le moindre doute.
Les sens seuls ne suffisent pas pour pouvoir acquérir une connaissance des corps conforme à notre situation. Il n'y a point d'homme au monde, qui puisse examiner par lui-même toutes les choses qui lui sont nécessaires à la vie ; dans un nombre infini d'occasions il doit être instruit par d'autres, et s'il n'ajoute pas foi à leur témoignage, il ne pourra tirer aucune utilité de la plupart des choses que Dieu lui a accordées ; et il se trouvera réduit à mener sur la terre une vie courte et malheureuse.
D'où nous concluons que Dieu a voulu que le témoignage fût aussi une marque de la vérité ; il a d'ailleurs donné aux hommes la faculté de déterminer les qualités que doit avoir un témoignage, pour qu'on y ajoute foi.
Les jugements, qui ont pour fondement l'analogie, nous conduisent aussi à la connaissance des choses ; et la justesse des conclusions, que nous tirons de l'analogie, se déduit du même principe ; c'est-à-dire, de la volonté de Dieu, dont la providence a placé l'homme dans des circonstances, qui lui imposent la nécessité de vivre peu et misérablement, s'il refuse d'attribuer aux choses, qu'il n'a point examinées, les propriétés qu'il a trouvées à d'autres choses semblables, en les examinant.
Qui pourrait sans le secours de l'analogie, distinguer du poison de ce qui peut être utîle à la santé ? Qui oserait quitter le lieu qu'il occupe ? Quel moyen y aurait-il d'éviter un nombre infini de périls ?
3°. Pour ce qui est de la troisième espèce de connaissance, qui est la convenance ou la disconvenance de quelqu'une de nos idées, considérées dans quelque autre rapport que ce soit ; comme c'est-là le plus vaste champ de nos connaissances, il est bien difficîle de déterminer jusqu'où il peut s'étendre. Comme les progrès qu'on peut faire dans cette partie de notre connaissance, dépendent de notre sagacité à trouver des idées intermédiaires, qui puissent faire voir les rapports des idées dont on ne considère pas la coexistence ; il est difficîle de dire, quand nous sommes au bout de ces sortes de découvertes.
Ceux qui ignorent l'Algèbre, ne sauraient se figurer les choses étonnantes qu'on peut faire en ce genre par le moyen de cette science. Il n'est pas possible de déterminer quels nouveaux moyens de perfectionner les autres parties de nos connaissances, peuvent être encore inventés par un esprit pénétrant. Quoi qu'il en sait, l'on peut assurer que les idées qui regardent les nombres et l'étendue, ne sont pas les seules capables de démonstration ; mais qu'il y en a d'autres qui font peut-être la plus importante de nos spéculations, d'où l'on pourrait déduire des connaissances aussi certaines, si les vices, les passions, des intérêts dominans, ne s'opposaient directement à l'exécution d'une telle entreprise.
L'idée d'un Etre suprême, infini en puissance, en bonté, en sagesse, qui nous a faits, et de qui nous dépendons ; et l'idée de nous-mêmes comme de créatures intelligentes et raisonnables : ces deux idées, dis-je, bien approfondies, conduiraient à des conséquences sur nos devoirs envers Dieu, aussi nécessaires et aussi intimement liées, que toutes les conséquences qu'on tire des principes mathématiques. On aurait du juste et de l'injuste des mesures aussi précises et aussi exactes que celles que nous avons du nombre et de l'étendue. Par exemple, cette proposition ; il ne saurait y avoir de l'injustice où il n'y a point de propriété, est aussi certaine qu'aucune démonstration qui soit dans Euclide ; car l'idée de propriété étant un droit à une certaine chose, et l'idée qu'on désigne par le nom d'injustice étant l'invasion ou la violation d'un droit ; il est évident que ces idées étant ainsi déterminées, et ces noms leur étant attachés, je puis connaître aussi certainement que cette proposition est véritable, que je connais qu'un triangle a trois angles égaux à deux droits. Autre proposition d'une égale certitude, nul gouvernement n'accorde une absolue liberté ; car comme l'idée de gouvernement est un établissement de société sur certaines règles ou lois dont il exige l'exécution, et que l'idée d'une absolue liberté emporte avec elle le droit de faire tout ce que l'on veut ; je puis être aussi certain de la vérité de cette proposition, que d'aucune qu'on trouve dans les Mathématiques.
Ce qui a donné à cet égard l'avantage aux idées de quantité, c'est :
1°. Qu'on peut les représenter par des marques sensibles, qui ont une plus grande et plus étroite correspondance avec elles, que quelques mots ou sens qu'on puisse imaginer. Des figures tracées sur le papier sont autant de copies des idées qu'on a dans l'esprit, qui ne sont pas sujettes à l'incertitude que les mots ont dans leur signification. Un angle, un cercle, ou un carré qu'on trace avec des lignes, parait à la vue sans qu'on puisse s'y méprendre, il demeure invariable, et peut être considéré à loisir ; on peut revoir la démonstration qu'on a faite sur son sujet, et en considérer plus d'une fois toutes les parties, sans qu'il y ait aucun danger que les idées changent le moins du monde. On ne peut pas faire la même chose à l'égard des idées morales ; car nous n'avons point de marques sensibles qui les représentent, et par où nous puissions les exposer aux yeux. Nous n'avons que des mots pour les exprimer ; mais quoique ces mots restent les mêmes quand ils sont écrits, cependant les idées qu'ils signifient, peuvent varier dans le même homme ; et il est fort rare qu'elles ne soient pas différentes en différentes personnes.
2°. Une autre chose qui cause une plus grande difficulté dans la morale ; c'est que les idées morales sont ordinairement plus complexes que celles des figures, qu'on considère ordinairement dans les Mathématiques ; d'où naissent ces deux inconvénients : le premier, que les noms des idées morales ont une signification plus incertaine, parce qu'on ne convient pas si aisément de la collection d'idées simples qu'ils signifient précisément ; et par conséquent le signe qu'on met toujours à leur place, lorsqu'on s'entretient avec d'autres personnes, et souvent en méditant en soi-même, n'emporte pas constamment avec lui la même idée. Un autre inconvénient qui nait de la complication des idées morales, c'est que l'esprit ne saurait retenir aisément ces combinaisons précises d'une manière aussi exacte et aussi parfaite qu'il est nécessaire pour examiner les rapports, les convenances ou les disconvenances de plusieurs de ces idées comparées l'une à l'autre ; et surtout lorsqu'on n'en peut juger que par de longues déductions, et par l'intervention de plusieurs autres idées complexes, dont on se sert pour montrer la convenance de deux idées éloignées. Il est donc certain que les vérités morales ont une étroite liaison les unes avec les autres, qu'elles découlent d'idées claires et distinctes par des conséquences nécessaires, et que par conséquent elles peuvent être démontrées.
3°. Quant à la connaissance que nous avons de l'existence réelle et actuelle des choses, elle s'étend sur beaucoup de choses. Nous avons une connaissance intuitive de notre existence, voyez le Discours Préliminaire : une connaissance démonstrative de l'existence de Dieu ; voyez DIEU : une connaissance sensitive de tous les objets qui frappent nos sens ; et une testimoniale de plusieurs événements qui sont parvenus jusqu'à nous, à-travers l'espace des siècles, purs et sans altération. Voyez VERITE.
Il est constant, par tout ce que nous venons de dire, qu'il y a des connaissances certaines, puisque nous apercevons de la convenance ou de la disconvenance entre plusieurs de nos idées. Mais toutes nos connaissances sont-elles réelles ? qui peut savoir ce que sont ces idées, dont nous voyons la convenance ou la disconvenance ? y a-t-il rien de si extravagant que les imaginations qui se forment dans le cerveau des hommes ? où est celui qui n'a pas quelque chimère dans la tête ? et s'il y a un homme d'un sens rassis et d'un jugement tout à fait solide, quelle différence y aura-t-il, en vertu de nos règles, entre la connaissance d'un tel homme et celle de l'esprit le plus extravagant du monde. Ils ont tous deux leurs idées ; et ils aperçoivent tous deux la convenance ou la disconvenance qui est entr'elles. Si ces idées diffèrent par quelque endroit, tout l'avantage sera du côté de celui qui a l'imagination la plus échauffée, parce qu'il a des idées plus vives et en plus grand nombre ; de sorte que selon nos propres règles, il aura aussi plus de connaissance. S'il est vrai que toute la connaissance consiste dans la perception de la convenance ou de la disconvenance de nos propres idées, il y aura autant de certitude dans les visions d'un enthousiaste, que dans les raisonnements d'un homme de bon sens. Il n'importe ce que les choses sont en elles-mêmes, pourvu qu'un homme observe la convenance de ses propres imaginations, et qu'il parle conséquemment ; ce qu'il dit est certain, c'est la vérité toute pure. Tous ces châteaux bâtis en l'air seront d'aussi fortes retraites de la vérité, que les démonstrations mathématiques. Mais de quel usage sera toute cette belle connaissance des imaginations des hommes, à celui qui cherche à s'instruire de la réalité des choses ? qu'importe de savoir ce que sont les fantaisies des hommes ? ce n'est que la connaissance des choses qu'on doit estimer ; c'est cela seul qui donne du prix à nos raisonnements, et qui fait préférer la connaissance de ce que les choses sont réellement en elles-mêmes, à une connaissance de songes et de visions. Voilà la difficulté proposée dans toute sa force par M. Locke. Voici comme il y répond.
Si la connaissance que nous avons de nos idées se termine à ces idées sans s'étendre plus avant lorsqu'on se propose quelque chose de plus, nos plus sérieuses pensées ne seront pas d'un beaucoup plus grand usage que les rêveries d'un cerveau déréglé ; et les vérités fondées sur cette connaissance, ne seront pas d'un plus grand poids que les discours d'un homme qui voit clairement les choses en songe, et les débite avec une extrême confiance ; velut aegri somnia, vanae fingentur species.
Il est évident que l'esprit ne connait pas les choses immédiatement, mais par l'intervention des idées qui les lui représentent ; et par conséquent notre connaissance n'est réelle, qu'autant qu'il y a de la conformité entre nos idées et la réalité des choses. Mais quel sera ici notre criterion ? comment l'esprit, qui n'aperçoit rien que ses propres idées, connaitra-t-il qu'elles conviennent avec les choses mêmes ? Quoique cela ne semble pas exempt de difficulté, on peut pourtant assurer avec toute la certitude possible, qu'il y a du moins deux sortes d'idées, qui sont conformes aux choses.
Les premières sont les idées simples ; car puisque l'esprit ne saurait en aucune façon se les former à lui-même, il faut nécessairement qu'elles soient produites par des choses qui agissent naturellement sur l'esprit, et y font naître les perceptions auxquelles elles sont proportionnées par la sagesse de celui qui nous a faits. Il s'ensuit de-là que les idées simples ne sont pas des fictions de notre propre imagination, mais des productions naturelles et régulières des choses existantes hors de nous, qui opèrent réellement sur nous ; et qu'ainsi elles ont toute la conformité à quoi elles sont destinées, ou que notre état exige : car elles nous représentent les choses sous les apparences que les choses sont capables de produire en nous ; par où nous devenons capables nous-mêmes de distinguer les espèces des substances particulières, de discerner l'état où elles se trouvent, et par ce moyen de les appliquer à notre usage. Ainsi l'idée de blancheur ou d'amertume, telle qu'elle est dans l'esprit, étant exactement conforme à la puissance qui est dans un corps d'y produire une telle idée, a toute la conformité réelle qu'elle peut ou doit avoir avec les choses qui existent hors de nous ; et cette conformité qui se trouve entre nos idées simples et l'existence des choses, suffit pour nous donner une connaissance réelle.
En second lieu, toutes nos idées complexes, excepté celles des substances, étant des archetypes que l'esprit a formés lui-même, qu'il n'a pas destinés à être des copies de quoi que ce sait, ni rapportés à l'existence d'aucunes choses comme à leurs originaux, elles ne peuvent manquer d'avoir toute la conformité nécessaire à une connaissance réelle : car ce qui n'est pas destiné à représenter autre chose que soi-même, ne peut être capable d'une fausse représentation. Or excepté les idées des substances, telles sont toutes nos idées complexes, qui sont des combinaisons d'idées, que l'esprit joint ensemble par un libre choix, sans examiner si elles ont aucune liaison dans la nature. De-là vient que toutes les idées de cet ordre sont elles-mêmes considérées comme des archetypes, et les choses ne sont considérées qu'en tant qu'elles y sont conformes. Par conséquent toute notre connaissance touchant ces idées est réelle, et s'étend aux choses mêmes ; parce que dans toutes nos pensées, dans tous nos raisonnements, et dans tous nos discours sur ces sortes d'idées, nous n'avons dessein de considérer les choses qu'autant qu'elles sont conformes à nos idées ; et par conséquent nous ne pouvons manquer d'acquérir sur ce sujet une réalité certaine et indubitable.
Quoique toute notre connaissance, en fait de Mathématiques, roule uniquement sur nos propres idées, on peut dire cependant qu'elle est réelle, et que ce ne sont point de simples visions, et des chimères d'un cerveau fertîle en imaginations frivoles. Le mathématicien examine la vérité et les propriétés qui appartiennent à un rectangle ou à un cercle, à les considérer seulement tels qu'ils sont en idée dans son esprit ; car peut-être n'a-t-il jamais trouvé en sa vie aucune de ces figures qui soient mathématiquement, c'est-à-dire, précisément et exactement véritables : ce qui n'empêche pourtant pas que la connaissance qu'il a de quelque vérité ou de quelque propriété que ce sait, qui appartient au cercle ou à toute autre figure mathématique, ne soit véritable et certaine, même à l'égard des choses réellement existantes ; parce que les choses réelles n'entrent dans ces sortes de propositions et n'y sont considérées, qu'autant qu'elles conviennent réellement avec les archetypes, qui sont dans l'esprit du mathématicien. Est-il vrai de l'idée du triangle que ses trois angles soient égaux à deux droits ? La même chose est aussi véritable d'un triangle, en quelque endroit qu'il existe réellement. Mais que toute autre figure actuellement existante ne soit pas exactement conforme à l'idée du triangle qu'il a dans l'esprit, elle n'a absolument rien à démêler avec cette proposition : et par conséquent le mathématicien voit certainement que toute sa connaissance touchant ces sortes d'idées est réelle ; parce que ne considérant les choses qu'autant qu'elles conviennent avec ces idées qu'il a dans l'esprit, il est assuré que tout ce qu'il sait sur ces figures, lorsqu'elles n'ont qu'une existence idéale dans son esprit, se trouvera aussi véritable à l'égard de ces mêmes figures, si elles viennent à exister réellement dans la matière : ses réflexions ne tombent que sur ces figures, qui sont les mêmes, soit qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas.
Il s'ensuit de-là, que la connaissance des vérités morales est aussi susceptible d'une certitude réelle, que celle des vérités mathématiques. Comme nos idées morales sont elles-mêmes des archetypes, aussi-bien que les idées mathématiques, et qu'ainsi ce sont des idées complete s, toute la convenance ou la disconvenance que nous découvrirons entr'elles, produira une connaissance réelle, aussi-bien que dans les figures mathématiques.
Pour parvenir à la connaissance et à la certitude, il est nécessaire que nous ayons des idées déterminées ; et pour faire que notre connaissance soit réelle, il faut que nos idées répondent à leurs archetypes : au reste l'on ne doit pas trouver étrange qu'on place la réalité de notre connaissance dans la considération de nos idées, sans se mettre fort en peine de l'existence réelle des choses ; puisqu'après y avoir bien pensé, l'on trouvera, si je ne me trompe, que la plupart des discours sur lesquels roulent les pensées et les disputes, ne sont effectivement que des propositions générales et des notions, auxquelles l'existence n'a aucune part. Tous les discours de Mathématiciens sur la quadrature du cercle, sur les sections coniques, ou sur toute autre partie des Mathématiques, ne regardent point du tout l'existence d'aucune de ces figures. Les démonstrations qu'ils font sur cela, et qui dépendent des idées qu'ils ont dans l'esprit, sont les mêmes, soit qu'il y ait un carré ou un cercle actuellement existant dans le monde, ou qu'il n'y en ait point. De même, la vérité des discours de morale est considérée indépendamment de la vie des hommes, et de l'existence actuelle de ces vertus ; et les offices de Cicéron ne sont pas moins conformes à la vérité, parce qu'il n'y a personne qui en pratique exactement les maximes, et qui règle sa vie sur le modèle d'un homme de bien, tel que Cicéron nous l'a dépeint dans cet ouvrage, et qui n'existait qu'en idée lorsqu'il l'écrivait. S'il est vrai dans la spéculation, c'est-à-dire en idée, que le meurtre mérite la mort, il le sera aussi à l'égard de toute action réelle qui est conforme à cette idée de meurtre. Quant aux autres actions, la vérité de cette proposition ne les touche en aucune manière. Il en est de même de toutes les autres espèces de choses qui n'ont point d'autre essence que les idées mêmes qui sont dans l'esprit de l'homme.
En troisième lieu, il y a une autre sorte d'idées complexes, qui se rapportant à des archetypes qui existent hors de nous, peuvent en être différentes ; et ainsi notre connaissance touchant ces idées peut manquer d'être réelle. Telles sont nos idées de substance, qui consistant dans une collection d'idées simples, peuvent pourtant être différentes de ces archetypes, dès-là qu'elles renferment plus d'idées ou d'autres idées que celles qu'on peut trouver unies dans les choses mêmes ; dans ce cas-là elles ne sont pas réelles, n'étant pas exactement conformes aux choses mêmes. Ainsi pour avoir des idées des substances, qui étant conformes aux choses puissent nous fournir une connaissance réelle, il ne suffit pas de joindre ensemble, ainsi que dans les modes, des idées qui ne soient pas incompatibles, quoiqu'elles n'aient jamais existé auparavant de cette manière ; comme sont, par exemple, des idées de sacrilège ou de parjure, etc. qui étaient aussi véritables et aussi réelles avant qu'après l'existence d'aucune action semblable. Il en est tout autrement à l'égard de nos idées de substances ; car celles-ci étant regardées comme des copies qui doivent représenter des archetypes existants hors de nous, elles doivent être toujours formées sur quelque chose qui existe ou qui ait existé ; et il ne faut pas qu'elles soient composées d'idées, que notre esprit joigne arbitrairement ensemble, sans suivre aucun modèle réel d'où elles aient été déduites, quoique nous ne puissions apercevoir aucune incompatibilité dans une telle combinaison. La raison de cela est, que ne sachant pas quelle est la constitution réelle des substances d'où dépendent nos idées simples, et qui est effectivement la cause de ce que quelques-unes d'elles sont étroitement liées ensemble dans un même sujet, et que d'autres en sont exclues, il y en a fort peu dont nous puissions assurer qu'elles peuvent ou ne peuvent pas exister ensemble dans la nature, au-delà de ce qui parait par l'expérience et par des observations sensibles. Par conséquent toute la réalité de la connaissance que nous avons des substances, est fondée sur ceci : que toutes nos idées complexes des substances doivent être telles qu'elles soient uniquement composées d'idées simples, qu'on ait reconnues co-exister dans la nature. Jusque-là nos idées sont véritables ; et quoiqu'elles ne soient peut-être pas des copies fort exactes des substances, elles ne laissent pourtant pas d'être les sujets de la connaissance réelle que nous avons des substances ; connaissance bornée, à la vérité, mais qui n'en est pas moins réelle, tant qu'elle peut s'étendre.
Enfin, pour terminer ce que nous avions à dire sur la certitude et la réalité de nos connaissances ; par-tout où nous apercevons la convenance ou la disconvenance de quelqu'une de nos idées, il y a une connaissance certaine ; et par-tout où nous sommes assurés que ces idées conviennent avec la réalité des choses, il y a une connaissance certaine et réelle.
Mais, direz-vous, notre connaissance n'est réelle qu'autant qu'elle est conforme à son objet extérieur : or nous ne pouvons le savoir ; car, ou notre idée est conforme à l'objet, ou elle n'y est pas conforme : si elle n'y est pas conforme, nous n'en avons pas l'idée : si nous disons qu'elle y est conforme, comment le prouverons-nous ? Il faudrait que nous connussions cet objet avant que d'en avoir l'idée, afin que nous puissions dire et être assurés que notre idée y est conforme. Mais loin de cela, nous ne saurions pas si cet objet existe, si nous n'en avions l'idée, et nous ne le connaissons que par l'idée que nous en avons : au lieu qu'il faudrait que nous connussions cet objet-là avant toutes choses, pour pouvoir dire que l'idée que nous avons est l'idée de cet objet. Je ne puis connaître la vérité de mon idée, que par la connaissance de l'objet dont elle est l'idée ; mais je ne puis connaître cet objet, que par l'assurance que j'aurai de la vérité de mon idée. Voilà donc deux choses telles que je ne saurais connaître la première que par la seconde, ni la seconde que par la première ; et par conséquent je ne saurais connaître avec une pleine certitude ni l'une ni l'autre. D'ailleurs pourquoi voulons-nous que l'idée que nous avons d'un arbre soit plus conforme à ce qui est hors de nous, que l'idée que nous avons de la douceur ou de l'amertume, de la chaleur ou du froid, des sons et des couleurs ? Or on convient qu'il n'y a rien hors de nous et dans les objets qui soit semblable à ces idées que nous avons en leur présence : donc nous n'avons aucune preuve démonstrative qu'il y ait hors de nous quelque chose qui soit conforme à l'idée que nous avons, par exemple, d'un arbre ou de quelque autre objet ; donc nous ne sommes assurés d'aucune connaissance réelle.
Rien n'est moins solide que cette objection, quoiqu'elle soit une des plus subtiles qui aient été proposées par Sextus Empiricus. L'objection suppose que nous croyons avoir l'idée d'un arbre, par exemple, sans que nous soyons surs de l'avoir. Voici donc ce que je réponds. L'idée est de sa nature et de son essence une image, une représentation. Or toute image, toute représentation suppose un objet quel qu'il sait. Je demande maintenant si cet objet est possible ou impossible. Qu'il ne soit pas impossible, un pur être de raison, cela se conçoit aisément. Il suffit que nous ne puissions pas plus nous en former l'idée, qu'un peintre peut tracer sur une toîle un cercle carré, un triangle rond, un carré sans quatre côtés. L'impossibilité du peintre pour peindre de telles figures, nous garantit l'impossibilité où nous sommes de concevoir un être qui implique contradiction. Il reste donc que l'objet représenté par l'idée, soit du moins possible. Or cet objet possible est ou interne, ou externe. S'il est interne, il se confond avec notre idée même, et par conséquent nous avons de lui la même perception intime que celle que nous avons de notre idée. S'il est externe, la connaissance que j'en ai par l'idée qui le représente, est aussi réelle que lui, parce que cette idée lui est nécessairement conforme. Mais pour connaître si l'idée est vraie, il faudrait que je connusse déjà l'objet. Point du tout ; car l'idée porte avec elle sa vérité, sa vérité consistant à représenter ce qu'elle représente, et à ne pouvoir pas ne point représenter ce qu'elle représente. L'objection suppose faux, en disant qu'une des deux choses, soit l'idée, soit l'objet, précède la connaissance de l'autre. Ce sont deux corollaires qui se connaissent en même temps. Mais pendant que je m'imagine avoir l'idée d'un arbre, ne peut-il pas se faire que j'aye l'idée de tout autre objet ? Cela n'est pas plus possible qu'il le serait de voir du noir quand on croit voir du blanc, de sentir de la douleur quand on croit n'avoir que des sentiments de plaisir. La raison de cela est que l'âme ayant une perception intime de tout ce qui se passe chez elle, elle ne peut jamais prendre une idée pour l'autre ; et par conséquent, si elle croit voir un arbre, c'est que réellement elle en a l'idée.
Quant à ce qu'on ajoute, que l'idée que nous avons d'un arbre ne doit pas être plus conforme à ce qui est hors de nous, que l'idée que nous avons de la douceur ou de l'amertume, de la chaleur ou du froid, des sons et des couleurs, sensations qui n'existent pas certainement hors de nous, cela ne souffre aucune difficulté. La notion d'un arbre dépouillé de toutes les qualités sensibles que lui donne un jugement précipité, et considéré du côté de son étendue, de sa grandeur, et de sa figure, n'est que l'idée de plusieurs êtres qui nous paraissent les uns hors des autres : c'est pourquoi en supposant au-dehors quelque chose de conforme à cette idée, nous nous le représentons toujours d'une manière aussi claire, que si nous ne le considérions qu'en l'idée même. Il en est tout autrement des couleurs, des odeurs, des gouts, etc. Tant qu'en réfléchissant sur ces sensations, nous les regardons comme à nous, comme nous étant propres, nous en avons des idées fort claires : mais si nous voulons, pour ainsi dire, les détacher de notre être, et en enrichir les objets, nous faisons une chose dont nous n'avons plus d'idée ; nous ne sommes portés à les leur attribuer, que parce que d'un côté nous sommes obligés d'y supposer quelque chose qui les occasionne, et que de l'autre cette cause nous est tout à fait cachée. Voyez Locke, le P. Buffier, Chambers, M. Formey.
CONNOISSANCES, (Vénerie) indices de l'âge et de la forme du cerf, par la tête, le pied, les fumées, etc.
CONNOISSANCE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 2771