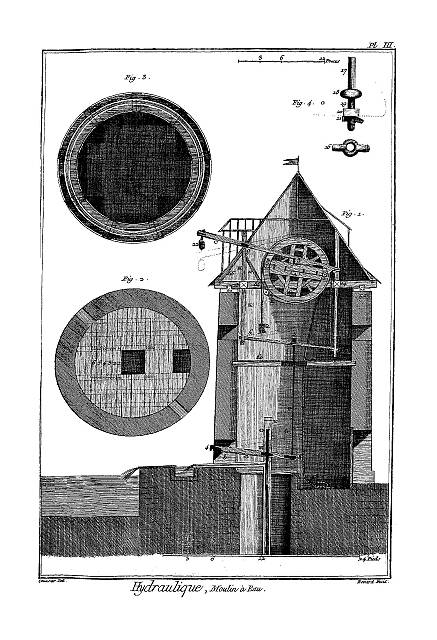S. f. (Métaphysique) la vérité, dit le P. Buffier, est quelque chose de si important pour l'homme, qu'il doit toujours chercher des moyens surs pour y arriver ; et quand il ne le peut, il doit s'en dédommager en s'attachant à ce qui en approche le plus, qui est ce qu'on appelle vraisemblance.
Au reste, une opinion n'approche du vrai que par certains endroits ; car approcher du vrai, c'est ressembler au vrai, c'est-à-dire être propre à former ou à rappeler dans l'esprit l'idée du vrai. Or, si une opinion par tous les endroits par lesquels on la peut considérer, formait également les idées du vrai, il n'y paraitrait rien que de vrai, on ne pourrait juger la chose que vraie ; et par-là ce serait effectivement le vrai, ou la vérité même.
D'ailleurs, comme ce qui n'est pas vrai est faux, et que ce qui ne ressemble pas au vrai ressemble au faux, il se trouve en tout ce qui s'appelle vraisemblable, quelques endroits qui ressemblent au faux ; tandis que d'autres endroits ressemblent au vrai. Il faut donc faire la balance de ces endroits opposés, pour reconnaître lesquels l'emportent les uns sur les autres, afin d'attribuer à une opinion la qualité de vraisemblable, sans quoi au même temps elle serait vraisemblable et ne le serait pas.
En effet, quelle raison y aurait-il d'appeler semblable au vrai, ce qui ressemble autant au faux qu'au vrai ? Si l'on nous demandait à quelle couleur ressemble une étoffe tachetée également de blanc et de noir, répondrions-nous qu'elle ressemble au blanc parce qu'il s'y trouve du blanc ? On nous demanderait en même temps, pourquoi ne pas dire aussi qu'elle ressemble au noir, puisqu'elle tient autant de l'un que de l'autre. A plus forte raison ne pourrait-on pas dire que la couleur de cette étoffe ressemble au noir, s'il s'y trouvait plus de noir que de blanc. Au contraire, si le blanc y dominait beaucoup plus que le noir, en sorte qu'elle rappelât tant d'idée du blanc, que le noir en comparaison ne fit qu'une impression peu sensible, on dirait que cette couleur approche du blanc, et ressemble à du blanc.
Ainsi dans les occasions où l'on ne parle pas avec une si grande exactitude, dès qu'il parait un peu plus d'endroits vrais que de faux, on appelle la chose vraisemblable ; mais pour être absolument vraisemblable, il faut qu'il se trouve manifestement et sensiblement beaucoup plus d'endroits vrais que de faux, sans quoi la ressemblance demeure indéterminée, n'approchant pas plus de l'un que de l'autre. Ce que je dis de la vraisemblance, s'entend aussi de la probabilité ; puisque la probabilité ne tombe que sur ce que l'esprit approuve, à cause de la ressemblance avec le vrai, se portant du côté où sont les plus grandes apparences de vérité, plutôt que du côté contraire, supposé qu'il veuille se déterminer. Je dis, supposé qu'il veuille se déterminer, car l'esprit ne se portant nécessairement qu'au vrai, dès qu'il ne l'aperçoit point dans tout son jour, il peut suspendre sa détermination ; mais supposé qu'il ne la suspende pas, il ne saurait pencher que du côté de la plus grande apparence de vrai.
On peut demander, si dans une opinion, il ne pourrait pas y avoir des endroits mitoyens entre le vrai et le faux, qui seraient des endroits où l'esprit ne saurait que penser. Or, dans les hypothèses pareilles, on doit regarder ce qui est mitoyen entre la vérité et la fausseté, comme s'il n'était rien du tout ; puisqu'en effet il est incapable de faire aucune impression sur un esprit raisonnable. Dans les occasions mêmes où il se trouve de côté et d'autre des raisons égales de juger, l'usage autorise le mot de vraisemblable ; mais comme ce vraisemblable ressemble autant au mensonge qu'à la vérité, j'aimerais mieux l'appeler douteux que vraisemblable.
Le plus haut degré du vraisemblable, est celui qui approche de la certitude physique, laquelle peut subsister peut-être elle-même avec quelque soupçon ou possibilité de faux. Par exemple, je suis certain physiquement que le soleil éclairera demain l'horizon ; mais cette certitude suppose que les choses demeureront dans un ordre naturel, et qu'à cet égard il ne se fera point de miracle. La vraisemblance augmente, pour ainsi dire, et s'approche du vrai par autant de degrés, que les circonstances suivantes s'y rencontrent en plus grand nombre, et d'une manière plus expresse.
1°. Quand ce que nous jugeons vraisemblable s'accorde avec des vérités évidentes.
2°. Quand ayant douté d'une opinion nous venons à nous y conformer à mesure que nous y faisons plus de réflexion, et que nous l'examinons de plus près.
3°. Quand des expériences que nous ne savions pas auparavant, surviennent à celles qui avaient été le fondement de notre opinion.
4°. Quand nous jugeons en conséquence d'un plus grand usage des choses que nous examinons.
5°. Quand les jugements que nous avons portés sur des choses de même nature, se sont vérifiés dans la suite. Tels sont à-peu-près les divers caractères qui selon leur étendue ou leur nombre plus considérable, rendent notre opinion plus semblable à la vérité ; en sorte que si toutes ces circonstances se rencontraient dans toute leur étendue, alors comme l'opinion serait parfaitement semblable à la vérité, elle passerait non-seulement pour vraisemblable, mais pour vraie, ou même elle le serait en effet. Comme une étoffe qui par tous les endroits ressemblerait à du blanc, non-seulement serait semblable à du blanc, mais encore serait dite absolument blanche.
Ce que nous venons d'observer sur la vraisemblance en général, s'applique, comme de soi-même à la vraisemblance qui se tire de l'autorité et du témoignage des hommes. Bien que les hommes en général puissent mentir, et que même nous ayons l'expérience qu'ils mentent souvent, néanmoins la nature ayant inspiré à tous les hommes l'amour du vrai, la présomption est que celui qui nous parle suit cette inclination ; lorsque nous n'avons aucune raison de juger, ou de soupçonner qu'il ne dit pas vrai.
Les raisons que nous en pourrions avoir, se tirent ou de sa personne, ou des choses qu'il nous dit ; de sa personne, par rapport ou à son esprit, ou à sa volonté.
1°. Par rapport à son esprit, s'il est peu capable de bien juger de ce qu'il rapporte ; 2°. si d'autres fois il s'y est mépris ; 3°. s'il est d'une imagination ombrageuse ou échauffée : caractère très-commun même parmi des gens d'esprit, qui prennent aisément l'ombre ou l'apparence des choses pour les choses mêmes ; et le phantome qu'ils se forment, pour la vérité qu'ils croient discerner.
Par rapport à la volonté ; 1°. si c'est un homme qui se fait une habitude de parler autrement qu'il ne pense ; 2°. si l'on a éprouvé qu'il lui échappe de ne pas dire exactement la vérité ; 3°. si l'on aperçoit dans lui quelque intérêt à dissimuler : on doit alors être plus réservé à le croire.
A l'égard des choses qu'il dit ; 1°. si elles ne se suivent et ne s'accordent pas bien ; 2°. si elles conviennent mal avec ce qui nous a été dit par d'autres personnes aussi dignes de foi ; 3°. si elles sont par elles-mêmes difficiles à croire, ou en des sujets où il ait pu aisément se méprendre.
Ces circonstances contraires rendent vraisemblable ce qui nous est rapporté : savoir, 1°. quand nous connaissons celui qui nous parle pour être d'un esprit juste et droit, d'une imagination réglée, et nullement ombrageuse, d'une sincérité exacte et constante ; 2°. quand d'ailleurs les circonstances des choses qu'il dit ne se démentent point entr'elles, mais s'accordent avec des faits ou des principes dont nous ne pouvons douter. A mesure que ces mêmes choses sont rapportées par un plus grand nombre de personnes, la vraisemblance augmentera aussi ; elle pourra même de la sorte parvenir à un si haut degré, qu'il sera impossible de suspendre notre jugement, à la vue de tant de circonstances qui ressemblent au vrai. Le dernier degré de la vraisemblance est certitude, comme son premier degré est doute ; c'est-à-dire qu'où finit le doute, là commence la vraisemblance, et où elle finit, là commence la certitude. Ainsi les deux extrêmes de la vraisemblance sont le doute et la certitude ; elle occupe tout l'intervalle qui les sépare, et cet intervalle s'accrait d'autant plus qu'il est parcouru par des esprits plus fins et plus pénétrants. Pour des esprits médiocres et vulgaires, cet espace est toujours fort étroit ; à peine savent-ils discerner les nuances du vrai et du vraisemblable.
L'usage le plus naturel et le plus général du vraisemblable est de suppléer pour le vrai : en sorte que là où notre esprit ne saurait atteindre le vrai, il atteigne du-moins le vraisemblable, pour s'y reposer comme dans la situation la plus voisine du vrai.
1°. A l'égard des choses de pure spéculation, il est bon d'être réservé à ne porter son jugement dans les choses vraisemblables, qu'après une grande attention : pourquoi ? parce que l'apparence du vrai subsiste alors avec une apparence de faux, qui peut suspendre notre jugement jusqu'à ce que la volonté le détermine. Je dis le suspendre, car elle n'a pas la faculté de déterminer l'esprit à ce qui parait le moins vrai. Ainsi dans les choses de pure spéculation, c'est très-bien fait de ne juger que lorsque les degrés de vraisemblance sont très-considérables, et qu'ils font presque disparaitre les apparences du faux, et le danger de se tromper.
En effet dans les choses de pure spéculation, il ne se rencontre nul inconvénient à ne pas porter son jugement, lorsque l'on court quelque hasard de se tromper : or pourquoi juger, quand d'un côté on peut s'en dispenser, et que d'un autre côté en jugeant, on s'expose à donner dans le faux ? il faudrait donc s'abstenir de juger sur la plupart des choses ? n'est-ce pas le caractère d'un stupide ? tout-au-contraire, c'est le caractère d'un esprit sensé, et d'un vrai philosophe, de ne juger des objets que par leur évidence, quand il ne se trouve nulle raison d'en user autrement : or il ne s'en trouve aucune de juger dans les choses de pure spéculation, quand elles ne sont que vraisemblables.
Cependant cette règle si judicieuse dans les choses de pure spéculation, n'est plus la même dans les choses de pratique et de conduite, où il faut par nécessité agir ou ne pas agir. Quoiqu'on ne doive pas prendre le vrai pour le vraisemblable, on doit néanmoins se déterminer par rapport aux choses de pratique, à s'en contenter comme du vrai, n'arrêtant les yeux de l'esprit que sur les apparences de vérité, qui dans le vraisemblable surpassent les apparences du faux.
La raison de ceci est évidente, c'est que par rapport à la pratique il faut agir, et par conséquent prendre un parti : si l'on demeurait indéterminé, on n'agirait jamais ; ce qui serait le plus pernicieux comme le plus impertinent de tous les partis. Ainsi pour ne pas demeurer indéterminé, il faut comme fermer les yeux à ce qui pourrait paraitre de vrai dans le parti contraire à celui qu'on embrasse actuellement. A la vérité dans la délibération on ne peut regarder de trop près aux diverses faces ou apparences de vrai qui se rencontrent de côté et d'autre, pour se bien assurer de quel côté est le vraisemblable ; mais quand on en est une fois assuré, il faut par rapport à la pratique, le regarder comme vrai, et ne le point perdre de vue : sans quoi on tomberait nécessairement dans l'inaction ou dans l'inconstance ; caractère de petitesse ou de faiblesse d'esprit.
Dans la nécessité où l'on est de se déterminer pour agir ou ne pas agir, l'indétermination est toujours un défaut de l'esprit, qui au milieu des faces diverses d'un même objet, ne discerne pas lesquelles doivent l'emporter sur les autres. Hors de ce besoin, on pourrait très-bien, et souvent avec plus de sagesse, demeurer indéterminé entre deux opinions qui ne sont que vraisemblables.
VRAISEMBLANCE, (Poésie) La première règle que doit observer le poète, en traitant les sujets qu'il a choisis, est de ne rien insérer qui soit contre la vraisemblance. Un fait vraisemblable est un fait possible dans les circonstances où on le met sur la scène. Les fictions sans vraisemblance, et les événements prodigieux à l'excès, dégoutent les lecteurs dont le jugement est formé. Il y a beaucoup de choses, dit un grand critique, où les poètes et les peintres peuvent donner carrière à leur imagination ; il ne faut pas toujours les resserrer dans la raison étroite et rigoureuse ; mais il ne leur est pas permis de mêler des choses incompatibles, d'accoupler les oiseaux avec les serpens, les tigres avec les agneaux.
Sed non ut placidis coeant immitia, non ut
Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.
Art poétiq. Ve 14.
Si de telles licences révoltantes sont défendues aux poètes, d'un autre côté les événements où il ne règne rien de surprenant, soit par la noblesse du sentiment, soit par la précision de la pensée, soit par la justesse de l'expression, paraissent plats ; l'alliance du merveilleux et du vraisemblable, où l'un et l'autre ne perdent point leurs droits, est un talent qui distingue les poètes de la classe de Virgile, des versificateurs sans invention, et des poètes extravagans ; cependant un poème sans merveilleux, déplait encore davantage qu'un poème fondé sur une supposition sans vraisemblance.
Comme rien ne détruit plus la vraisemblance d'un fait, que la connaissance certaine que peut avoir le spectateur que le fait est arrivé autrement que le poète ne le raconte ; les poètes qui contredisent dans leurs ouvrages des faits historiques très-connus, nuisent beaucoup à la vraisemblance de leurs fictions. Je sais bien que le faux est quelquefois plus vraisemblable que le vrai, mais nous ne réglons pas notre croyance des faits sur leur vraisemblance métaphysique, ou sur le pied de leur possibilité, c'est sur la vraisemblance historique. Nous n'examinons pas ce qui doit arriver plus probablement, mais ce que les témoins nécessaires, et ce que les historiens racontent ; et c'est leur récit, et non pas la vraisemblance, qui détermine notre croyance. Ainsi nous ne croyons pas l'événement qui est le plus vraisemblable et le plus possible, mais ce qu'ils nous disent être véritablement arrivé. Leur déposition étant la règle de notre croyance sur les faits, ce qui peut être contraire à leur déposition, ne saurait paraitre vraisemblable : or comme la vérité est l'âme de l'histoire, la vraisemblance est l'âme de la poésie.
Je ne nie pas néanmoins qu'il n'y ait des vraisemblances théâtrales, par exemple en matière d'opéra, auxquelles on est obligé de se prêter ; en accordant cette liberté aux poètes, on en est payé par les beautés qu'elle le met en état de produire. Il y a des vraisemblances d'une autre espèce pour l'épopée ; cependant il faut dans ce genre même, rendre par l'adresse et le génie, les suppositions les plus vraisemblables qu'il soit possible, comme Virgile a fait pour pallier la bizarrerie de ce cheval énorme que les Grecs s'avisèrent de construire pour se rendre maîtres de Troie.
Ces réflexions peuvent suffire sur la vraisemblance en général, la question particulière du vraisemblable dramatique a été traitée au mot POESIE dramatique. (D.J.)
VRAISEMBLANCE pittoresque, (Peinture) Il est deux sortes de vraisemblances en peinture ; la vraisemblance mécanique, et la vraisemblance poétique. Indiquons d'après M. l'abbé du Bos, en quoi consistent l'une et l'autre.
La vraisemblance mécanique exige de ne rien représenter qui ne soit possible, qui ne soit encore suivant les lois de la statique, les lois du mouvement, et les lois de l'optique. Cette vraisemblance mécanique, consiste donc à ne point donner à une lumière d'autres effets que ceux qu'elle avait dans la nature : par exemple, à ne lui point faire éclairer les corps sur lesquels d'autres corps interposés l'empêchent de tomber : elle consiste à ne point s'éloigner sensiblement de la proportion naturelle des corps, à ne point leur donner plus de force qu'il est vraisemblable qu'ils en puissent avoir. Un peintre pécherait contre ces lois, s'il faisait lever par un homme faible, et dans une attitude gênée, un fardeau qu'un homme qui peut faire usage de toutes ses forces aurait peine à ébranler. Encore moins faut-il faire porter à une figure, un tronc de colonnes, ou quelqu'autre fardeau d'une pesanteur excessive, et au-dessus des forces d'un Hercule. Il est aisé à un artiste de ne pas pécher contre la vraisemblance mécanique, parce que avec un peu de lumières, et des règles formelles qu'il trouve dans tous les ouvrages de peinture, il est en état d'éviter les erreurs grossières ; mais la vraisemblance poétique est un art tout autrement difficîle à acquérir. Ainsi nous devons nous arrêter davantage à en représenter toute l'étendue.
La vraisemblance poétique consiste en général, à donner toujours à ses personnages, les passions qui leur conviennent, suivant leur âge, leur dignité, suivant le tempérament qu'on leur prête, et l'intérêt qu'on leur fait prendre dans l'action. Elle consiste encore à observer dans son tableau ce que les Italiens appellent il costume, c'est-à-dire à s'y conformer à ce que nous savons des mœurs, des usages, des rites, des habits, des bâtiments, et des armes particulières des peuples qu'on veut représenter. Enfin la vraisemblance poétique consiste à donner aux personnages d'un tableau, leur tête et leur caractère connu, quand ils en ont un.
Quoique tous les spectateurs dans un tableau deviennent des acteurs, leur action néanmoins ne doit être vive qu'à proportion de l'intérêt qu'ils prennent à l'événement dont on les rend témoins. Ainsi le soldat qui voit le sacrifice d'Iphigénie, doit être ému ; mais il ne doit point être aussi ému qu'un frère de la victime. Une femme qui assiste au jugement de Susanne, et qu'on ne reconnait point à son air de tête ou à ses traits, pour être la sœur de Susanne ou sa mère, ne doit pas montrer le même degré d'affliction qu'une parente. Il faut qu'un jeune homme applaudisse avec plus d'empressement qu'un vieillard.
L'attention à la même chose est encore différente à ces deux âges. Le jeune homme doit paraitre livré entièrement à tel spectacle, que l'homme d'expérience ne doit voir qu'avec une légère attention. Le spectateur à qui l'on donne la physionomie d'un homme d'esprit, ne doit point admirer comme celui qu'on a caractérisé par une physionomie stupide. L'étonnement du roi ne doit point être celui d'un homme du peuple. Un homme qui écoute de loin, ne doit pas se présenter comme celui qui écoute de près. L'attention de celui qui voit, est différente de l'attention de celui qui ne fait qu'entendre. Une personne vive ne voit pas, et n'écoute pas dans la même attitude qu'une personne mélancolique. Le respect et l'attention que la cour d'un roi de Perse témoigne pour son maître, doivent être exprimés par des démonstrations qui ne conviennent pas à l'attention de la suite d'un consul romain pour son magistrat. La crainte d'un esclave n'est pas celle d'un citoyen, ni la peur d'une femme celle d'un soldat. Un soldat qui verrait le ciel s'entr'ouvrir, ne doit pas même avoir peur comme une personne d'une autre condition. La grande frayeur peut rendre une femme immobîle ; mais un soldat éperdu doit encore se mettre en posture de se servir de ses armes, du-moins par un mouvement purement machinal. Un homme de courage attaqué d'une grande douleur, laisse bien voir sa souffrance peinte sur son visage, mais elle n'y doit point paraitre telle qu'elle se montrerait sur le visage d'une femme. La colere d'un homme vif n'est pas celle d'un homme mélancolique.
On voit au maître-autel de la petite église de S. Etienne de Gènes, un tableau de Jules, romain, qui représente le martyre de ce saint. Le peintre y exprime parfaitement la différence qui est entre l'action naturelle des personnes de chaque tempérament, quoiqu'elles agissent par la même passion ; et l'on sait bien que cette sorte d'exécution ne se faisait point par des bourreaux payés, mais par le peuple lui-même. Un des Juifs qui lapide le saint, a des cheveux roussâtres, le teint haut en couleur, enfin toutes les marques d'un homme bilieux et sanguin ; et il parait transporté de colere ; sa bouche et ses narines sont ouvertes extraordinairement ; son geste est celui d'un furieux ; et pour lancer sa pierre avec plus d'impétuosité, il ne se soutient que sur un pied. Un autre juif placé auprès du premier, et qu'on reconnait être d'un tempérament mélancolique, à sa maigreur, à son teint livide, à la noirceur des poils, se ramasse tout le corps en jetant sa pierre, qu'il dirige à la tête du saint. On voit bien que sa haine est encore plus forte que celle du premier, quoique son maintien et son geste ne marquent pas tant de fureur. Sa colere contre un homme condamné par la loi, et qu'il exécute par principe de religion, n'en est pas moins grande pour être d'une espèce différente.
L'emportement d'un général ne doit pas être semblable à celui d'un simple soldat. Enfin il en est de même de tous les sentiments et de toutes les passions. Si je n'en parle point plus au long, c'est que j'en ai déjà trop dit pour les personnes qui ont réfléchi sur le grand art des expressions, et je n'en saurais dire assez pour celles qui n'y ont pas réfléchi.
La vraisemblance poétique consiste encore dans l'observation des règles que nous comprenons, ainsi que les Italiens, sous le mot de costume, observation qui donne un si grand mérite aux tableaux du Poussin. Suivant ces règles, il faut représenter les lieux où l'action s'est passée, tels qu'ils ont été, si nous en avons connaissance ; et quand il n'en est pas demeuré de notion précise, il faut, en imaginant leur disposition, prendre garde à ne se point trouver en contradiction avec ce qu'on en peut savoir. Les mêmes règles veulent qu'on donne aux différentes nations qui paraissent ordinairement sur la scène des tableaux, la couleur du visage et l'habitude de corps que l'histoire a remarqué leur être propres. Il est même beau de pousser la vraisemblance jusqu'à suivre ce que nous savons de particulier des animaux de chaque contrée, quand nous représentons un événement arrivé dans ce lieu-là. Le Poussin qui a traité plusieurs actions dont la scène est en Egypte, met presque toujours dans ses tableaux, des bâtiments, des arbres ou des animaux, qui par différentes raisons, sont regardés comme étant particuliers à ce pays.
M. le Brun a suivi ces règles avec la même ponctualité dans ses tableaux de l'histoire d'Alexandre. Les Perses et les Indiens s'y distinguent des Grecs à leur physionomie autant qu'à leurs armes. Leurs chevaux n'ont pas le même corsage que ceux des Macédoniens. Conformément à la vérité, les chevaux des Perses y sont représentés plus minces. On raconte que M. le Brun avait fait dessiner à Alep des chevaux de Perse, afin d'observer le costume sur ce point-là dans ses tableaux. Il est vrai qu'il se trompa pour la tête d'Alexandre dans le premier qu'il fit : c'est celui qui représente les reines de Perse aux pieds d'Alexandre. On avait donné à M le Brun pour la tête d'Alexandre, la tête de Minerve qui était sur une médaille, au revers de laquelle on lisait le nom d'Alexandre. Ce prince, contre la vérité qui nous est connue, parait donc beau comme une femme dans ce tableau. Mais M. le Brun se corrigea, dès qu'il eut été averti de sa méprise, et il nous a donné la véritable tête du vainqueur de Darius, dans le tableau du passage du Granique et dans celui de son entrée à Babylone. Il en prit l'idée d'après le buste de ce prince, qui se voit dans un des bosquets de Versailles sur une colonne, et qu'un sculpteur moderne a déguisé en Mars gaulois, en lui mettant un coq sur son casque ; ce buste, ainsi que la colonne qui est d'albâtre oriental, ont été apportés d'Alexandrie.
La vraisemblance poétique exige aussi qu'on représente les nations avec leurs vêtements, leurs armes et leurs étendards ; elle exige qu'on mette dans les enseignes des Athéniens, la chouette ; dans celles des Egyptiens, la cigogne, et l'aigle dans celles des Romains ; enfin qu'on se conforme à celles de leurs coutumes qui ont du rapport avec l'action du tableau. Ainsi le peintre qui fera un tableau de la mort de Britannicus, ne représentera pas Néron et les autres convives assis autour d'une table, mais bien couchés sur des lits.
L'erreur d'introduire dans une action des personnages qui ne purent jamais être témoins, pour avoir vécu dans des temps éloignés de celui de l'action, est une erreur grossière où nos peintres ne tombent plus. On ne voit plus un S. François écouter la prédication de S. Paul, ni un confesseur le crucifix en main, exhorter le bon larron.
Enfin la vraisemblance poétique demande que le peintre donne à ses personnages leur air de tête connu, soit que cet air nous ait été transmis par des médailles, des statues, ou par des portraits, soit qu'une tradition dont on ignore la source, nous l'ait conservé, soit même qu'il soit imaginé. Quoique nous ne sachions pas certainement comme S. Pierre était fait, néanmoins les peintres et les sculpteurs sont tombés d'accord par une convention tacite, de le représenter avec un certain air de tête et une certaine taille qui sont devenus propres à ce saint. En imitation, l'idée réelle et généralement établie tient lieu de vérité. Ce que j'ai dit de S. Pierre, peut aussi se dire de la figure sous laquelle on représente plusieurs autres saints, et même de celle qu'on donne ordinairement à S. Paul, quoiqu'elle ne convienne pas trop avec le portrait que cet apôtre fait de lui-même ; il n'importe, la chose est établie ainsi. Le sculpteur qui représenterait S. Paul moins grand, plus décharné, et avec une barbe plus petite que celle de S. Pierre, serait repris autant que le fut Bandinelli, pour avoir mis à côté de la statue d'Adam qu'il fit pour le dôme de Florence, une statue d'Eve plus haute que celle de son mari. Ces deux statues ne sont plus dans l'église cathédrale de Florence ; elles en ont été ôtées en 1722, par ordre du grand duc Cosme III. pour être mises dans la grande salle du vieux palais. On leur a substitué un grouppe que Michel Ange avait laissé imparfait, et qui représente un Christ descendu de la croix.
Nous voyons par les épitres de Sidonius Apollinaris, que les philosophes illustres de l'antiquité avaient aussi chacun son air de tête, sa figure et son geste, qui lui étaient propres en peinture. Raphaël s'est bien servi de cette érudition dans son tableau de l'école d'Athènes. Nous apprenons aussi de Quintilien, que les anciens peintres s'étaient assujettis à donner à leurs dieux et à leurs héros, la physionomie et le même caractère que Zeuxis leur avait donné : ce qui lui valut le nom de législateur.
L'observation de la vraisemblance nous parait donc, après le choix du sujet, la chose la plus importante d'un tableau. La règle qui enjoint aux peintres, comme aux poètes, de faire un plan judicieux, d'ordonner et d'arranger leurs idées, de manière que les objets se débrouillent sans peine, vient immédiatement après la règle qui enjoint d'observer la vraisemblance. Voyez donc ORDONNANCE, Peinture. (D.J.)
VRAISEMBLANCE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 3128