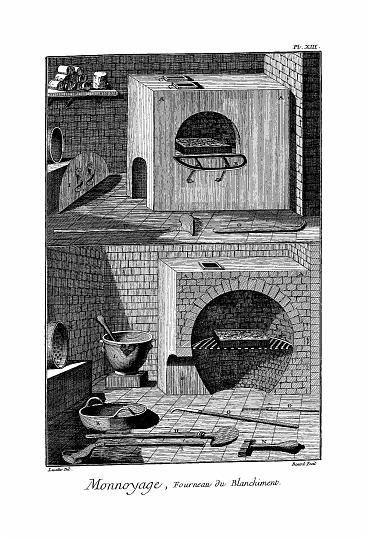S. f. (Morale) signifie quelquefois le trésor du prince, trésorier de l'épargne, les deniers de l'épargne, &c.
Epargne en ce sens n'est plus guère d'usage ; on dit plutôt aujourd'hui trésor royal.
Epargne, la loi de l'épargne, expression employée par quelques physiciens modernes, pour exprimer le decret par lequel Dieu règle de la manière la plus simple et la plus constante tous les mouvements, toutes les altérations, et les autres changements de la nature. Voyez ACTION, COSMOLOGIE, etc.
Epargne, dans le sens le plus vulgaire, est une dépendance de l'économie ; c'est proprement le soin et l'habileté nécessaires pour éviter les dépenses superflues, et pour faire à peu de frais celles qui sont indispensables. Les réflexions que l'on Ve lire ici, auraient pu entrer au mot ECONOMIE, qui a un sens plus étendu, et qui embrasse tous les moyens légitimes, tous les soins nécessaires pour conserver et pour accroitre un bien quelconque, et surtout pour le dispenser à-propos. C'est en ce sens que l'on dit économie d'une famille, économie des abeilles, économie nationale. Au reste les termes d'épargne et d'économie énoncent à-peu-près la même idée ; et on les emploiera indifféremment dans ce discours, suivant qu'ils paraitront plus convenables pour la justesse de l'expression.
L'épargne économique a toujours été regardée comme une vertu, et dans le Paganisme, et parmi les Chrétiens ; il s'est même Ve des héros qui l'ont constamment pratiquée : cependant, il faut l'avouer, cette vertu est trop modeste, ou, si l'on veut, trop obscure pour être essentielle à l'héroïsme ; peu de héros sont capables d'atteindre jusque-là. L'économie s'accorde beaucoup mieux avec la politique ; elle en est la base, l'appui, et l'on peut dire en un mot qu'elle en est inséparable. En effet, le ministère est proprement le soin de l'économie publique : aussi M. de Sully, ce grand ministre, cet économe si sage et si zélé, a-t-il intitulé ses mémoires, Economies royales, &c.
L'épargne économique s'allie encore parfaitement avec la piété, elle en est la compagne fidèle ; c'est-là qu'une âme chrétienne trouve des ressources assurées pour tant de bonnes œuvres que la charité prescrit.
Quoi qu'il en sait, il n'est peut-être pas de peuple aujourd'hui moins amateur ni moins au fait de l'épargne, que les François ; et en conséquence il n'en est guère de plus agité, de plus exposé aux chagrins et aux miseres de la vie. Au reste, l'indifférence ou plutôt le mépris que nous avons pour cette vertu, nous est inspiré dès l'enfance par une mauvaise éducation, et surtout par les mauvais exemples que nous voyons sans-cesse. On entend louer perpétuellement la somptuosité des repas et des fêtes, la magnificence des habits, des appartements, des meubles, etc. Tout cela est représenté, non-seulement comme le but et la récompense du travail et des talents, mais surtout comme le fruit du goût et du génie, comme la marque d'une âme noble et d'un esprit élevé.
D'ailleurs, quiconque a un certain air d'élégance et de propreté dans tout ce qui l'environne ; quiconque sait faire les honneurs de sa table et de sa maison, passe à coup sur pour homme de mérite et pour galant homme, quand même il manquerait essentiellement dans le reste.
Au milieu de ces éloges prodigués au luxe et à la dépense, comment plaider la cause de l'épargne ? Aussi ne s'avise-t-on pas aujourd'hui dans un discours étudié, dans une instruction, dans un prône, de recommander le travail, l'épargne, la frugalité, comme des qualités estimables et utiles. Il est inoui qu'on exhorte les jeunes gens à renoncer au vin, à la bonne-chère, à la parure, à savoir se priver des vaines superfluités, à s'accoutumer de bonne heure au simple nécessaire. De telles exhortations paraitraient basses et mal-sonnantes ; elles sont néanmoins bien conformes aux maximes de la sagesse, et peut-être seraient-elles plus efficaces que toute autre morale, pour rendre les hommes réglés et vertueux. Malheureusement elles ne sont point à la mode parmi nous, on s'en éloigne même tous les jours de plus en plus ; par-tout on insinue le contraire, la mollesse et les commodités de la vie. Je me souviens que dans ma jeunesse on remarquait avec une sorte de mépris les jeunes gens trop occupés de leur parure ; aujourd'hui on regarderait avec mépris ceux qui auraient un air simple et négligé. L'éducation devrait nous apprendre à devenir des citoyens utiles, sobres, désintéressés, bienfaisants : qu'elle nous éloigne aujourd'hui de ce grand but ! elle nous apprend à multiplier nos besoins, et par-là elle nous rend plus avides, plus à charge à nous-mêmes, plus durs et plus inutiles aux autres.
Qu'un jeune homme ait plus de talent que de fortune, on lui dira tout au plus d'une manière vague, qu'il doit songer tout de bon à son avancement ; qu'il doit être fidèle à ses devoirs, éviter les mauvaises compagnies, la débauche, etc. mais on ne lui dira pas, ce qu'il faudrait pourtant lui dire et lui répeter sans-cesse, que pour s'assurer le nécessaire et pour s'avancer par des voies légitimes, pour devenir honnête homme et citoyen vertueux, utîle à soi et à sa patrie, il faut être courageux et patient, travailler sans relâche, éviter la dépense, mépriser également la peine et le plaisir, et se mettre enfin au-dessus des préjugés qui favorisent le luxe, la dissipation et la mollesse.
On connait assez l'efficacité de ces moyens : cependant comme on attache mal-à-propos certaine idée de bassesse à tout ce qui sent l'épargne et l'économie, on n'oserait donner de semblables conseils, on croirait prêcher l'avarice ; sur quoi je remarque en passant, que de tous les vices combattus dans la morale, il n'en est pas de moins déterminé que celui-ci.
On nous dépeint souvent les avares comme des gens sans honneur et sans humanité, gens qui ne vivent que pour s'enrichir, et qui sacrifient tout à la passion d'accumuler ; enfin comme des insensés, qui, au milieu de l'abondance, écartent loin d'eux toutes les douceurs de la vie, et qui se refusent jusqu'au rigide nécessaire. Mais peu de gens se reconnaissent à cette peinture affreuse ; et s'il fallait toutes ces circonstances pour constituer l'homme avare, il n'en serait presque point sur la terre. Il suffit pour mériter cette odieuse qualification, d'avoir un violent désir des richesses, et d'être peu scrupuleux sur les moyens d'en acquérir. L'avarice n'est point essentiellement unie à la lésine, peut-être même n'est-elle pas incompatible avec le faste et la prodigalité.
Cependant, par un défaut de justesse, qui n'est que trop ordinaire, on traite communément d'avare l'homme sobre, attentif et laborieux, qui, par son travail et ses épargnes, s'élève insensiblement au-dessus de ses semblables ; mais plut au ciel que nous eussions bien des avares de cette espèce ! la société s'en trouverait beaucoup mieux, et l'on n'essuyerait pas tant d'injustices de la part des hommes. En général ces hommes resserrés, si l'on veut, mais plutôt ménagés qu'avares, sont presque toujours d'un bon commerce ; ils deviennent même quelquefois compatissants ; et si on ne les trouve pas généreux, on les trouve au moins assez équitables. Avec eux enfin on ne perd presque jamais, au lieu qu'on perd le plus souvent avec les dissipateurs. Ces ménagers en un mot sont dans le système d'une honnête épargne, à laquelle nous prodiguons mal-à-propos le nom d'avarice.
Les anciens Romains plus éclairés que nous sur cette matière, étaient bien éloignés d'en user de la sorte ; loin de regarder la parcimonie comme une pratique basse ou vicieuse, erreur trop commune parmi les Français, ils l'identifiaient, au contraire, avec la probité la plus entière ; ils jugeaient ces vertueuses habitudes tellement inséparables, que l'expression connue de vir frugi, signifiait tout à la fais, chez eux, l'homme sobre et ménager, l'honnête homme et l'homme de bien.
L'Esprit-Saint nous présente la même idée ; il fait en mille endroits l'éloge de l'économie, et partout il la distingue de l'avarice. Il en marque la différence d'une manière bien sensible, quand il dit d'un côté qu'il n'est rien de plus méchant que l'avarice, ni rien de plus criminel que d'aimer l'argent (Ecclésiastesiast. Xe 9. 10.) et que de l'autre il nous exhorte au travail, à l'épargne, à la sobriété, comme aux seuls moyens d'enrichissement, lorsqu'il nous représente l'aisance et la richesse comme des biens désirables, comme les heureux fruits d'une vie sobre et laborieuse.
Allez, dit-il au paresseux, allez à la fourmi, et voyez comme elle ramasse dans l'été de quoi subsister dans les autres saisons. Prov. VIe 6.
Celui, dit-il encore, qui est lâche et négligent dans son travail, ne vaut guère mieux que le dissipateur. Prov. XVIIIe 9.
Il nous assure de même, que le paresseux qui ne veut pas labourer pendant la froidure, sera réduit à mendier pendant l'été. Prov. xx. 4.
Il nous dit dans un autre endroit : pour peu que vous cédiez aux douceurs du repos, à l'indolence, à la paresse, la pauvreté viendra s'établir chez vous et s'y rendra la plus forte : mais, continue-t-il, si vous êtes actif et laborieux, votre moisson sera comme une source abondante, et la disette fuira loin de vous. Prov. VIe 10. 11.
Il rappelle une seconde fois la même leçon, en disant que celui qui laboure son champ sera rassasié ; mais que celui qui aime l'oisiveté sera surpris par l'indigence. Prov. xxviij. 19.
Il nous avertit en même temps, que l'ouvrier sujet à l'ivrognerie ne deviendra jamais riche. Ecclésiastesiastique, xjx. 1.
Que quiconque aime le vin et la bonne chère, non-seulement ne s'enrichira point, mais qu'il tombera même dans la misere. Prov. xxj. 17.
Il nous défend de regarder le vin lorsqu'il brille dans un verre, de peur que cette liqueur ne fasse sur nous des impressions agréables mais dangereuses, et qu'ensuite semblable à un serpent et à un basilic, elle ne nous tue de son poison. Prov. xxiij. 31. 32.
Retranchez, dit-il ailleurs, retranchez le vin à ceux qui sont chargés du ministère public, de peur qu'enivrés de cette boisson traitresse, ils ne viennent à oublier la justice, et qu'ils n'altèrent le bon droit du pauvre. Prov. xxxj. 4. 5.
Contentez-vous, dit-il encore, du lait de vos chèvres pour votre nourriture, et qu'il fournisse aux autres besoins de votre maison, etc. Prov. xxvij. 27.
Que d'instruction et d'encouragement à l'épargne et aux travaux économiques, ne trouve-t-on pas dans l'éloge qu'il fait de la femme forte ! Il nous la dépeint comme une mère de famille attentive et ménagère, qui rend la vie douce à son mari et lui épargne mille sollicitudes ; qui forme des entreprises importantes, et qui met elle-même la main à l'œuvre ; qui se lève avant le jour pour distribuer l'ouvrage et la nourriture à ses domestiques ; qui augmente son domaine par de nouvelles acquisitions ; qui plante des vignes ; qui fabrique des étoffes pour fournir sa maison et pour commercer au-dehors ; qui n'a d'autre parure qu'une beauté simple et naturelle ; qui met néanmoins dans l'occasion les habits les plus riches ; qui ne profère que des paroles de douceur et de sagesse ; qui est enfin compatissante et secourable pour les malheureux. Prov. xxxj. 10. 11. 12. 13. 14. 15. &c.
A ces préceptes, à ces exemples d'économie si bien tracés dans les livres de la Sagesse, joignons un mot de S. Paul, et confirmons le tout par un trait d'épargne que J. C. nous a laissé. L'apôtre écrivant à Timothée, veut entr'autres qualités dans les évêques, qu'ils soient capables d'élever leurs enfants et de régler leurs affaires domestiques, en un mot qu'ils soient de bons économes ; en effet, dit-il, s'ils ne savent pas conduire leur maison, comment conduiront-ils les affaires de l'Eglise ? Si quis autem domui suae prae esse nescit, quomodò ecclesiae Dei diligentiam habebit ? I. épitre à Timothée, ch. IIIe . 4. 5.
Le Sauveur nous donne aussi lui-même un excellente leçon d'économie, lorsqu'ayant multiplié cinq pains et deux poissons au point de rassasier une foule de peuple qui le suivait, il fait ramasser ensuite les morceaux qui restent et qui remplissent douze corbeilles, et cela, comme il le dit, pour ne rien laisser perdre : colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant. Jean, VIe 12.
Malgré ces autorités si respectables et si sacrées, le goût des vains plaisirs et des folles dépenses est chez nous la passion dominante, ou plutôt c'est une espèce de manie qui possède les grands et les petits, les riches et les pauvres, et à laquelle nous sacrifions souvent une bonne partie du nécessaire.
Au reste il faudrait n'avoir aucune expérience du monde, pour proposer sérieusement l'abolition totale du luxe et des superfluités ; aussi n'est-ce pas là mon intention. Le commun des hommes est trop faible, trop esclave de la coutume et de l'opinion, pour résister au torrent du mauvais exemple ; mais s'il est impossible de convertir la multitude, il n'est peut-être pas difficîle de persuader les gens en place, gens éclairés et judicieux, à qui l'on peut représenter l'abus de mille dépenses inutiles au fond, et dont la suppression ne gênerait point la liberté publique ; dépenses qui d'ailleurs n'ont proprement aucun but vertueux, et qu'on pourrait employer avec plus de sagesse et d'utilité : feux d'artifice et autres feux de joie, bals et festins publics, entrées d'ambassadeurs, etc. que de momeries, que d'amusements puériles, que de millions prodigués en Europe, pour payer tribut à la coutume ! tandis qu'on est pressé de besoins réels, auxquels on ne saurait satisfaire, parce qu'on n'est pas fidèle à l'économie nationale.
Mais que dis-je ? On commence à sentir la futilité de ces dépenses, et notre ministère l'a déjà bien reconnue, lorsque le ciel ayant comblé nos vœux par la naissance du duc de Bourgogne, ce jeune prince si cher à la France et à l'Europe entière, on a mieux aimé pour exprimer la joie commune dans cet heureux événement, on a mieux aimé, dis-je, allumer de toutes parts le flambeau de l'hymenée, et présenter aux peuples ses ris et ses jeux pour favoriser la population par de nouveaux mariages, que de faire, suivant la coutume, des prodigalités mal entendues, que d'allumer des feux inutiles et dispendieux qu'un instant voit briller et s'éteindre.
Cette pratique si raisonnable rentre parfaitement dans la pensée d'un sage suédois, qui donnant une somme, il y a deux ans, pour commencer un établissement utîle à sa patrie, s'exprimait ainsi dans une lettre qu'il écrivait à ce sujet : " Plut au ciel que la mode put s'établir parmi nous, que dans tous les événements qui causent l'allégresse publique, on ne fit éclater sa joie que par des actes utiles à la société ! on verrait bientôt nombre de monuments honorables de notre raison, qui perpétueraient bien mieux la mémoire des faits dignes de passer à la postérité, et seraient plus glorieux pour l'humanité que tout cet appareil tumultueux de fêtes, de repas, de bals, et d'autres divertissements usités en pareilles occasions ". Gazette de France, 8 Décembre 1753. Suède.
La même proposition est bien confirmée par l'exemple d'un empereur de la Chine qui vivait au dernier siècle, et qui dans l'un des grands événements de son règne, défendit à ses sujets de faire les réjouissances ordinaires et consacrées par l'usage, soit pour leur épargner des frais inutiles et mal placés, soit pour les engager vraisemblablement à opérer quelque bien durable, plus glorieux pour lui-même, plus avantageux à tout son peuple, que des amusements frivoles et passagers, dont il ne reste aucune utilité sensible.
Voici encore un trait que je ne dois pas oublier : " Le ministère d'Angleterre, dit une gazette.... de l'année 1754, a fait compter mille guinées à M. Wal, ci-devant ambassadeur d'Espagne à Londres ; ce qui est, dit-on, le présent ordinaire que l'état fait aux ministres étrangers en quittant la Grande-Bretagne ". Qui ne voit que mille guinées ou mille louis forment un présent plus utîle et plus raisonnable que ne serait un bijou, uniquement destiné à l'ornement d'un cabinet ?
Après ces grands exemples d'épargne politique, oserait-on blâmer cet ambassadeur hollandais, qui recevant à son départ d'une cour étrangère le portrait du prince enrichi de diamants, mais qui trouvant bien du vide dans ce présent magnifique, demanda bonnement ce que cela pouvait valoir. Comme on l'eut assuré que le tout coutait quarante mille écus : que ne me donnait-on, dit-il, une lettre-de-change de pareille somme à prendre sur un banquier d'Amsterdam ? Cette naïveté hollandaise nous fait rire d'abord ; mais en examinant la chose de près, les gens sensés jugeront apparemment qu'il avait raison, et qu'une bonne lettre de quarante mille écus est bien plus de service qu'un portrait.
En suivant le même goût d'épargne, que de retranchements, que d'institutions utiles et praticables en plusieurs genres différents ! Que d'épargnes possibles dans l'administration de la justice, police, et finances, puisqu'il serait aisé, en simplifiant les régies et les autres affaires, d'employer à tout cela bien moins de monde qu'on ne fait à présent ! Cet article est assez important pour mériter des traités particuliers ; nous en avons sur cela plusieurs qu'on peut lire avec beaucoup de fruit.
Que d'épargnes possibles dans la discipline de nos troupes, et que d'avantages on en pourrait tirer pour le roi et pour l'état, si l'on s'attachait comme les anciens à les occuper utilement ! J'en parlerai dans quelqu'autre occasion.
Que d'épargnes possibles dans la police des Arts et du Commerce, en levant les obstacles qu'on trouve à chaque pas sur le transport et le débit des marchandises et denrées, mais surtout en rétablissant peu-à-peu la liberté générale des métiers et négoces, telle qu'elle était jadis en France, et telle qu'elle est encore aujourd'hui en plusieurs états voisins ; supprimant par conséquent les formalités onéreuses des brevets d'apprentissage, maitrises et réceptions, et autres semblables pratiques, qui arrêtent l'activité des travailleurs, souvent même qui les éloignent tout à fait des occupations utiles, et qui les jettent ensuite en des extrémités funestes ; pratiques enfin que l'esprit de monopole a introduites en Europe, et qui ne se maintiennent dans ces temps éclairés, que par le peu d'attention des législateurs. Nous n'avons déjà, tous tant que nous sommes, que trop de répugnance pour les travaux pénibles ; il ne faudrait pas en augmenter les difficultés, ni faire naître des occasions ou des prétextes à notre paresse.
De plus, indépendamment des maitrises, il y a parmi les ouvriers mille usages abusifs et ruineux qu'il faudrait abolir impitoyablement ; tels sont, par exemple, tous droits de compagnonage, toutes fêtes de communauté, tous frais d'assemblée, jetons, bougies, repas et buvettes ; occasions perpétuelles de fainéantise, d'excès et de pertes, qui retombent nécessairement sur le public, et qui ne s'accordent point avec l'économie nationale.
Que d'épargnes possibles enfin dans l'exercice de la religion, en supprimant les trois quarts de nos fêtes, comme on l'a fait en Italie, dans l'Autriche, dans les Pays-Bas, et ailleurs : la France y gagnerait des millions tous les ans ; outre que l'on épargnerait bien des frais qui se font ces jours-là dans nos églises. Qu'on pardonne sur cela les détails suivants, à un citoyen que l'amour du bien public anime.
Quel soulagement et quelle épargne pour le public, si l'on retranchait la distribution du pain-beni ! C'est une dépense des plus inutiles, dépense néanmoins considérable et qui fait crier bien des gens. On dit que certains officiers des paroisses font sur cela de petites concussions, ignorées sans-doute de la police, et que la loi n'ayant rien fixé là-dessus, ils rançonnent les citoyens impunément selon qu'ils les trouvent plus ou moins faciles. Quoi qu'il en sait, il est démontré par un calcul exact, que le pain-beni coute en France plusieurs millions par an ; il n'est cependant d'aucune nécessité, il y a même des contrées dans le royaume où l'on n'en donne point du tout : en un mot, il ne porte pas plus de bénédiction que l'eau qu'on emploie pour le benir ; et par conséquent ou pourrait s'en tenir à l'eau qui ne coute rien, et supprimer la dépense du pain-beni comme onéreuse à bien du monde.
Après avoir indiqué la suppression du pain-beni, je ne crois pas devoir épargner davantage la plupart des quêtes usitées parmi nous, et surtout la location des chaises. Tous négoces sont défendus dans le temple du Seigneur ; lui-même les a proscrits hautement, et je ne vois rien dans l'évangîle sur quoi il ait parlé avec tant de force. Domus mea domus orationis est, vos autem fecistis illam speluncam latronum. Luc, xjx. 46. Il me semble que c'est une leçon et pour les pasteurs et pour les magistrats.
Rien de plus indécent que de vendre la place à l'église ; MM. les ecclésiastiques ont grand soin de s'y mettre à l'aise et proprement, assis et à genoux : il conviendrait que tous les fidèles y fussent de même commodément, et sans jamais financer. Pour cela il y faudrait mettre des bancs appropriés à cette fin, bancs qui rempliraient la nef et les côtés, et n'y laisseraient que de simples passages. J'ai Ve quelque chose d'approchant dans une province du royaume, mais beaucoup mieux en Angleterre et en Hollande, où l'on est assis dans les temples sans aucuns frais, et sans être interrompu par des mendiants, par des quêteurs, ni par des loueurs de chaises. En quoi les Protestants nous donnent un bel exemple à suivre, si nous étions assez raisonnables, assez désintéressés pour cela.
Mais, dira-t-on sans-doute, cette recette retranchée, comment fournir aux dépenses ordinaires ? En voici le moyen sur et facile, c'est de retrancher tout à fait une bonne partie de ces dépenses, et de modérer, comme il est possible, celles que l'on croit les plus indispensables. Quelle nécessité d'avoir tant de chantres et autres officiers dans les paroisses ? A quoi bon tant de luminaires, tant d'ornements, tant de cloches, etc. Si l'on était un peu raisonnable faudrait-il tant d'étalage, tant de cire et de sonnerie pour enterrer les morts ? On en peut dire autant de mille autres superfluités onéreuses, et qui dénotent plus dans les uns l'amour du lucre, dans les autres l'amour du faste, que le zèle de la religion et de la vraie piété.
Au surplus, il n'est pas possible que de simples particuliers remédient jamais à de pareils abus ; chacun sent la tyrannie de la coutume, chacun même en gémit dans son particulier ; cependant tout le monde porte le joug. L'homme enfant craint la censure et le qu'en dira-t-on, et personne n'ose résister au torrent. C'est donc au gouvernement à déterminer une bonne fais, suivant la différence des conditions, tous frais funéraires, frais de mariage et de baptême, etc. et je crois qu'on pourrait, au grand bien du public, les reduire à-peu-près au tiers de ce qu'il en coute aujourd'hui ; en sorte que ce fût une règle constante pour toutes les familles, et qu'il fût absolument défendu aux particuliers et aux curés de faire ou de souffrir aucune dépense au-delà.
Quelques politiques modernes ont sagement observé que le nombre surabondant des gens d'église était visiblement contraire à l'opulence nationale, ce qui est principalement vrai des réguliers de l'un et de l'autre sexe. En effet, excepté ceux qui ont un ministère utîle et connu, tous les autres vivent aux dépens des vrais travailleurs, sans rien produire de profitable à la société ; ils ne contribuent pas même à leur propre subsistance, fruges consumère nati ; Hor. l. I. ep. IIe Ve 29. et bien qu'issus la plupart des conditions les plus médiocres, bien qu'assujettis par état aux rigueurs de la pénitence, ils trouvent moyen d'éluder l'antique loi du travail, et de mener une vie douce et tranquille sans être obligés d'essuyer la sueur de leur visage.
Pour arrêter un si grand mal politique, il ne faudrait admettre aux ordres que le nombre de sujets nécessaires pour le service de l'église. A l'égard des reclus qui ont un ministère public, on ne peut que louer leur zèle à remplir leurs fonctions pénibles, et on doit les regarder comme des sujets précieux à l'état. Pour les autres qui n'ont pas d'occupations importantes, il paraitrait à-propos d'en diminuer le nombre à l'avenir, et de chercher des moyens pour les rendre plus utiles.
Voilà plusieurs moyens d'épargne que les politiques ont déjà touchés ; mais en voici un autre qu'ils n'ont pas encore effleuré, et qui est néanmoins des plus intéressants : je parle des académies de jeu, qui sont visiblement contraires au bien national ; mais je parle surtout des cabarets si multipliés, si nuisibles parmi nous, que c'est pour le peuple la cause la plus commune de sa misere et de ses désordres.
Les cabarets, à le bien prendre, sont une occasion perpétuelle d'excès et de pertes ; et il serait très-utile, dans les vues de la religion et de la politique, d'en supprimer la meilleure partie à mesure qu'ils viendraient à vaquer. Il ne serait pas moins important de les interdire pendant les jours ouvrables à tous les gens établis et connus en chaque paraisse ; de les fermer sévèrement à neuf heures du soir dans toutes les saisons, et de mettre enfin les contrevenans à une bonne amende, dont moitié aux dénonciateurs, moitié aux inspecteurs de police.
Ces règlements, dira-t-on, bien qu'utiles et raisonnables, diminueraient le produit des aides ; mais premièrement le royaume n'est pas fait pour les aides, les aides au contraire sont faites pour le royaume ; elles sont proprement une ressource pour subvenir à ses besoins : si cependant par quelque occasion que ce puisse être, elles devenaient nuisibles à l'état, il n'est pas douteux qu'il ne fallut les rectifier ou chercher des moyens moins ruineux, à-peu-près comme on change ou qu'on cesse un remède lorsqu'il devient contraire au malade.
D'ailleurs les règlements proposés ne doivent point alarmer les financiers, par la grande raison que ce qui ne se consommerait pas dans les cabarets, se consommerait encore mieux, et plus universellement, dans les maisons particulières, mais pour l'ordinaire sans excès et sans perte de temps ; au lieu que les cabarets, toujours ouverts, dérangent si bien nos ouvriers, qu'on ne peut d'ordinaire compter sur eux, ni voir la fin d'un ouvrage commencé. Nous nous plaignons sans-cesse de la dureté des temps ; que ne nous plaignons-nous plutôt de notre imprudence, qui nous porte à faire et à tolérer des dépenses et des pertes sans nombre ?
Autre proposition qui tient à l'épargne publique, ce serait de fonder des monts de piété dans toutes nos bonnes villes, pour faire trouver de l'argent sur gage et sans intérêt ; si ce n'est peut-être qu'on pourrait tirer deux pour cent par année, pour fournit aux frais de la régie. On sait que les prêteurs-usuraires sont très-nuisibles au public, et qu'ainsi l'on éviterait bien des pertes si l'on pouvait se passer de leur ministère. Il serait donc à souhaiter que les âmes pieuses et les cœurs bienfaisants songeassent sérieusement à effectuer les fondations favorables dont nous parlons.
Outre la commodité générale d'un emprunt gratuit et facîle pour les peuples, je regarde comme l'un des avantages de ces établissements, que ce serait autant de bureaux connus où l'on pourrait déposer avec confiance des sommes qu'on n'est pas toujours à portée de placer utilement, et dont on est quelquefois embarrassé. Combien d'avares qui, craignant pour l'avenir, n'osent se défaire de leur argent ; et qui malgré leurs précautions, ont toujours à redouter les vols, les incendies, les pillages, etc. Combien d'ouvriers, combien de domestiques et d'autres gens isolés, qui ayant épargné une petite somme, dix pistoles, cent écus, plus ou moins, ne savent actuellement qu'en faire, et appréhendent avec raison de les dissiper ou de les perdre ? Je trouve donc qu'il serait avantageux dans tous ces cas de pouvoir déposer surement une somme quelconque, avec liberté de la retirer à son gré. Par-là on ferait circuler dans le public une infinité de sommes petites ou grandes qui demeurent aujourd'hui dans l'inaction. D'un autre côté, les particuliers déposans éviteraient bien des inquiétudes et des filouteries ; outre qu'ils seraient moins exposés à prêter leur argent mal-à-propos, ou à le dépenser follement. Ainsi chacun retrouverait ses fonds ou ses épargnes, lorsqu'il se présenterait de bonnes affaires, et la plupart des ouvriers et des domestiques deviendraient plus économes et plus rangés.
Cette habitude d'économie dans les moindres sujets est plus importante qu'on ne croit au bien général ; et c'est en quoi nous sommes fort au-dessous des nations voisines, qui presque toutes sont plus accoutumées que nous à l'épargne et aux attentions économiques. Voici sur cela un trait qui est particulier aux Anglais, et qui mérite d'être rapporté. On assure donc qu'il y a chez eux, dans la plupart des grandes maisons, ce qu'ils appellent a saving-man, c'est-à-dire un domestique attentif et ménager qui veille perpétuellement à ce que rien ne traine, à ce que rien ne se perde ou ne s'égare. Son unique emploi est de roder à toute heure dans tous les recoins d'une grande maison, depuis la cave jusqu'au grenier, dans les cours, écuries, jardins, et autres dépendances, de remettre en son lieu tout ce qu'il trouve déplacé, et d'emporter dans son magasin tout ce qu'il rencontre épars et à l'abandon, de la ferraille de toute espèce, des bouts de planche et autres bois, des cordes, du cuir, de la chandelle, toute sorte de hardes, meubles, ustenciles, outils, etc.
Outre une infinité de choses, chacune de peu de valeur, mais dont l'ensemble est important, et dont cet économe prévient la perte, il conserve aussi bien souvent des choses de prix, que des maîtres, des domestiques ou des ouvriers laissent trainer par oubli, ou par quelque autre raison que ce puisse être. Sa vigilance réveille l'attention des autres, et il devient par état l'antagoniste de la friponnerie et le réparateur de la négligence.
J'ai déjà marqué ci-devant qu'il n'était ici question que d'épargne publique, et que je ne touchais presque point à la conduite des particuliers. Plusieurs néanmoins ne m'ont opposé que de prétendus inconvénients contre la suppression totale de notre luxe, ce qui n'attaque point ma thèse, et porte par conséquent à faux : cependant je tâcherai de répondre à l'objection, comme si je lui trouvais quelque fondement solide.
Si l'on suivait, dit-on, tant de projets de perfection et de réformes ; que d'un côté l'on supprimât les dépenses inutiles ; que de l'autre, on se livrât de toutes parts à des entreprises fructueuses ; en un mot, que l'économie devint à la mode parmi les Français, on verrait bien-tôt, à la vérité, notre opulence sensiblement accrue ; mais que ferait-on de tant de richesses accumulées ? D'ailleurs la plupart des sujets, moins employés aux arts de somptuosité, n'auraient guère de part à tant d'opulence, et languiraient apparemment au milieu de l'abondance générale.
Il est aisé de répondre à cette difficulté. En effet, si l'épargne économique s'établissait parmi nous ; qu'on donnât plus au nécessaire et moins au superflu, il se ferait, j'en conviens, moins de dépenses frivoles et mal-placées, mais aussi s'en ferait-il beaucoup plus de raisonnables et de vertueuses. Les riches et les grands, moins obérés, payeraient mieux leurs créanciers : d'ailleurs plus puissants et plus pécunieux, ils auraient plus de facilité à marier leurs enfants ; au lieu d'un mariage, ils en feraient deux ; au lieu de deux, ils en feraient quatre, et l'on verrait ainsi moins de renversement et moins d'extinctions dans les familles. On donnerait moins au faste, au caprice, à la vanité ; mais on donnerait plus à la justice, à la bienfaisance, à la véritable gloire ; en un mot, on emploierait beaucoup moins de sujets à des arts stériles, arts d'amusement et de frivolité, mais beaucoup plus à des arts avantageux et nécessaires ; et pour lors, s'il y avait moins d'artisans du luxe et des plaisirs, moins de domestiques inutiles et desœuvrés, il y aurait en récompense plus de cultivateurs, et d'autres précieux instruments de la véritable richesse.
Il est démontré, pour quiconque réfléchit, que la différence d'occupation dans les sujets produit l'opulence ou la disette nationale, en un mot le bien ou le mal de la société. On sent parfaitement que si quelqu'un peut tenir un homme à ses gages, il lui sera plus avantageux d'avoir un bon jardinier que d'entretenir un domestique de parade. Il y a donc des emplois infiniment plus utiles les uns que les autres ; et si l'on occupait la plupart des hommes avec plus d'intelligence et d'utilité, la nation en serait plus puissante, et les particuliers plus à leur aise.
D'ailleurs la pratique habituelle de l'épargne produisant, au moins chez les riches, une surabondance de biens qui ne s'y trouve presque jamais, il en résulterait pour les peuples un soulagement sensible, en ce que les petits alors seraient moins inquiétés et moins foulés par les grands. Que le loup cesse d'avoir faim, il ne désolera plus les bergeries.
Quoi qu'il en sait, les propositions et les pratiques énoncées ci-dessus nous paraitraient plus intéressantes, si une mauvaise coutume, si l'ignorance et la mollesse ne nous avaient rendus indifférents sur les avantages de l'épargne, et surtout si cette habitude précieuse n'était confondue le plus souvent avec la sordide avarice. Erreur dont nous avons un exemple connu dans le jugement peu favorable qu'on a porté de nos jours d'un citoyen vertueux et désintéressé, feu M. Godinot, chanoine de Reims.
Amateur passionné de l'Agriculture, il consacrait à l'étude de la Physique et aux occupations champêtres tout le loisir que lui laissait le devoir de sa place. Il s'attacha spécialement à perfectionner la culture des vignes, et plus encore la façon des vins, et bien-tôt il trouva l'art de les rendre si supérieurs et si parfaits, qu'il en fournit dans la suite à tous les potentats de l'Europe ; ce qui lui donna moyen dans le cours d'une longue vie, d'accumuler des sommes prodigieuses, sommes dont ce philosophe chrétien méditait de longue-main l'usage le plus noble et le plus digne de sa bienfaisance.
Du reste, il vivait dans la plus grande simplicité, dans la pratique fidèle et constante d'une épargne visible, et qui semblait même outrée. Aussi les esprits vulgaires qui ne jugent que sur les apparences, et qui ne connaissaient pas ses grands desseins, ne le regardèrent pendant bien des années qu'avec une sorte de mépris ; et ils continuèrent toujours sur le même ton, jusqu'à ce que plus instruits et tout à fait subjugués par les établissements et les constructions utiles dont il décora la ville de Reims, et surtout par les travaux immenses qu'il entreprit à ses frais, pour y conduire des eaux abondantes et salubres qui manquaient auparavant, ils lui prodiguèrent enfin avec le reste de la France le tribut d'éloges et d'admiration, qu'ils ne pouvaient refuser à son généreux patriotisme.
Un si beau modèle touchera sans-doute le cœur des Français, encouragés d'ailleurs par l'exemple de plusieurs sociétés établies en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, sociétés uniquement occupées de vues économiques, et qui de leurs propres deniers font tous les ans des largesses considérables aux laboureurs, et aux artistes qui se distinguent par la supériorité de leurs travaux et de leurs découvertes. Le même goût s'est répandu jusqu'en Italie. On apprit l'an passé le nouvel établissement d'une académie d'Agriculture à Florence.
Mais c'est principalement en Suède que la science économique semble avoir fixé le siège de son empire. Dans les autres contrées elle n'est cultivée que par quelques amateurs, ou par de faibles compagnies encore peu accréditées et peu connues : en Suède, elle trouve une académie royale qui lui est uniquement dévouée ; qui est formée d'ailleurs et soutenue par tout ce qu'il y a de plus savant et de plus distingué dans l'état ; académie qui, écartant tout ce qui n'est que d'érudition, d'agrément et de curiosité, n'admet que des observations et des recherches tendantes à l'utilité physique et sensible.
C'est de ce fonds abondant que s'enrichit le plus souvent notre journal économique, production nouvelle digne par son objet de toute l'attention du ministère, et qui l'emporterait par son utilité sur tous nos recueils d'académies, si le gouvernement commettait à la direction de cet ouvrage des hommes parfaitement au fait des sciences et des arts économiques, et que ces hommes précieux, animés et conduits par un supérieur éclairé, ne fussent jamais à la merci des entrepreneurs, jamais frustrés par conséquent des justes honoraires si bien dû. à leur travail.
Ce serait en effet une vue bien conforme à la justice et à l'économie publique, de ne pas abandonner le plus grand nombre de sujets à la rapacité de ceux qui les emploient, et dont le but principal, ou pour mieux dire unique, est de profiter du labeur d'autrui sans égard au bien des travailleurs. Sur quoi j'observe que dans ce conflit d'intérêts, le gouvernement devrait abroger toute concession de droits privatifs, fermer l'oreille à toute représentation qui, colorée du bien public, est au fond suggérée par l'esprit de monopole, et qu'il devrait opérer sans ménagement ce qui est équitable en soi, et favorable à la franchise des arts et du commerce.
Quoi qu'il en sait, nous pouvons féliciter la France de ce que, parmi tant d'académiciens livrés à la manie du bel esprit, mais peu touchés des recherches utiles, elle compte des génies supérieurs, des hommes consommés en tout genre de sciences, lesquels ont toujours allié la beauté du style, les grâces même de l'éloquence avec les études les plus solides, et qui s'étant consacrés depuis bien des années à des travaux et à des essais économiques, nous ont enrichis, comme on sait, des découvertes les plus intéressantes.
Il parait enfin que depuis la paix de 1748, le goût de l'économie publique gagne insensiblement l'Europe entière. Les princes aujourd'hui, plus éclairés qu'autrefois, ambitionnent beaucoup moins de s'agrandir par la guerre. L'histoire et l'expérience leur ont également appris que c'est une voie incertaine et destructive. L'amélioration de leurs états leur en présente une autre plus courte et plus assurée ; aussi tous s'y livrent comme à l'envi, et ils paraissent plus disposés que jamais à profiter de tant d'ouvrages publiés de nos jours sur le commerce, la navigation, et la finance, sur l'exploitation des terres, sur l'établissement et le progrès des arts les plus utiles ; dispositions favorables, qui contribueront à rendre les sujets plus économes, plus sains, plus fortunés, et je crois même plus vertueux.
En effet, la véritable économie également inconnue à l'avare et au prodigue, tient un juste milieu entre les extrêmes opposés ; et c'est au défaut de cette vertu si déprimée, qu'on doit attribuer la plupart des maux qui couvrent la face de la terre. Le goût trop ordinaire des amusements, des superfluités et des délices entraîne la mollesse, l'oisiveté, la dépense, et souvent la disette, mais toujours au moins la soif des richesses, qui deviennent d'autant plus nécessaires qu'on s'assujettit à plus de besoins ; ce qui produit ensuite les artifices et les détours, la rapacité, la violence, et tant d'autres excès qui viennent de la même source.
Je prêche donc hautement l'épargne publique et particulière ; mais c'est une épargne sage et désintéressée, qui donne du courage contre la peine, de la fermeté contre le plaisir, et qui est enfin la meilleure ressource de la bienfaisance et de la générosité ; c'est cette honnête parcimonie si chère autrefois à Pline le jeune, et qui le mettait en état, comme il le dit lui-même, de faire dans une fortune médiocre, de grandes libéralités publiques et particulières. Quidquid mihi pater tuus debuit, acceptum tibi ferri jubeo ; nec est quod verearis ne sit mihi ista onerosa donatio. Sunt quidem omnino nobis modicae facultates, dignitas sumptuosa, reditus propter conditionem agellorum nescio minor an incertior ; sed quod cessat ex reditu, frugalitate suppletur, ex quâ velut à fonte liberalitas nostra decurrit. Lettres de Pline, livre II. lettre IVe On trouve dans toutes ces lettres mille traits de bienfaisance. Voyez surtout liv. III. lett. XIe liv. IV. lett. XIIIe &c.
Rien ne devrait être plus recommandé aux jeunes gens que cette habitude vertueuse, laquelle deviendrait pour eux un préservatif contre les vices. C'est en quoi l'éducation des anciens était plus conséquente et plus raisonnable que la nôtre. Ils accoutumaient les enfants de bonne-heure aux pratiques du ménage, tant par leur propre exemple que par le pécule qu'ils leur accordaient, et que ceux-ci, quoique jeunes et dépendants, faisaient valoir à leur profit. Cette légère administration leur donnait un commencement d'application et de sollicitude, qui devenait utîle pour le reste de la vie.
Que nous pensons là-dessus différemment des anciens ! on n'oserait aujourd'hui tourner les jeunes gens à l'économie ; et ce serait, comme l'on pense, n'avoir pas de sentiments que de leur en inspirer l'estime et le gout. Erreur bien commune dans notre siècle, mais erreur funeste qui nuit infiniment à nos mœurs. On a fondé en mille endroits des prix d'éloquence et de poésie ; qui fondera parmi nous des prix d'épargne et de frugalité ?
Au reste, ces propositions n'ont d'autre but que d'éclairer les hommes sur leurs intérêts, de les rendre plus attentifs sur le nécessaire, moins ardents sur le superflu, en un mot d'appliquer leur industrie à des objets plus fructueux, et d'employer un plus grand nombre de sujets pour le bien moral, physique et sensible de la société. Plut au ciel que de telles mœurs prissent chez nous la place de l'intérêt, du luxe et des plaisirs ; que d'aisance, que de bonheur et de paix il en résulterait pour tous les citoyens ! Cet article est de M. FAIGUET.